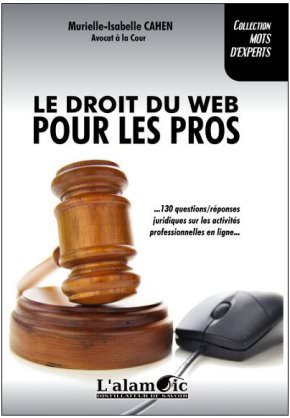21 Jan 2026
Propriété intellectuelle, stockage de l’œuvre. Quels droits donnent un NFT ((jeton non fongible)) ?
Le cas des œuvres numériques est évoqué à l’article R. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui vise les « créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de douze exemplaires »…(1)
L’approche retenue est clairement axée sur le support, qui reste l’élément déterminant de l’application du droit de suite. Cela correspond au demeurant aux pratiques du marché : pour la plupart des créations numériques qui passent en vente, les acquéreurs se voient remettre le support de stockage, éventuellement numéroté et signé. Le support contrebalance l’ubiquité des objets numériques et pourvoit la rareté recherchée par les acquéreurs.
L’arrivée sur le marché de l’art d’œuvres entièrement dématérialisées renouvelle la question. L’œuvre étant duplicable à l’infini, son appréhension par le droit de suite ne va pas de soi. Les technologies de blockchain permettent cependant de recréer les caractères du support matériel, en associant l’œuvre à un jeton non fongible (NFT), infalsifiable, unique et non interchangeable.
Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?
Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63
ou contactez-nous en cliquant sur le lien
« Les NFT, une technologie aux usages divers, à fort potentiel économique,,, » (1) . Par cette affirmation, le Conseil des ventes volontaires mettait en lumière le succès très remarqué des Non Fungible Tokens (NFT) ou des jetons non interchangeables ces derniers temps. Le marché des NFT a connu une croissance exponentielle en 2021, se chiffrant en dizaines de milliards de dollars.La cession de « The Merge » de l’artiste anonyme Pak constitue l’un des exemples les plus marquants du marché des NFT, avec un prix record de 91,8 millions de dollars.. L’exemple le plus significatif reste la vente aux enchères de la photo numérique « Everyday : the first 5 000 days » de l’artiste américain « Beeple » (Mike Winkelmann), sous forme de NFT, à 69,3 millions de dollars le 11 mars 2021. Au regard de l’essor actuel des NFT, il devient important pour les entrepreneurs de savoir à quoi correspond cette technologie.
Les NFT sont intimement liés à la technologie de blockchain, puisqu’ils sont inscrits sur celle-ci. C’est la raison pour laquelle il convient de présenter brièvement la blockchain. D’après un rapport de l’Assemblée nationale de 2018, « une blockchain est un registre, une grande base de données qui a la particularité d’être partagée simultanément avec tous ses utilisateurs, tous également détenteurs de ce registre, et qui ont également tous la capacité d’y inscrire des données, selon des règles spécifiques fixées par un protocole informatique très bien sécurisée grâce à la cryptographie ».(3)
Le modèle économique d’une blockchain repose avant tout sur une promesse de sécurité optimale. Les échanges successifs sont enregistrés sous forme de blocs de transactions, d’où le nom « blockchain » ou « chaîne de blocs ». Chaque bloc est relié à ceux qui le précèdent et le suivent. Les blocs confirment l’heure et la séquence exactes des transactions. Il est impossible de modifier un bloc ou d’insérer un nouveau bloc entre deux blocs.
Comme tout marché émergent dans le domaine du luxe, du sport et de l’art, l’univers des « NFT » n’est pas épargné par les problématiques de fraude.
Comme souvent, le droit arrivera à rebours pour réguler ce nouveau marché et dans l’intervalle, il conviendra de composer avec la législation existante afin de l’interpréter, de l’étendre et ainsi d’assurer la protection des titulaires de droits de propriété intellectuelle.
I. Qu’est-ce qu’un NFT (jeton non fongible) ?
Les NFT sont par définition des unités de valeur non interchangeables avec d’autres. Le jeton représente un actif unique, qui ne peut pas être remplacé par un autre. On le dit alors non fongibleIls constituent une sorte de certificat numérique inscrit sur une blockchain et attestant de l’authenticité d’un bien ou d’une œuvre, physique ou numérique.(4)
La création d’un NFT nécessite que soit généré un « smart contract » : un programme informatique qui exécute un ensemble d’instructions ou de règles prédéfinies par le créateur du smart contract. C’est ensuite ledit smart contract qui est déployé et exécuté sur une blockchain (via un processus dit de « minting »).
Le NFT n’est donc pas l’œuvre numérique ou le produit marqué en lui-même. L’acquéreur du NFT acquiert seulement un « jeton » auquel certains droits sont associés et qui présente des caractéristiques déterminées dans le smart contract qui a donné lieu à sa création.
Ce NFT correspond donc à une sorte de certificat d’authenticité de cette œuvre ou de cet objet, ledit certificat étant inscrit sur la blockchain et permettant ainsi, en principe, de garantir le caractère unique et l’authenticité du fichier numérique y étant associé ainsi que l’identité de son propriétaire.
Il s’agit donc de l’acquisition d’un bien incorporel : le « jeton » ou NFT. L’œuvre numérique ou le fichier numérique représentant le bien sur lequel est apposée une marque reste quant à lui stocké hors de la blockchain (sur un serveur, dans un cloud, sur un serveur décentralisé de type IPFS) et est accessible via l’URL figurant dans le smart contract.
II. Qui peut consentir à la création d’un NFT ?
Pour répondre à cette question, il convient au préalable de déterminer « sur quoi porte le NFT ».
Ce qui fait la valeur du NFT, c’est la communauté qu’il intéresse. Cette communauté est classiquement formée autour de la notoriété d’un artiste, d’une célébrité, d’un sportif, d’une marque de luxe, de sport, d’un jeu vidéo, etc.Toutefois, les prix des NFT connaissent de fortes fluctuations, comme l’illustre le NFT du premier tweet de l’histoire, acquis pour 2,9 millions de dollars et qui ne vaut aujourd’hui plus que quelques milliers de dollars. (5)
Ce qui donne lieu à la création d’un NFT peut ainsi être l’image d’une personne, une œuvre visuelle ou audiovisuelle, une création d’art appliqué (un modèle de sac à main, de chaussures, etc.) revêtue d’une marque de renommée, une bouteille de vin, etc.
Par conséquent, compte tenu de sa nature protéiforme, le NFT est susceptible de donner prise à différents types de droits : droit d’auteur, droit des marques, droit des dessins et modèles, droit à l’image.
C’est la raison pour laquelle il est indispensable de disposer des droits patrimoniaux d’auteur, du droit d’exploitation des marques ou des dessins et modèles ou des droits à l’image concernée pour pouvoir autoriser la création d’un NFT reproduisant ou renvoyant à l’« objet de droit » concerné.
C’est ce qu’ont découvert à leurs dépens les créateurs de la plateforme américaine HitPiece se décrivant comme une plateforme dédiée aux NFT musicaux. Cette plateforme a ainsi créé un très important catalogue de NFT d’œuvres musicales d’artistes très connus tels que John Lennon, les Rolling Stones. Or, la plateforme à peine lancée, cette création de NFT à partir de leur musique et sans autorisation a été massivement dénoncée par les artistes via les réseaux sociaux. La plateforme a finalement été fermée après avoir reçu une mise en demeure de la puissante Recording Industry Association of America (RIAA).
III. Quels droits acquiert-on lorsqu’on achète un NFT ?
L’acquisition d’un NFT ne permet d’acquérir juridiquement que les droits prévus au smart contract à l’origine dudit NFT.
Ainsi, sauf à ce que cela soit expressément prévu au smart contract, l’acquisition d’un NFT ne permet en aucun cas, d’acquérir de manière automatique ou implicite, les droits patrimoniaux
d’auteur sur une œuvre numérique, des droits d’exploitation d’une marque, d’un dessin ou d’un modèle ou encore, un droit d’exploitation de l’image d’une personne physique.
A notre sens, les principes de droit positif en matière de cession et d’exploitation des droits de propriété intellectuelle trouvent ici pleinement à s’appliquer sans qu’il ne soit nécessaire ou indispensable que le Code de la propriété intellectuelle (le « CPI ») fasse expressément référence à la notion de « NFT ».
A. Le titulaire des droits de propriété intellectuelle bénéficie-t-il d’un « droit de suite » ? Le cas échéant, ce droit de suite est-il légal ou contractuel ?
-
Le droit de suite au sens du CPI
Le droit de suite tel que défini par le CPI ne trouve à s’appliquer que s’agissant d’une œuvre graphique ou plastique.
L’article L. 122-8 du CPI reconnaît aux auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques le droit de percevoir un pourcentage du prix de toute vente de l’œuvre après la première cession opérée par eux-mêmes ou par leurs ayants droit, lorsqu’un professionnel du marché de l’art intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire.(6)
Ainsi les conditions d’application du droit de suite au sens de l’article L. 122-8 du CPI peuvent être résumées comme suit :
Il doit porter sur une œuvre graphique ou plastique telles que des tableaux, collages, peintures, dessins, gravures, estampes, lithographies, sculptures, tapisseries, céramiques, verreries ou encore photographies. Cette liste n’est pas exhaustive et la jurisprudence admet que le droit de suite s’applique aux œuvres d’arts appliqués .(7)
En outre, l’article R. 122-3 du CPI prévoit expressément que donnent prise au droit de suite les « créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de douze exemplaires ».
Seule la revente de l’original d’une œuvre graphique ou plastique donne prise au droit de suite.
Ce droit de suite s’exerce dès la première revente qui intervient à la cession initiale de l’œuvre originale par l’artiste, sous réserve que cette vente fasse intervenir un professionnel du marché de l’art. Les ventes entre particuliers sans intervention d’un professionnel du marché de l’art ne donnent donc pas lieu à l’application du droit de suite.
Le prélèvement du droit de suite sur le prix de revente s’applique dès lors que ce prix excède 750 euros. Le taux est dégressif, le montant étant plafonné à 12 500 euros.
Il est en outre utile de rappeler que le droit de suite est d’ordre public et que s’agissant d’un droit inaliénable, l’auteur ne peut ni le céder ni y renoncer.
Ainsi, l’application de ce droit tel que prévu par l’article L. 122-8 du CPI devrait a priori trouver à s’appliquer en cas de revente d’un NFT associé à une création plastique sur support numérique par le biais d’une plateforme ou, comme cela semble désormais possible, par le biais d’une vente publique aux enchères.
L’application de ce droit devrait également être automatique dès lors que le NFT créé porte sur une œuvre plastique.
Mais que se passe-t-il si le smart contract en cause n’y fait pas référence ? Dans ce cas, le versement de ce droit ne sera pas automatiquement réalisé par l’inscription d’une nouvelle transaction portant sur la revente du NFT sur la blockchain concernée. Cependant, l’auteur bénéficiera de la transparence et de la traçabilité des transactions successives pour requérir l’application de ce droit.
-
Le droit percevoir des redevances sur les reventes successives aménagées contractuellement par les smart contracts
En matière de NFT, il est fait référence de manière récurrente à l’existence d’un « droit de suite » mis en place sur les plateformes de création et de vente de NFT, telles que Opensea, Rarible, Nifty Gateway, etc.
Les redevances NFT correspondent à une commission, exprimée en pourcentage, que perçoit le créateur d’un jeton non fongible (NFT) à chaque revente de son œuvre sur le marché secondaire. Ce mécanisme permet aux créateurs de contenu de générer un revenu passif durable au-delà de la vente initiale de leur création originale. Lors de la première vente, le créateur reçoit l’intégralité du prix de l’œuvre. Au moment de la création et de la mise en vente du NFT, il définit à l’avance le taux de redevance applicable aux ventes ultérieures, généralement compris entre 5 % et 10 %. (8)
Or, comme nous l’avons vu précédemment, un NFT peut porter sur d’autres « objets de droit » que sur des œuvres au sens du Code de la propriété intellectuelle.
Ainsi, l’usage de la notion de « droit de suite » pour en réalité faire état d’un droit aménagé contractuellement prête à confusion. En effet, il s’agit là d’un droit purement contractuel de percevoir des redevances sur les reventes successives. Ce droit est prévu au smart contract à l’origine du NFT et ce, peu important que le NFT porte sur une œuvre, sur un dessin et modèle, sur un produit marqué ou sur tout autre objet/élément non couvert par un droit de propriété intellectuelle.
L’avantage de la technologie blockchain est qu’elle permet d’assurer une traçabilité de ces reventes successives du NFT et d’assurer une forme d’automaticité du reversement de ces redevances au titulaire des droits (au sens contractuel du terme).
Mais cette prérogative contractuelle est bien différente du droit de suite de l’article L. 122-8 du CPI dont l’application est légalement limitée.
Peut-on alors imaginer que les auteurs d’œuvres plastiques sur support numérique seraient en droit de réclamer le cumul du droit de suite légal prévu par l’article L. 122-8 du CPI avec le « droit de suite contractuel » prévu dans le smart contract si rien n’est spécifié ? La jurisprudence aura sans nul doute l’occasion de trancher cette question, mais, selon nous, rien ne s’y opposerait à notre sens.
B. La revente du NFT donne-t-elle prise à un droit de distribution ou de communication au public ?
La revente d’un NFT portant sur une œuvre protégée par le droit d’auteur relève-t-il du droit de distribution ou du droit de communication au public ?
Cette question est importante pour déterminer si le propriétaire acquéreur d’un NFT est libre d’en assurer la revente ou s’il devrait plutôt prendre la précaution de requérir l’autorisation préalable du titulaire des droits d’auteur.
Dans le monde corporel, la règle de l’épuisement du droit de distribution (art. L. 122-3-1 du CPI) veut que le titulaire de droits de propriété intellectuelle perde toute possibilité d’invoquer lesdits droits pour s’opposer à la libre circulation d’un exemplaire de son œuvre (livre, CD, DVD, poster, etc.) dès lors que le bien en cause a été commercialisé et mis sur le marché par le titulaire du droit ou avec son consentement au sein de l’Espace économique Européen.(9)
-
La question s’est posée de savoir si cette règle pouvait être librement transposée au monde numérique
Dans l’arrêt Usedsoft,(10) la CJUE a répondu à la question de savoir si l’utilisateur d’un logiciel pouvait librement revendre la copie de la licence qu’il a acquise licitement, à d’autres utilisateurs. La Cour, par une décision très critiquée par la doctrine française, a répondu par l’affirmative. Elle a considéré que l’éditeur de logiciels n’est plus en mesure de s’opposer à la revente de la copie de ses logiciels, ses droits d’auteurs susceptibles d’y faire obstacle, devant être considérés comme épuisés par la première mise à disposition de la copie. Cette décision était rendue sur le fondement de la Directive 2009/24/CE concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur.
Dans l’arrêt Tom Kabinet, (11)la CJUE a cette fois adopté une position différente concernant la revente d’occasion d’ebooks dématérialisés en considérant que la notion de droit de distribution ne s’appliquait qu’aux objets tangibles et relevait du droit de « communication au public » prévu par la directive 2001/29/CE.
Cette solution se fonde sur le fait que dans l’univers numérique, les fichiers contenant l’œuvre se transmettent par le biais d’une reproduction et que les copies numériques dématérialisées, à l’inverse des livres sur un support matériel, ne se détériorent pas avec l’usage de sorte que les copies d’occasion constituent des substituts parfaits des copies neuves. Ainsi, le détenteur du fichier incluant une œuvre peut en revendre une parfaite copie sans pour autant se dessaisir de son propre fichier initial.
Dans cet arrêt, la CJUE a pris le soin de préciser qu’il ne s’agit pas d’un revirement par rapport à l’arrêt UsedSoft, mais que les deux directives en cause aboutissent en réalité à des solutions distinctes. Ainsi, seuls les biens dématérialisés entrant dans le champ d’application de la directive sur les programmes d’ordinateur sont susceptibles d’épuisement.
-
Concernant les NFT, la question n’est pas simple à trancher pour deux raisons
Tout d’abord, car certains NFT sont associés à la fois à une œuvre numérique, mais également à un bien corporel. Par exemple, le groupe de rock Kings of Leon a lancé la commercialisation de NFT permettant d’accéder à la fois à l’écoute de son dernier album, mais aussi de bénéficier de places de concert. Or, il ne fait aucun doute qu’une place de concert une fois acquise peut librement être revendue, car relevant de la qualification d’objet tangible.
Ensuite, s’agissant des NFT portant uniquement sur une œuvre numérique, l’importante nouveauté apportée par cette technologie est que le NFT permet de garantir l’authenticité et l’unicité de l’œuvre numérique à laquelle il renvoie via une URL (l’œuvre étant stockée hors chaîne sur un serveur ou via un stockage décentralisé de type IPFS). Ainsi, à la différence de la copie numérique classique d’une œuvre que tout à chacun pouvait aisément réaliser sans qu’il ne soit ensuite possible techniquement de distinguer la copie de l’original, le NFT permet de garantir cette unicité du fichier numérique.
On pourrait donc vraisemblablement considérer que la vente d’un NFT, par les garanties qu’apporte la technologie blockchain, est assimilable à la vente d’un exemplaire matériel dans la mesure où il s’agit de la vente d’un jeton unique non fongible, lequel donne lieu à une dépossession du créateur du NFT tant du jeton en lui-même que du support fichier de l’œuvre numérique dont l’authenticité est traçable.
Cependant, le doute est permis sur l’appréciation qu’en fera la jurisprudence au regard de ce qui avait été retenu dans l’arrêt Tom Kabinet, la Cour considérant que « l’intention à la base de la proposition de directive 2001/29/CE était de faire en sorte que toute communication au public d’une œuvre, autre que la distribution de copies physiques de celle-ci, relève non pas de la notion de « distribution au public », visée à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29, mais de celle de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive ».
Pour lire une version plus complète de cet article sur les NFT et la propriété intellectuelle, cliquez
Sources :
- Article R122-3 – Code de la propriété intellectuelle – Légifrance
- Aurore SAUVIAT (Avocate IP, Digital & Data DPO Certifiée IAPP)
- Rapport d’information sur les chaînes de blocs
- NFT ou jetons non fongibles, qu’est-ce que c’est? | AMF
- Us/technology | The Guardian
- Article L122-8 – Code de la propriété intellectuelle – Légifrance
- Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 4 …
- Redevances NFT : qu’est-ce qu’elles sont et comment … – Binance
- Article L122-3-1 – Code de la propriété intellectuelle – Légifrance
- C‑128/11- UsedSoft – CURIA – 3 juillet 2012
- C-233/23 – Tom Kabinet- CURIA – 19 décembre 2019