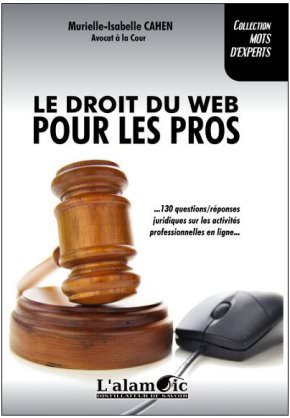11 Mar 2024
Diffamation sur une page Facebook et sur twitter : qui est l’auteur principal ?
Comme chacun le sait, les réseaux sociaux sont le théâtre de vifs échanges fondés sur la liberté d’expression. Cette liberté de communication n’est cependant pas absolue et le délit de diffamation peut être retenu à l’encontre d’un utilisateur. Cependant, il est parfois difficile de déterminer qui est l’utilisateur, auteur des propos diffamatoires.
Il est alors intéressant de revenir sur le régime de responsabilité applicable au délit de diffamation sur une page Facebook ou sur un compte Twitter et plus particulièrement à la détermination du responsable.
L’émergence des réseaux sociaux a en effet permis à chacun de se saisir de l’actualité et d’exprimer son point de vue de manière directe. Mais cette nouvelle voie d’expression dénuée d’intermédiation peut également favoriser des propos qualifiables de diffamatoires.
Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?
Téléphonez – nous au : 01 43 37 75 63
ou contactez – nous en cliquant sur le lien
Les victimes de propos diffamatoires sur une page Facebook ou sur un compte Twitter ne sont pas démunies face à cette situation et la loi permet de réagir face à ces comportements délictueux.
Ainsi, en se fondant sur la loi de 1881 (loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) réprimant les propos diffamatoires (I), la loi de 1982 (loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle) et la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) prévoient un régime de responsabilité en cascade (II) fondé sur la détermination de l’auteur principal.
I – APPLICABILITÉ DE LA LOI DE 1881 POUR DES PROPOS TENUS SUR UNE PAGE FACEBOOK OU UN COMPTE TWITTER
A – L’APPLICABILITÉ DE LA LOI DE 1881
Lors de l’émergence d’Internet, s’est posée la question du régime de responsabilité applicable à des propos répréhensibles. En effet, face à l’augmentation du nombre de connexions et d’échange de messages via l’Internet, un nombre croissant de contentieux est apparu. La solution est venue de la loi du 29 juillet 1982 (loi n° 82652) dite loi sur la communication audiovisuelle (Cour de cassation – Chambre criminelle 16 octobre 2018 in fine).
Par cette loi, le législateur de l’époque crée un régime de responsabilité spécial, directement fondé sur la loi du 29 juillet 1881 et notamment son article 29 qui consacre la diffamation. Ce renvoi permet d’écarter le fondement classique de la responsabilité civile fondé sur l’article 1240 du Code civil (anciennement 1382 du Code civil) qui prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Cette responsabilité spéciale permet une meilleure adaptation des recours face aux réalités de l’Internet, notamment sur les difficultés probatoires que peuvent rencontrer les victimes.
L’article 1240 du Code civil requiert en effet classiquement trois critères pour retenir la responsabilité d’une personne : une faute, un lien de causalité et un dommage. Par cette loi, le législateur reconnaît donc la spécificité des cas de responsabilités sur l’Internet.
L’assimilation faite en 1982 pour l’Internet à la loi de 1881 sur la liberté de la presse vaut aujourd’hui pour les réseaux sociaux. C’est ce que prévoit la loi de 2004 dite LCEN (Tribunal correctionnel Pau, 12 nov. 2018). La loi de 1881 réprimant les propos diffamatoires par voie de presse est donc applicable aux messages postés sur une page Facebook ou un compte Twitter (Cour d’appel de de Paris – 17 déc. 2014 n° 12/20 756).
La Cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 16 janvier 2024, a rappelé l’article 29 de la loi de 1881 et le fait que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de 1240 du Code civil, l’objectif étant d’interdire aux parties de contourner, en se fondant sur le droit commun, les dispositions protectrices de la liberté d’information et d’expression de la loi de 1881.
En l’espèce, il est constant que les appelants fondent leur action sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil. Par conséquent, la cour estime que c’est donc justement que le premier juge, retenant que les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil ne permettaient pas de sanctionner les abus à la liberté d’expression, a débouté les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes
B – LE DÉLIT DE DIFFAMATION DANS LA LOI DE 1881
La loi du 29 juillet 1881, dispositif cardinal de la liberté d’expression dans le corpus juridique français prévoit en son article 29 un délit : la diffamation.
Cet article dispose : « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ».
La diffamation requiert donc la réunion de cinq éléments : une allégation ou imputation, un fait déterminé, une atteinte à l’honneur ou à la considération, une personne ou un corps identifié, une publicité des propos.
Un arrêt du 26 février 2020 rendu par la Cour d’appel de Paris (Cour d’appel de Paris, 26 févr. 2020, 10/2020) précise cette notion de diffamation : « la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, а savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent ».
La publicité est le caractère le plus discuté en matière de diffamation, la Cour de cassation procédant à une différence d’analyse entre les pages publiques et privées. Plusieurs affaires concernant des insultes proférées par des salariés à propos de leurs employeurs ont en effet été rejetées par la Cour.
La haute juridiction a plusieurs fois procédé à une analyse du nombre d’amis de l’intéressé : si ce nombre dépasse celui du cercle d’amis restreint, alors le message litigieux pourra être considéré comme étant public (Civ. 1re, 10 avr. 2013, n° 11–19.530). À l’inverse, si le nombre d’amis demeure comparable à un cercle d’amis restreint, le caractère public n’est pas retenu et l’auteur pourra être exonéré. Dans le cas de Twitter, l’analyse diffère : pour les comptes privés, les juges pourront procéder à une évaluation du nombre de personnes suivant le compte. Pour le cas des comptes publics, la publicité est présumée (Cass. Crim, 11 décembre 2018, 17-85.159, Inédit)
La question du caractère public ou non d’un message Facebook peut s’avérer épineuse. La Cour de cassation semble s’attacher à un autre critère : celui de la communauté d’intérêts. Elle a ainsi pu retenir le caractère public d’un message publié au sein d’un groupe partageant une « communauté d’intérêts » (Civ. 1re, 10 avr. 2013, n° 11-19.530).
Dans le cas d’une page Facebook, la question est différente puisque le caractère public est plus aisé à caractériser : n’importe quel utilisateur peut avoir accès à cette page (CAA Nantes, 21 janv. 2016, n° 14NT02263).
S’ajoute à ces éléments dits « matériels » de l’infraction, un élément moral : l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un corps déterminé. Ce deuxième élément est le plus souvent présumé. C’est ce que juge la Cour de cassation dans un arrêt du 19 juin 2012 : (Cour de cassation, chambre criminelle, 19 juin 2012, n° 11-84.235) : « les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger а toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos ».
II – UN RÉGIME DE RESPONSABILITÉ EN CASCADE
A – LA RESPONSABILITÉ EN CASCADE : DÉTERMINATION DE L’AUTEUR PRINCIPAL
Déterminer qui est le responsable d’un acte de diffamation peut s’avérer complexe, surtout lorsque l’acte a été commis par l’intermédiaire d’un ordinateur.
Conscient de cette problématique, le législateur a instauré un système de responsabilité en cascade, permettant dans la plupart des cas, de déterminer un responsable. Ainsi, l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 prévoit que « l’auteur, et à défaut de l’auteur, le producteur seront poursuivis comme auteur principal ».
Appliqué à une page Facebook ou à un compte Twitter et à défaut d’auteur identifiable, il s’agira du producteur. Producteur au sens de celui « ayant pris l’initiative de créer un service de communication au public » (Cass. crim., 16 févr. 2010 n°09-81.064) c’est-à-dire la personne physique qui fournit le service. Sachant que la jurisprudence considère que « le titulaire d’un compte Facebook en est en conséquence le directeur de la publication » (Tribunal correctionnel de Pau, 12 nov. 2018). Cela vaut aussi pour un compte Twitter dont l’auteur n’est pas identifiable.
Cependant, le créateur ou animateur d’un site de communication au public, en tant que producteur, pourra se voir exonérer de toute responsabilité vis-à-vis du contenu du message adressé par un utilisateur s’il n’avait pas connaissance du message avant sa mise en ligne (Conseil constitutionnel, 16 sept. 2011, n° 2011-164 QPC). Pour une page Facebook.
Dans un arrêt rendu le 13 novembre 2020 par la Cour Administrative d’Appel de Paris (4e chambre de l’instruction), la personne mise en cause, animatrice d’une page Facebook contestait sa responsabilité, arguant que l’ordinateur utilisé pour administrer sa page se trouvait dans un lieu accessible au public et que plusieurs personnes pouvaient de fait, y avoir eu accès, sans son contrôle (la personne ne s’étant pas déconnectée de son compte personnel).
Elle cherchait ainsi à s’exonérer de sa responsabilité. La Cour a cependant refusé ce raisonnement en se fondant sur le fait qu’elle ne pouvait nier sa responsabilité. Le message litigieux provenant de son compte personnel et non d’un compte tiers : l’auteur avait utilisé les codes d’accès de l’administrateur de la page, sans que cette dernière ne puisse démontrer qui était cette personne. L’administrateur a donc était désigné comme responsable.
Ainsi, peut-être retenu comme auteur principal et donc responsable au sens de la loi du 29 juillet 1881, l’auteur du texte litigieux et à défaut l’administrateur de la page Facebook ou du compte Twitter (pour Facebook : Cour de cassation – Chambre criminelle, 1 septembre 2020, n° 19-84.505 – pour Twitter : Cour de cassation – Chambre criminelle, 10 mai 2017, 16.81-555)
Dans le cas précis de Twitter, il faut noter une spécificité : les membres apparaissent souvent sous pseudonyme, rendant l’exercice d’identification encore plus complexe (Cass. Crim. 8 janv. 2019). Afin de lutter plus efficacement contre les agissements de personnes non identifiables, la loi pour la confiance dans l’économie (loi du 21 juin 2004, précitée) a mis en place un régime de responsabilité spécifique. Ainsi, les hébergeurs ont l’obligation de supprimer les tweets illicites qui leur ont été signalés. Et ceux dans les plus brefs délais.
Dans un arrêt du 16 février 2023, la Cour d’appel de Versailles a établi que que la demande formulée par l’appelant n’a pas pour objet l’engagement de la responsabilité des sociétés Google Ireland Limited et Google LLC sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, aucune des infractions de presse prévues par ce texte ne leur étant reprochée et aucune des qualités mentionnées ne pouvant leur être appliquées, seul demeure au débat à hauteur de la cour, le respect de leurs obligations en matière de traitement de données personnelles. Par conséquent, la cour considère que la fin de non-recevoir tirée de ce moyen sera rejetée.
B – LE RÉGIME D’EXONÉRATION
Il existe en finalité peu de cas d’exonération de responsabilité pour des propos diffamatoires sur une page Facebook ou un compte Twitter. Le principal cas pour l’auteur n’en est pas réellement un : cela recouvre la situation dans laquelle il n’est pas identifiable. Un autre cas d’exonération pour l’auteur peut être celui d’arguer la non-publicité de la diffamation ou le manque d’un critère constitutif de la diffamation. Mais encore une fois ce il ne s’agit pas d’un réel cas d’exonération.
Pour l’administrateur, l’exonération peut venir de la démonstration que les propos diffamatoires publiés sur sa page n’avaient pas été portés à sa connaissance avant publication. Dans le cas où son identité a été usurpée et qu’un usage malveillant de son compte Facebook ou Twitter a été perpétré, l’administrateur pourra se voir exonérer de toute responsabilité pour des propos diffamatoires. Il devra pour cela rapporter la preuve de l’usurpation (en lien : Tribunal correctionnel de Paris 18 avril 2019).
Tel ne fut pas le cas dans l’affaire précitée du 13 novembre 2020 (Cour Administrative d’Appel de Paris, 4e chambre de l’instruction).
Dans le cas où une personne publie un message à caractère diffamatoire sur une page Facebook ou un compte Twitter qu’elle n’administre pas et si l’administrateur intervient promptement pour supprimer le commentaire, alors sa responsabilité pourra être écartée. C’est le même mécanisme que celui prévu par la LCEN (Loi sur la Confiance dans l’Économie Numérique du 21 juin 2004), pour les hébergeurs.
En somme, la responsabilité en cascade prévue par la loi du 29 juillet 1982 réduit considérablement les cas d’exonérations pour des cas de diffamation.
Pour lire cet article sur la diffamation sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter en version plus détaillée, cliquez
SOURCES :
- Cour de cassation – Chambre criminelle 16 octobre 2018 / n° 17-87.418 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_2018-10-16_1787418
- Cour d’appel de Paris, 26 févr. 2020, 10/2020 :
- Cour d’appel de Paris – 17 déc. 2014 n° 12/20 756 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CA_PARIS_2014-12-17_1220756
- Cour de cassation, chambre criminelle, 19 juin 2012, n° 11-84.235 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_2012-06-19_1184235
- Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006070722/2021-01-07/
- Loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000880222/2021-01-07/
- Loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000801164/2021-01-07/
- Tribunal correctionnel Pau, 12 nov. 2018 : https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-pau-ch-corr-jugement-correctionnel-du-12-novembre-2018/
- 1re, 10 avr. 2013, n° 11-19.530 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027303638/
- crim., 16 févr. 2010 n°09-81.064 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022004533/
- Cour de cassation – Chambre criminelle, 1 septembre 2020, n° 19-84.505 : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/1168_1er_45221.html
- Cour de cassation – Chambre criminelle, 10 mai 2017, 16.81-555 :
- Cour Administrative d’Appel de Paris, 4e chambre de l’instruction 13 nov. 2020 : https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-4eme-ch-de-linstruction-arret-du-13-novembre-2020/
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2018, 17-85.159, Inédit : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037850944/
- Tribunal correctionnel de Paris 18 avril 2019
- Cour de cassation, Chambre criminelle 8 janv. 2019 : https://www.gazette-du-palais.fr/wp-content/uploads/2019/01/Cass.-crim_8-janv.-2019_n °-17-81 396.pdfCour d’appel de Pau, 1ère Chambre, 16 janvier 2024, n° 22/01614 : https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CAPAU-16012024-22_01614?em=Cour%20d%27appel%20de%20pau%2C%201%C3%A8re%20Chambre%2C%2016%20janvier%202024%2C%20%2022%2F01614
- Cour d’appel de Versailles, 14e chambre, 16 février 2023, n° 22/03558 : https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CAVERSAILLES-16022023-22_03558?em=Cour%20d%27appel%20de%20versailles%2C%2014e%20chambre%2C%2016%20f%C3%A9vrier%202023%2C%20%2022%2F03558