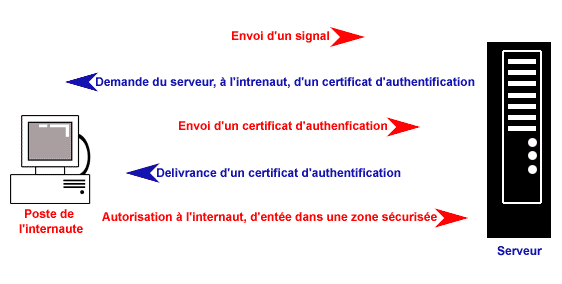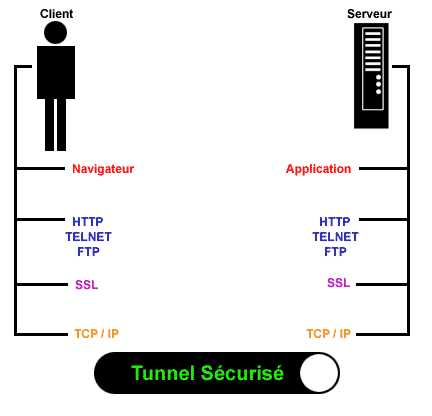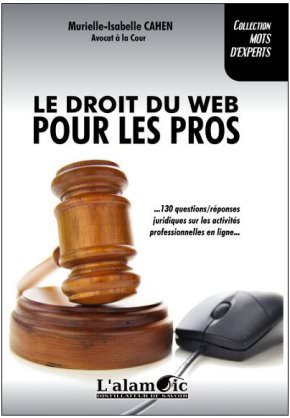11 Juin 2024
LA PROTECTION DU LOGICIEL PAR LE DROIT D’AUTEUR
11Le logiciel occupe aujourd’hui une place importante de l’économie numérique, en effet, celui-ci est embarqué dans de nombreuses machines, il est devenu indispensable. C’est pourquoi il est apparu nécessaire de savoir quelle protection était accordée au logiciel, or la réponse à cette question n’était pas évidente, puisque l’on pouvait hésiter entre une protection accordée via le droit des brevets, le droit d’auteur, ou encore créer un régime propre au logiciel. C’est finalement la protection par le droit d’auteur qui a été choisie.
Le Code de la propriété intellectuelle n’apporte pas de définition arrêtée en la matière, mais la Commission de terminologie française a apporté des précisions quand au terme de logiciel, dans des travaux publiés au journal officiel du 17 janvier 1982. Ainsi, le logiciel est un ensemble de programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation, relatif au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données.
Un logiciel est un produit actif qui se caractérise principalement par ses fonctionnalités, ou sa structure externe, alors qu’un programme informatique se caractérise par sa structure interne et peut ne consister qu’en un listing de données. La loi française est une des rares avoir opté pour le terme de « logiciel », alors que les législations étrangères (Royaume-Uni, Japon, Allemagne ou les États-Unis) ont préféré celui de « programme informatique ». La directive européenne, qui vise les programmes d’ordinateur, pose dans son préambule que le terme « programme d’ordinateur » comprend les travaux préparatoires de conception du logiciel aboutissant, ainsi, au développement d’un programme, à condition qu’ils soient de nature à permettre la réalisation d’un programme à un stade ultérieur.
Dans un arrêt en date du 6 octobre 2021, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 6 oct. 2021, no C-13/20), a précisé la possibilité pour un acquéreur de programme d’ordinateur d’effectuer une décompilation de tout ou partie de celui-ci pour corriger des erreurs affectant son fonctionnement, y compris dans la situation où la correction implique la désactivation d’une fonction perturbant le bon fonctionnement de l’application contenant le programme. (12)
On sait, par ailleurs, que le droit d’auteur recoupe l’ensemble des droits moraux et patrimoniaux dont dispose l’auteur d’une « œuvre de l’esprit » (de sa création, somme toute) sur celle-ci. Le Code de la propriété indique cette fois-ci, en son article L112-2, les œuvres encadrées par la protection accordée par le droit d’auteur, parmi lesquelles on compte les logiciels.
Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?
Téléphonez – nous au : 01 43 37 75 63
ou contactez – nous en cliquant sur le lien
En France, le logiciel est protégé par le droit d’auteur, même si le législateur hésitait entre la protection par le droit des brevets, une protection par le droit d’auteur, ou une protection par un droit intellectuel spécifique. En effet, le logiciel fait appel à plusieurs notions. D’abord, à des notions de brevets par son aspect technique, ensuite au droit d’auteur, en ce qu’il constitue une œuvre du langage. Même si le législateur a choisi le droit d’auteur pour assurer la protection du logiciel, celui-ci a été adapté au logiciel de façon à appréhender l’aspect technique de la notion de logiciel.
I / Le choix de la protection par le droit d’auteur
A / Les raisons de l’exclusion du droit des brevets
En France, le débat a été tranché dès 1968 avec l’adoption de la loi du 2 janvier 1968 qui expliquait le refus de l’application du droit des brevets au logiciel par son inaptitude à remplir le caractère industriel exigé pour les inventions brevetables.
En effet, pour qu’une invention soit brevetable, elle doit remplir plusieurs conditions cumulatives, à savoir : une invention nouvelle, une invention impliquant une activité inventive, une invention licite, et enfin, une invention susceptible d’application industrielle. En vertu de l’article L. 611-15 du code la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture.
Par ailleurs, le législateur a opté de ne pas choisir la protection par le droit des brevets pour des motifs économiques et techniques. Il craignait que les États Unis inondent le marché français de demande de brevet et qu’ils bloquent ainsi la recherche française. En somme, les praticiens auraient eu plus de difficulté à apprécier l’état de la technique antérieure en matière de logiciel.
Toutefois l’exclusion de brevetabilité n’est pas absolue. En effet l’article L 611-10 CPI n’exclut le logiciel de la brevetabilité « qu’en tant que tel ». Cela signifie que le logiciel ne peut pas être déposé que s’il est revendiqué en tant que tel, mais qu’il devient brevetable lorsqu’il est intégré à une invention plus globale.
Ainsi, bien qu’un algorithme ou un logiciel ne soit pas brevetable, en tant que tel, il le devient s’il constitue une étape importante dans un processus industriel et/ou dans le fonctionnement d’un système. Ce principe a été consacré, en matière de logiciel, dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris dans l’affaire « Schlumberger ».
La loi exclut donc de la brevetabilité les logiciels en tant que tels et non les machines ou les systèmes, dont une ou plusieurs étapes sont mises en œuvre par un logiciel, comme le précisent les directives de l’Office européen des brevets (OEB).
Enfin l’avantage de la protection par le droit d’auteur est que celle-ci est acquise sans aucune formalité de dépôt, contrairement au brevet qui implique un dépôt entraînant un certain coût, soit auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle, soit auprès de l’Office européen des brevets (OEB).
B / La notion de logiciel
Il faut se référer à la jurisprudence pour délimiter les contours de la notion de « logiciel ». Du point de vue technique le logiciel se définit comme un processus comprenant deux phases, à savoir une phase d’analyse et une phase de programmation. La phase de programmation consiste enfin à rédiger des instructions dans un langage informatique, ce qui se concrétise par le passage du code source au code objet, qui permet de passer à une version automatisable par l’ordinateur de la solution donnée.
On distingue le logiciel d’application du logiciel d’exploitation. Leur différence tient dans leur nature et leur fonctionnalité. En effet, le logiciel d’exploitation permet l’utilisation et organise le fonctionnement de la machine, tandis que le logiciel d’application ne sera qu’une fonctionnalité incluse dans l’ordinateur, sachant qu’il doit être compatible avec le logiciel d’exploitation et avec l’ordinateur sur lequel il sera installé.
II / L’adaptation du droit d’auteur au logiciel
A / Les éléments du logiciel protégeables par le droit d’auteur
Selon un célèbre adage attribué à Henri Debois, « les idées sont par essence et par destination de libre parcours ». Les idées doivent librement circuler dans nos esprits. L’exclusion de la protection des idées se justifie par la volonté de ne pas bloquer la création ni entraver la libre concurrence. Or certains éléments du logiciel sont assimilés aux idées (les algorithmes et les fonctionnalités du logiciel).
Toutefois, il convient de noter que la Cour de Justice de l’Union européenne a précisé, dans une décision, que « ne sont pas protégeables des fonctionnalités de logiciel (CJUE, SAS Institue c/ World Programming).
Un des éléments protégeables par le droit d’auteur est d’une part le matériel de conception préparatoire. L’article L 111-2 du CPI dispose en effet que la protection est accordée au logiciel y compris son matériel de conception préparatoire. Cela recouvre l’ensemble des travaux de conception aboutissant au développement d’un programme de nature à constituer un logiciel à un stade ultérieur. C’est dans ce concept de « matériel de conception préparatoire » que se situent les analyses fonctionnelles et organiques, qui sont donc protégées.
Le deuxième élément du logiciel protégé est son programme. Les programmes recouvrent le code source et le code objet du logiciel. Par programme source, on entend la liste des instructions qui composent le logiciel. Pour déterminer s’il y a contrefaçon d’un programme source, les experts le comparent avec celui du logiciel contrefaisant afin d’établir le nombre de lignes identiques des deux programmes.
Concernant le programme objet, la jurisprudence n’a jamais douté de l’application du droit d’auteur aux programmes objet, c’est-à-dire à l’enregistrement ou à la transcription en code binaire, sur bande, disque ou disquette magnétiques ou à l’intérieur d’une mémoire de type « ROM », du programme source d’un logiciel. Le droit d’auteur protège le œuvres quelle que soit leur forme, et la doctrine et la jurisprudence française ne voient dans le programme objet qu’une traduction du programme source en langage codé magnétiquement.
Le troisième élément protégé est la documentation d’utilisation. Le statut du cahier des charges, et des informations qu’il contient, est normalement réglés par les dispositions du contrat de développement de logiciel.
Dans un arrêt en date du 6 mars 2024, (Cass. com., 6 mars 2024, no 22-23657,) la chambre commerciale a précisé que lorsqu’un logiciel est mis à disposition par téléchargement accompagné de la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation permettant au client d’utiliser cette copie de manière permanente, en contrepartie d’un paiement, cela implique un transfert de la propriété de cette copie. (14)
Mais, même en l’absence de dispositions contractuelles, commets un acte de concurrence déloyale la SSII ou le constructeur qui utilise pour son compte un cahier des charges ou d’autres informations techniques qui lui ont été communiquées par un client dans le cadre de relations contractuelles. Cependant, le réalisateur demeure libre d’utiliser le « savoir-faire général » acquis par l’étude du cahier des charges, mais par prudence, il aura intérêt à le mentionner spécifiquement dans le contrat de commande.
Le quatrième élément du logiciel bénéficiant de la protection est la page-écran. Elle consiste en la manifestation graphique du logiciel, passant par des dessins, des icônes, etc.
Enfin, d’autres éléments du logiciel pouvant faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur sont : les interfaces techniques et fonctionnelles, le manuel d’utilisation et documents commerciaux, le titre des logiciels, etc.
B / Les droits moraux et patrimoniaux du créateur
Concernant les droits patrimoniaux, l’article L 122-6 du CPI prévoit trois prérogatives au bénéfice de l’auteur d’un logiciel, à savoir un droit de reproduction, de modification et de mise sur le marché.
La première prérogative, à savoir, le droit de reproduction permet à l’auteur d’avoir un monopole sur la fixation de l’œuvre sur tout support qui en permet la communication au public. Ce droit implique pour l’auteur du logiciel d’être protégé à la fois contre la reproduction permanente de son logiciel, mais aussi contre toute reproduction provisoire.
Le droit de modification permet quant à lui à l’auteur du logiciel de s’opposer à la traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre modification de son logiciel. Ces actes nécessitent en effet l’autorisation de l’auteur du logiciel, sous peine d’être déclarés contrefacteur.
Enfin le droit de mise sur le marché est totalement étranger au droit d’auteur classique. Cela signifie que l’auteur dispose du droit de mettre son logiciel sur le marché à titre onéreux ou gratuit. Il existe toutefois une limite à ce droit dans la mesure où la première vente d’un logiciel dans un État membre de la communauté européenne, par l’auteur ou avec son consentement, épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les États membres. Le logiciel étant considéré comme une marchandise, il est logique qu’on lui applique le principe communautaire de libre circulation des marchandises.
La location reste cependant réservée à l’auteur même lorsqu’il y a eu une première vente dans un État membre.
Concernant les droits moraux, là aussi le droit d’auteur s’est adapté au logiciel notamment en paralysant certaines attributions qui font en principe partie des attributions de l’auteur au titre de ses droits moraux. La finalité de la limitation est d’éviter un exercice débridé de ces droits, notamment parce qu’ils sont perpétuels alors que les droits patrimoniaux courent jusqu’à 70 ans après la mort de l’auteur, puisse nuire à la commercialisation des logiciels.
L’auteur du logiciel conserve le droit de divulgation et le droit à la paternité de l’œuvre. Selon un arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai, « le droit moral du programmeur, par interprétation a contrario de l’article L. 127-7 du CPI, se réduit en matière de logiciel au droit au nom . ». Cela sous-entend qu’il suffit que le nom de l’auteur soit crédité sur l’écran de l’ordinateur lors de la mise en route du logiciel, pour que son droit au respect soit respecté. Le nom de l’auteur doit donc être mentionné.
Concernant le droit au respect de son œuvre, il est limité dans la mesure où un auteur ne peut pas s’opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits patrimoniaux si elle n’est pas préjudiciable à son honneur ou à sa réputation. Ce droit consiste pour l’auteur à pouvoir s’opposer à une dénaturation de son œuvre. En droit d’auteur classique, il n’est pas nécessaire de prouver une atteinte à son honneur ou à sa réputation pour pouvoir invoquer son droit au respect de l’œuvre.
Enfin le droit de retrait, ou droit de repentir, est totalement paralysé en matière de logiciel. Ce droit consiste au fait que l’auteur peut en principe à tout moment décider d’arrêter la divulgation de son œuvre.
III / Protection des logiciels autres que par le droit d’auteur
A – Protection par le droit des dessins et modèles
Un logiciel peut bénéficier de la protection par le droit des dessins et modèles, dans son aspect télévisuel si l’on suit la logique du Livre V du CPI (an. L. 14 juill. 1909). Toutefois, sont exclus de la protection accordée par le Livre V les dessins dont la forme est inséparable de leur fonction par leur fonction. Enfin, ne sont protégés que les dessins « nouveaux » : ainsi, la protection de la loi a été refusée à un jeu vidéo ayant le même aspect télévisuel que des jeux existants antérieurement.
B – Protection des logiciels par le droit des marques
La marque fait l’objet d’une protection autonome qui élargit l’arsenal juridique à la disposition des créateurs de logiciels. Par exemple : en cas de piratage par des distributeurs, il y aura également contrefaçon de marque. Mais le dépôt de la marque ne confère que des droits sur celle-ci et non sur le logiciel lui-même.
C – Protection des logiciels par le droit pénal
L’appropriation frauduleuse d’un logiciel est susceptible de tomber sous le coup d’une large variété de lois pénales (vol, abus de confiance, corruption active ou passive d’employé, violation de secret professionnel, divulgation de secret de fabrique). D’ailleurs, il a déjà été jugé que constituait :
« Le délit de vol prévu par le Code pénal la copie d’un logiciel spécifique par un employé à l’insu de son employeur. »
Dans un arrêt en date du 9 mars 2021, (Cass. crim., 9 mars 2021, no 20-90034) la chambre criminelle a considéré qu’était dénuée de caractère sérieux la question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité de l’article L335-3 alinéa 2 du CPI au principe de légalité des délits et des peines. Cet article dispose : « Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit. » (15)
IV / Sanctions de la contrefaçon de logiciels
L’alinéa 1er de l’article 6 de la directive européenne sur la protection juridique des programmes d’ordinateur dispose que : « Le fait d’importer, de posséder ou de prendre en charge une copie illicite d’un programme d’ordinateur en sachant ou en ayant de bonnes raisons de croire qu’il s’agit effectivement d’une copie illicite constitue une infraction aux droits exclusifs de l’auteur sur ce programme. »
En matière pénale, la contrefaçon est punie par l’article L. 335-2 du CPI qui, depuis la loi du 29 octobre 2007, prévoit une peine d’emprisonnement de trois ans et 300 000 euros d’amende.
En matière civile, le contrefacteur peut être condamné non seulement à la confiscation des logiciels contrefaits, à celui du matériel utilisé pour la contrefaçon, à la publication du jugement dans diverses revues professionnelles, mais surtout au paiement de dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice subi.
L’attribution de dommages et intérêts est généralement effectuée d’une manière stricte, sur le fondement du gain manqué ou de la perte du chiffre d’affaires, compte tenu des éléments commerciaux fournis par le demandeur.
Dans un arrêt en date du 8 décembre 2023 (CA Paris, P. 5, ch. 2, 8 déc. 2023, no 21/19696), la cour d’appel de Paris a précisé que l’éditeur d’un logiciel peut agir en contrefaçon contre son cocontractant pour bénéficier des garanties de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 tenant à l’évaluation des dommages et intérêts et à la saisie réelle des marchandises prétendument contrefaisantes. (13)
Pour lire une version plus complète de cet article sur la contrefaçon de logiciel, cliquez
Sources :
- Le Stanc, « Exclusions de brevetabilité règles relatives au logiciel » J.-cl. brevets, fasc. 155 J.-P. Martin, « La < protection > des < logiciels > informatiques : droit d’auteur ou brevet d’invention ?
- CA Paris, 4e ch., 15 juin 1981
- 3 juin 1986, no 84-16.97
- CA Douai, 1re ch., 1er juill. 1996, PIBD 1993, III, 129 qui alloue l’équivalent de 3 000 euros pour l’atteinte portée au droit au nom de l’auteur.
- corr. Nanterre, 15e ch., Coreland c/ Fama
- TGI Paris, 3e ch., 9 mars 1984
- CA Versailles, 3e ch., 21 avr. 1989, Rigoult c/ Verveer, Juris-data no 43864
- -L. Goutal, « La < protection > pénale des < logiciels > », Exp. 1986, no 80, p. 2
- TGI Montbéliard, 26 mai 1978, Peugeot c/ X, Exp. 1978.
- TGI Paris, 31e ch., 19 mars 1990 GST c/ E., Cah. dr. Auteur 1990
- TGI Paris, 3e ch., 13 févr. 1989, Sisro c/ Ampersand, Exp. 1989.
- CJUE, 6 oct. 2021, noC-13/20 https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=C-13/20
- CA Paris, P. 5, ch. 2, 8 déc. 2023, no21/19696 https://www.courdecassation.fr/decision/657412aed0916383187adcd2?search_api_fulltext=21/19696&op=Rechercher&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=all&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=1
- com., 6 mars 2024, no22-23657, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049261474?init=true&page=1&query=22-23.657&searchField=ALL&tab_selection=all
- crim., 9 mars 2021, no20-90034 https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20210309-2090034