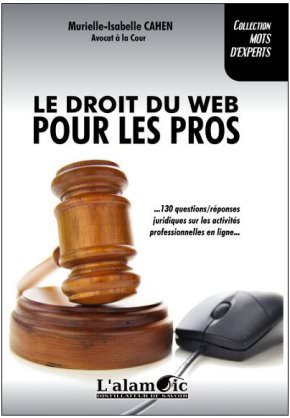23 Mai 2022
LE DROIT A L’IMAGE DES MORTS
L’article 9 du Code civil confère à toute personne le droit au respect de sa vie privée, de ce principe découle le droit à l’image. Ce dernier est un droit appartenant aux personnes vivantes. En effet, la mort entraîne la fin de la personnalité juridique. Le Droit à l’image est un droit de la personnalité qui s’éteint avec la mort et qui est intransmissible. Cependant, la question du droit à l’image fait tout de même débat.
Avec le développement des nouvelles technologies, les droits de la personnalité tels que le droit à l’image et à la vie privée sont souvent violés. Les réseaux sociaux, le déploiement de caméras, l’écoute ou la surveillance par les employeurs peuvent bafouer ces droits. Le droit à l’image est mis à rude épreuve constamment sur la toile.
Qu’en est-il lorsque l’image est celle d’une personne qui n’est plus ? Les enjeux qui découlent de cette question sont multiples et méritent par conséquent d’être au cœur d’une réflexion.
Le droit à l’image est une construction jurisprudentielle découlant de l’article 9 du Code civil portant sur le droit au respect de la vie privée. C’est suite à la parution de la photographie d’une actrice décédée dans un journal en 1858 que la question s’est posé du droit à l’image des morts. Les juges s’étaient alors fondés sur le droit à l’image pour condamner la reproduction de la photographie. En estimant notamment que le consentement formel de la famille était nécessaire à cette reproduction.
Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?
Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63
ou contactez-nous en cliquant sur le lien
Depuis cette première affaire, de nombreux jugements ont été rendus concernant le droit à l’image des morts. Les juridictions s’accordent sur le fait que les droits de la personnalité s’éteignent avec la mort de la personne. Cependant, la question est toujours d’actualité. En effet, nombreuses sont les exceptions. Parmi ces exceptions on retrouve notamment : la dignité de l’être humain, le droit pénal imposant le consentement de la personne pour diffuser la photographie.
En réalité, la seule exception qui tend à s’appliquer est celle de la dignité humaine, en effet, le décès de la personne éteint les droits de la personnalité, par conséquent, on ne peut obtenir de consentement. Les droits patrimoniaux sont transmissibles tandis que les droits de la personnalité cessent avec la mort de la personne.
Ainsi, on peut se demander par quels moyens est-il possible de se protéger malgré tout, des diffusions indésirables de l’image d’une personne après sa mort ?
Tout d’abord, il convient de rappeler que peu importe le moment ou une photographie a été prise, la mort de la personne entraîne l’extinction du droit à l’image (I). Néanmoins, la diffusion de la photographie peut causer un préjudice moral, celui-ci ne s’éteint pas avec la mort de la personne, en effet, l’image est figée. (II)
I – L’extinction du droit à l’image
Le droit à l’image répond au régime plus général des droits de la personnalité. Il n’y a pas d’ambiguïté quant à l’application de ce régime au droit à l’image, alors même que les droits de la personnalité (A) regroupent plusieurs droits spécifiques qui s’éteignent avec le décès des personnes lésées dans ces droits (B).
A – Les droits de la personnalité
Les droits de la personnalité sont des constructions prétoriennes. Ils découlent pour de l’article 9 du Code civil. On retrouve parmi ces droits, le droit au respect de la vie privée et le droit à l’image. Dans les droits de la personnalité, nous retrouvons également le droit moral de l’auteur, cependant celui-ci bénéficie d’un régime particulier.
Pour la doctrine, ces droits ont pour objectif la protection de l’intégrité physique et morale. Il est intéressant de se concentrer sur l’intégrité morale de la personne. En effet, l’intégrité physique demeure même après la mort de l’auteur. Concernant l’intégrité morale, la question est plus épineuse.
Par principe, les droits de la personnalité sont des droits extrapatrimoniaux inhérents à la personne et inaliénables, ces droits ne sont pas transmissibles. Par conséquent, ils s’éteignent avec le défunt.
L’exemple du droit d’auteur est quant à lui particulier. Le droit d’auteur regroupe des droits patrimoniaux et moraux. Concernant la première catégorie, regroupant le droit de représentation et le droit de suite, elle comprend des droits qui sont cessibles et transmissibles et qui perdurent 70 ans après la mort de l’auteur.
La seconde catégorie prévue à l’article L.121-1 du Code de propriété intellectuelle., regroupe le droit de paternité, le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre, le droit de retrait ainsi que le droit de divulgation. Ces droits sont incessibles, mais sont cependant transmissibles pour cause de mort aux héritiers. Les Droits moraux sont perpétuels et inaliénables. Néanmoins, le droit retrait étant intimement lié à la personne de l’auteur, il cesse avec sa mort.
Par conséquent, les droits de la personnalité, étant directement liés à la personne, doivent s’éteindre avec la personne. Néanmoins, cela peut causer de nombreux problèmes, notamment sur la pérennité de la protection comme c’est le cas avec le droit à l’image.
B – L’extinction des droits de la personnalité
L’article 16-1-1 du Code civil prévoit que le « respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort ».
Ainsi certains droits liés à l’intégrité physique peuvent être invoqués après la mort d’une personne, en effet la protection ne cesse pas avec son décès. Néanmoins, ce n’est pas le cas avec l’intégrité morale.
En effet, les droits en lien avec l’intégrité morale de la personne ne peuvent perdurer après la mort du titulaire de ces droits. À titre d’exemple, la présomption d’innocence n’est pas transmissible et s’éteint avec le décès de la personne, car il n’est pas possible de poursuivre pénalement une personne décédée.
Pour le droit à l’image, c’est similaire. Dans un arrêt rendu le 14 décembre 1999, la Cour de cassation a énoncé que ce droit s’éteint de plein droit avec le décès de la personne à qui appartient ce droit, ce qui rend impossible tout recours de la part des héritiers sur le droit à l’image de la personne décédée.
Position réaffirmée récemment par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 31 janvier 2018 (1). L’image de l’artiste du défunt artiste Henri Salvador avait fait l’objet d’une utilisation commerciale. Son ancienne épouse avait donc formé un recours en se basant sur le droit à l’image. La Cour de cassation vient rappeler que le droit à l’image est un droit extrapatrimonial et non patrimonial et que par conséquent, il ne se transmet pas aux héritiers, car il s’éteint avec le décès du titulaire de ce droit.
Néanmoins, il est tout de même possible pour les héritiers de pouvoir agir pour protéger la diffusion de l’image de la personne décédée si celle-ci leur cause un préjudice moral personnel.
II – Une protection sur le fondement du préjudice moral
Le juge permet tout de même à la famille dans certains cas de pouvoir agir, il permet à cette dernière d’agir sur le fondement du préjudice moral. (A) Cette solution, après avoir été dégagée par la Cour de cassation a été suivie par le Conseil d’État (B)
A – L’image des morts protégées par la responsabilité civile
La Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 octobre 2009 (2), à refuser d’appliquer l’article 9 du Code civil en précisant que le droit à l’image s’éteint avec le décès de la personne qui en est titulaire. Un des enfants d’un auteur décédé avait poursuivi un éditeur et un auteur sur le fondement du droit à l’image, car ces derniers avaient publié un livre retraçant la vie de leur père.
La Cour de cassation a donc appliqué sa jurisprudence et rejeté la demande. Néanmoins, la Cour de cassation est venue offrir une nouvelle voie pour les héritiers. En effet, elle consacre la possibilité de venir rechercher la responsabilité des personnes à l’origine de la publication sur le fondement du préjudice moral. Comme énoncé à l’article 1382 (ancien, actuel 1240) du Code civil « « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La Cour énonce que « les proches d’une personne décédée ne peuvent contester la reproduction de son image qu’à la condition d’établir le préjudice personnel qu’ils en éprouvent, déduit le cas échéant d’une atteinte à la mémoire du mort ou au respect qui lui est dû ».
Ainsi, pour pouvoir obtenir une réparation, il faut donc se baser sur le terrain de la responsabilité civile. Il est donc nécessaire que la diffusion de la photographie de la personne décédée cause un préjudice moral aux personnes qui en font la demande.
L’atteinte à la mémoire ou la dignité du corps humain peuvent donc par ricochet causer un préjudice personnel aux proches de la personne décédée, leur permettant d’agir sur le fondement de la responsabilité civile. Néanmoins, il convient de rappeler que dans certains cas, la dignité du corps humain peut être écartée en raison du droit d’information.
Le raisonnement n’est pas dénué de sens, à tel point que le Conseil d’État a repris le raisonnement à son compte en se reconnaissant compétent lors d’une espèce similaire et en faisant application du Code civil.
B – L’application directe des dispositions du Code civil par le juge administratif
Le juge administratif a eu l’occasion de s’exprimer sur ce sujet dans un arrêt rendu le 27 avril 2011. (3) En l’espèce, un entretien entre un psychanalyste et une artiste avait été enregistré et filmé. Cet entretien avait été diffusé lors d’une exposition après le décès du psychanalyste. Les enfants de ce dernier ont formé un recours de plein contentieux pour obtenir réparation suite à la diffusion de cet entretien.
Tout comme les juridictions civiles, le Conseil d’État énonce que « « le droit d’agir pour le respect de la vie privée ou de l’image s’éteint au décès de la personne concernée ». En précisant que « si les proches d’une personne peuvent s’opposer à la reproduction de son image après son décès, c’est à la condition d’en éprouver un préjudice personnel, direct et certain ».
Néanmoins, l’ancien article 1382 n’est tout de même pas cité par le juge administratif. Mais l’idée est la même, pour obtenir réparation il faut rechercher la responsabilité de l’auteur de la diffusion de l’image du mort. Et il faut que cette diffusion ait causé un préjudice personnel à ceux qui demandent réparation. Le Conseil d’État précise que le préjudice personnel doit être certain et direct.
Pour lire une version plus complète de cet article sur le droit à l’image des défunts, cliquez
Sources :
(1)https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036584709
(2)https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021194220/
(3)https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000023946420/