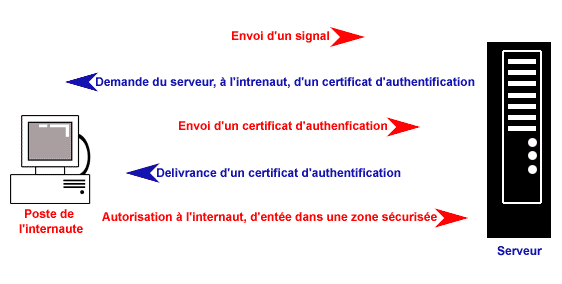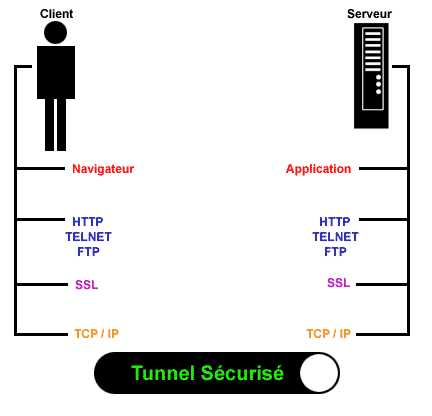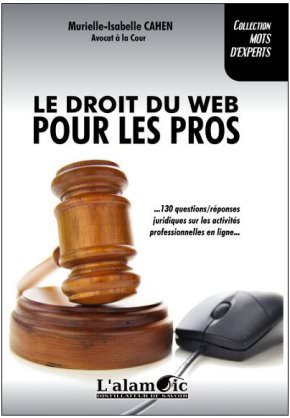21 Avr 2021
Contrat de cession du droit à l’image
L’autorisation par laquelle une personne en autorise une autre à exploiter son image est appelée cession de droit à l’image. La loi et les tribunaux protègent le droit exclusif de chacun sur sa propre image et sur l’utilisation qui peut en être faite. Ce type de cession est très courant dans l’univers de la mode ou des médias.
Existe-t-il des règles spéciales régissant ce type de cession ?
En France, le droit à l’image est protégé par le biais des droits de la personnalité.
Les droits de la personnalité assurent à l’individu la protection des attributs de la personnalité et garantissent son intégrité morale.
Plusieurs textes assurent leur protection, c’est le cas de l’article 12 de la DUDH et de l’article 9 ou 16 du Code Civil.
Ces droits sont des droits extrapatrimoniaux, c’est-à-dire qu’ils sont reconnus à toute personne du simple fait qu’elles existent. Contrairement aux droits patrimoniaux, les droits extrapatrimoniaux sont situés en dehors du patrimoine de l’individu. Ils sont, dès lors, absolus, intransmissibles, imprescriptibles et insaisissables.
À l’origine, le droit à l’image va être consacré grâce au droit au respect de la vie privée consacré à l’Article 9 du code civil.
Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?
Téléphonez nous au : 01 43 37 75 63
ou contactez nous en cliquant sur le lien
» Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »
Toute personne physique a le droit de disposer de son image, quelle que soit la nature du support de publication ou de diffusion de l’image.
Néanmoins, ce droit n’est n’a jamais été reconnu expressément par le législateur. Il n’existe que dans son rapport avec la vie privée et n’est donc pas un droit absolu.
Le droit au respect de la vie privée permet une protection contre toute intervention arbitraire dans l’intimité d’une personne. La protection conférée par ce texte est quasiment sans limites. En effet, la notion de » vie privée » est extensive et évolue au gré de nouvelles mœurs et technologies.
Ainsi, le droit à l’image devient, au fil du temps, un droit autonome et distinct du droit au respect de la vie privée, même si protégé sur le même fondement.
Contrairement aux autres droits de la personnalité, droits extrapatrimoniaux, le droit à l’image est mixte.
Intimement lié à l’individu, il est extrapatrimonial, et pouvant faire l’objet d’exploitation commerciale, il est patrimonial. Cette double nature affecte la portée de sa protection.
En effet, toute personne peut transférer le droit qu’elle a sur son image à un tiers dans le cadre d’un contrat de cession de droit à l’image.
Ainsi, il est nécessaire de se demander quelles règles sont applicables aux contrats de cession de droit à l’image.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris a répondu à cette question dans un arrêt du 07 octobre 2015.
En l’espèce, un mannequin avait signé un contrat par lequel elle consentait à céder son droit à l’image à une société spécialisée dans le commerce de l’habillement.
Aux termes du contrat, le mannequin accordait un droit d’exploitation de son image dans une vidéo promotionnelle de la marque de la société » de façon définitive et irrévocable, et ce, sans aucune limitation de durée et aucune restriction de territoire, le droit d’utiliser son image provenant exclusivement des prises de vues issues du tournage « .
La vidéo a été diffusée sur tous les réseaux (câblés et internet) à des fins commerciales, comme prévu dans le contrat.
Dès lors, les juges ont dû déterminer si le contrat de cession du droit à l’image relevait du droit commun des contrats ou à des règles spécifiques.
Toutefois concernant les conditions de délimitation territoriale, le 14 mai 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a consacré un principe d’unité du préjudice en cas de communications papier et en ligne, concomitantes. Il n’existe pas de préjudices distincts, bien que la communication en ligne ait touché un public différent de celui de la communication papier. Le tribunal considère que l’unité de temps et de lieu a joué à une aggravation d’un préjudice unique.
La doctrine s’était en effet demandée s’il était possible de rapprocher le régime particulier de la cession de droit d’auteur à celle du droit de l’image.
En droit de la propriété intellectuelle, la cession de droits est subordonnée à une obligation de circonscrire très précisément dans le temps et l’espace son étendue.
Cependant, la jurisprudence avait écarté, à de nombreuses reprises, la subordination de la validité des contrats de cession de droit à l’image à l’obligation de limitation territoriale ainsi qu’à celle d’énumération précise des usages fait de l’image.
Ces décisions prouvent l’existence d’un traitement juridique distinct entre la cession de droit d’auteur et celle de droit à l’image.
En outre, d’après l’article 9, seul article applicable en la matière, toute personne physique a le droit de disposer de son image, quelle que soit la nature du support de publication ou de diffusion de l’image. Ainsi, la cession de l’image relève de la liberté contractuelle et donc du croit commun des contrats. Le droit à l’image ne peut donc être assimilé au droit d’auteur qui lui est régi par le Code de la Propriété Intellectuelle.
Dès lors, tout contrat de cession d’image sera apprécié au regard des règles contractuelles de droit commun.
En droit commun des contrats sont prohibés les engagements perpétuels. En d’autres termes, tout contrat instituant une durée d’engagement ad vitam aeternam est nul.
Cette prohibition n’entraîne pas, en revanche, l’interdiction de prévoir une durée contractuelle indéfinie.
En effet, les contrats prévoyant une telle durée sont qualifiés de contrats à durée indéterminée.
En l’espèce, le contrat était signé « sans aucune limitation de durée « .
C’est sur ce fondement que le TGI de Paris a considéré valable la résiliation du contrat liant le mannequin à la société spécialisée dans le commerce d’habillement.
Tout contrat à durée indéterminée peut être résilié à tout moment de façon unilatérale.
« du fait de l’absence de terme prévu pour l’autorisation donnée d’utiliser et d’exploiter son image, ce contrat doit s’interpréter comme un contrat à durée indéterminée dont la résiliation est offerte aux deux parties. »
Le contrat de cession de droit à l’image est donc soumis au droit commun des contrats.
S’agissant du point de départ de la durée de la cession du droit à l’image, ce dernier à fait l’objet d’un contentieux, le 16 novembre 2018. En l’espèce, une mannequin avait tourné un film publicitaire, encadré par un contrat de cession du droit à l’image. Or le contrat limitait l’autorisation d’exploitation de l’image, à une durée de 2ans. Or 3 ans plus tard, le film publicitaire est toujours exploité par la société. Le contrat ne prévoyant pas de point de départ à l’exploitation des droits, ce dernier fut laissé à l’appréciation du juge, qui a considéré que le point de départ débutait à la signature du contrat et non à la première diffusion du film publicitaire. Le juge en a conclu, que la durée d’exploitation de 2ans était terminée et que la société avait alors violé l’article 9 du Code civil.
Dans cette même décision, le juge a déclaré que, le droit à l’image est un droit exclusif dont dispose la mannequin, et que même si son visage est flouté sur le film, le reste du corps est visible et est donc un attribut du droit à l’image.
Enfin, dans une décision du 10 septembre 2018, la cour d’appel de Versailles a précisé qu’une violation du droit à l’image ne constituait pas une atteinte à la vie privée. La cour n’a pas retenu d’atteinte à la vie privée en l’espèce, car la personne concernée était de notoriété publique et qu’elle avait elle-même annoncé sa venue à l’événement où elle a été photographiée. L’atteinte à la vie privée ne se déduit donc pas forcément d’une atteinte à son droit à l’image.
Pour voir l’article sur la protection du droit à l’image en version plus complète, cliquez
SOURCES
http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=4752
Tribunal judiciaire de Nanterre, pôle civil, 1ère ch., jugement du 14 mai 2020
https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-judiciaire-de-nanterre-pole-civil-1ere-ch-jugement-du-14-mai-2020/
TGI de Paris, ordonnance de référé du 16 novembre 2018
https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-paris-ordonnance-de-refere-du-16-novembre-2018/
Cour d’appel de Versailles, 1ère ch. – 1ère sec., arrêt du 29 juin 2018
https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-versailles-1ere-ch-1ere-sec-arret-du-29-juin-2018/