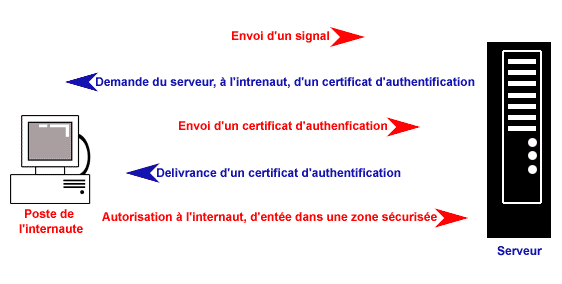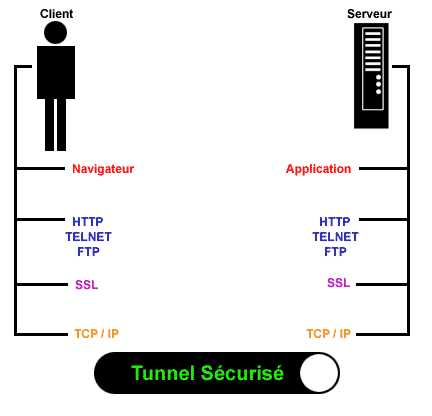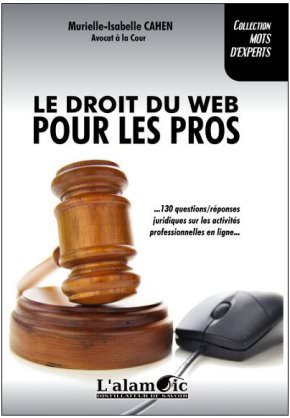12 Nov 2021
OBLIGATIONS DE MOYENS ET OBLIGATIONS DE RÉSULTAT
L’inexécution contractuelle s’apprécie au regard de l’intensité de l’obligation souscrite. La distinction d’origine doctrinale entre « obligations de moyens » et « obligations de résultat » prend tout son sens dans ce terrain. En effet, est-ce au créancier de prouver que son partenaire a commis un manquement afin d’engager sa responsabilité pour obtenir des dommages et intérêts, ou à l’inverse, est-ce à celui qui n’a pas rempli son obligation de prouver qu’il en a été empêché par un cas d’impossibilité exclusif de dommages et intérêts ?
« Toute imputation passe en preuve invincible » : contrairement à ce qu’affirmait Rousseau, le droit français prévoir que la charge de la preuve pèse, en principe, sur celui qui accuse.
En effet, l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », et réciproquement que « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La direction scientifique de Dalloz nous rappelle que « La distinction entre obligation de moyen et de résultat a été forgée par Demogue pour résoudre la contradiction entre les articles 1137 et 1147 du Code civil ».
Néanmoins, en matière contractuelle ainsi qu’en matière de responsabilité, l’article 1147 du Code civil est le texte de référence en la matière : en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de l’obligation, il appartient au débiteur de justifier que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Est présumée donc la responsabilité et la charge de la preuve pèse sur celui qui n’a pas exécuté ou a mal exécuté. Cependant, il existe d’autres dispositions du Code civil (article 1137) qui prévoient que le créancier de l’obligation doit démontrer que son débiteur n’a pas agi ou a mal agi et a commis une faute. À partir de ces textes, la doctrine a dégagé la distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat.
Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrat ?
Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63
ou contactez-nous en cliquant sur le lien
Au 20e siècle, René Demogue dans son « Traité des obligations en général » propose ainsi de classer les obligations contractuelles par leur objet et démontre une unité entre les responsabilités contractuelles et délictuelles reposant toutes les deux sur l’existence d’une faute qui, tantôt doit être prouvée en établissant une négligence ou une imprudence, tantôt découle du simple fait que le résultat n’est pas atteint.
La jurisprudence a repris cette distinction alors même qu’elle est aujourd’hui souvent contestée en des termes parfois sévères. L’avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription proposait d’intégrer dans le Code civil cette distinction ; suggestion qui n’a pas été reprise dans le projet de réforme du droit des contrats.
Cette distinction repose sur le contenu de l’obligation, sur ce qui a été promis. L’obligation est de résultat lorsque le débiteur s’est engagé à obtenir un résultat déterminé ou pour reprendre les termes de l’article 1149 alinéa 1 de la loi « lorsque le débiteur est tenu, sauf en cas de force majeure, de procurer au créancier la satisfaction promise ». A contrario, il y aura obligation de moyens lorsque le débiteur a promis de mettre son activité au service du créancier, mais sans garantir que tel ou tel résultat sera obtenu, ou selon l’article 1149 alinéa 2 de la loi « lorsque le débiteur est seulement tenu d’apporter les soins et diligences normalement nécessaires pour atteindre un certain but ».
Il convient de rappeler que l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 établissant les éléments de la réforme récente du droit des obligations n’a rien prévu en matière d’obligation de moyens et de résultats. Le législateur n’a ni codifié ni précisé la définition des obligations de résultat et de moyen.
Dès lors, il convient de s’intéresser à la distinction fondamentale entre obligation de moyen et de résultat (I), pour comprendre réellement la portée d’une telle distinction (II).
I- L’intérêt de la distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat
La distinction entre ces obligations présente un intérêt en matière probatoire (A) et lorsque les parties n’ont pas précisé ce point dans leur convention, il revient aux tribunaux de déterminer pour chaque type d’obligation si elle est de moyens ou de résultat (B).
A) La charge de la preuve
La distinction de la preuve présente un intérêt qui se manifeste à propos des conditions de la responsabilité éventuelle du débiteur. En effet, si l’obligation est de résultat et que le résultat promis n’a pas été atteint, le débiteur est présumé responsable. À titre d’exemple, si la livraison d’une certaine quantité de marchandises à un moment donné n’a pas été atteinte, la responsabilité est encourue de plein droit. Le débiteur ne peut échapper à cette responsabilité qu’en démontrant que l’inexécution provient d’un cas de force majeure.
Qu’est-ce que la force majeure ? D’après une définition classique, un obstacle ne constitue un cas de force majeure que s’il présente pour le débiteur qui l’invoque trois caractères : l’irrésistibilité, l’imprévisibilité et l’extériorité. Un arrêt de l’assemblée plénière du 14 avril 2006 a défini la force majeure comme « l’événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution ».
Cet arrêt énonce qu’il faut la réunion de ces conditions cumulatives pour qu’il y ait force majeure, conditions appréciées à des moments distincts, alors que l’extériorité demeure incertaine. À l’opposé, lorsque l’obligation est de moyens, il incombe au créancier de démontrer que le débiteur n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires.
Ceci étant, certaines obligations telles que l’obligation de sécurité pesant sur le transporteur de personnes peuvent être soit de moyens, soit de résultat. Pendant la phase d’exécution du contrat proprement dit, il s’agirait d’une obligation de résultat, alors qu’avant et après, il s’agirait d’une obligation de moyens (Cass. Civ., 21 novembre 1911 ; Cass. civ., 1ère, 7 mars 1989).
B) Appréciation par les juges du fond
Dans l’hypothèse d’un désaccord entre les parties sur la portée de l’obligation, il appartient au juge de décider si cette obligation est de moyens ou de résultat. Il arrive que son appréciation évolue dans le temps. En effet, concernant la responsabilité médicale, elle reposait depuis un arrêt de 1936 sur une obligation de moyens, puis, la jurisprudence a admis que pesait sur le médecin une obligation de résultat pour les matériels et les produits qu’il utilise, et pour les maladies nosocomiales. Ces solutions ont été reprises par la loi du 4 mars 2002. L’appréciation du juge va se faire en fonction de différents critères :
– la volonté présumée des parties : peut être le critère déterminant de l’intensité de l’obligation, mais le juge du fond, au titre de son pouvoir d’appréciation et de requalification (article 12 du Code de procédure civile) peut restituer à l’obligation sa véritable qualification ;
– le caractère aléatoire ou non du résultat attendu : si l’obtention du résultat est par essence aléatoire, le débiteur ne peut être tenu à une obligation de résultat. C’est l’application de ce critère qui explique que le médecin ne puisse être tenu, au titre de son obligation principale de soins, à une obligation de résultat. Le résultat de son intervention est toujours aléatoire parce que la science a ses limites et parce que les thérapies les plus éprouvées peuvent ne pas produire les mêmes effets chez tous les patients ;
– le rôle actif ou passif du créancier dans l’exécution de l’obligation : dans l’hypothèse où le créancier est activement impliqué dans le processus d’exécution de l’obligation à laquelle le débiteur est tenu, cette obligation ne peut être qu’une obligation de moyens. Il est, en effet, impossible d’imposer une obligation de résultat là où le créancier n’est pas le seul maître de l’obtention du résultat.
Le juge prend en compte la qualité de l’auteur, la nature du dommage et de l’obligation, la présence d’un aléa et la participation active du créancier ; la combinaison de ces éléments constituant un faisceau d’indices lui permettant de rechercher la volonté des parties.
Les modes de preuve sont libres (témoins, expertises) et si la faute est prouvée, la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle sera établie à moins que l’auteur ne puisse dénier l’existence d’un lien de causalité entre sa faute et le dommage.
Dans un arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 novembre 2020, la troisième chambre civile s’était prononcée sur l’intensité de l’obligation contractuelle de sécurité qui était à la charge de l’entreprise assurant la maintenance et l’entretien de portes automatiques de garage.
En l’espèce, un locataire d’appartement est blessé par la porte automatique du parking de son immeuble. Celle-ci ne s’était pas refermée et le locataire en essayant de la fermer manuellement s’est blessé.
Il va donc assigner l’assureur de son immeuble en réparation des préjudices et la société chargée de la maintenance de la porte est appelée en garantie par l’assureur.
À cet égard, la Cour de cassation énonce que : « celui qui est chargé de la maintenance d’une porte automatique d’accès à un parking est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l’appareil ». (4)
II- La portée de la distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat
Prendre exemple sur la responsabilité du médecin et sur celle de l’avocat est intéressant concernant la portée de la distinction (A). Certaines catégories intermédiaires ont également vu le jour (B) (C).
A) L’obligation du médecin
S’agissant des obligations de donner et de ne pas faire (article 1126 du Code civil), il s’agit sans nul doute d’obligations de résultat parce qu’a été promis un résultat absolu, non susceptible de plus ou de moins (exemple : transférer la propriété, ne pas faire concurrence, livraison d’une chose à telle date).
Quant aux obligations de faire, elles peuvent être de moyens ou de résultat. En matière médicale, la question de la nature de l’obligation du médecin s’est posée à plusieurs égards. Les progrès de la médecine ont poussé la jurisprudence à reconnaître de plus en plus une obligation de résultat alors que les aléas de la médecine avaient traditionnellement fait opter les tribunaux pour une obligation de moyens.
En effet, le médecin s’engage non pas à guérir ; mais à mettre en œuvre tous les moyens afin d’améliorer l’état du patient. Le célèbre arrêt Mercier de 1936 est aujourd’hui repris à l’article L.1142-1 du Code de la santé publique tel qu’il résulte de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Le principe de responsabilité pour faute est réaffirmé, « les professionnels de santé (…) ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic et de soins qu’en cas de faute ». Toutefois, afin de ne pas pénaliser les patients, la même loi a prévu un système d’indemnisation pour les dommages les plus graves et la Cour de cassation admet des exceptions au principe de responsabilité pour faute pour les infections nosocomiales ainsi que pour les dommages causés par les produits de santé.
Le médecin étant également tenu d’une obligation d’information, la jurisprudence avait d’abord retenu que le patient devait rapporter la preuve de l’inexécution de l’obligation avant de décider en 1997, qu’il lui incombe de prouver qu’il a exécuté cette obligation.
B) Des catégories intermédiaires
Grâce à quelques textes épars concernant le régime de certains contrats spéciaux, la jurisprudence a pu ajouter des catégories intermédiaires d’obligations dans lesquelles le débiteur devrait rapporter simplement la preuve de son absence de faute pour se dégager. Il en est ainsi concernant le contrat d’entreprise, l’article 1789 du Code civil ne rend l’entrepreneur responsable de la chose qui lui a été confiée que si la perte de cette chose est due à sa faute ; la jurisprudence admettant néanmoins que cette faute est présumée et que l’entrepreneur doit, pour se dégager, prouver son absence de faute.
Bien que généralisée dans les contrats de restitution, cette catégorie semble aussi parfois s’appliquer à une obligation de sécurité. Il s’agit là d’une obligation de moyens renforcée, parfois appelée obligation de résultat atténuée : c’est bien au débiteur qu’il incombe de se dégager, mais la preuve exigée est plus aisée que celle de la force majeure.
En outre, il existe une obligation de résultat, renforcée pour laquelle aucune cause d’exonération totale n’est envisageable. Dans ce contexte, la volonté des parties est très importante et le faisceau d’indices évoqués n’a plus d’intérêt. Ces catégories intermédiaires sont en voie de régression. Une partie de la doctrine soutient néanmoins que cette distinction binaire est sans doute trop primaire pour refléter la réalité contractuelle contemporaine et qu’il faudra certainement la reconsidérer.
C) La catégorie des contrats informatiques
Dans le cadre d’un contrat informatique, la nature de l’obligation des parties est inhérente à la détermination du rôle de leur responsabilité. La jurisprudence est plus stricte en la matière, en ce qu’elle considère que le prestataire d’une mission informatique est tenu d’une obligation de résultat.
À titre d’illustration, le tribunal de commerce de Vienne, dans un jugement du 21 janvier 2021, considère qu’un prestataire, qui remet au client un logiciel avec des dysfonctionnements, a manqué à l’obligation de résultat consistant à la livraison d’un logiciel personnalisé et conforme aux attentes de son client.
En outre, la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 17 mai 2017, avait retenu la responsabilité d’un prestataire de service informatique qui s’était engagé à la réalisation d’un site internet en usant la mention « clé en main ».
En effet, à la suite de dysfonctionnements survenus à la mise en œuvre du site, la Cour de cassation avait interprété la mention « clé en main » utilisée par le prestataire informatique comme révélant l’existence d’une obligation de résultat. (1)
Ceci étant, la jurisprudence s’est prononcée en faveur d’une qualification d’obligation de moyen renforcée dans la mesure où la collaboration du client était indispensable. À cet égard, la Cour d’appel de Caen, dans un arrêt rendu le 22 avril 2021, bien qu’elle ait considéré que le prestataire était ténu d’une obligation de résultat concernant la livraison d’un logiciel. La Cour avait considéré que ce dernier était tenu d’une obligation de moyen quant aux prestations de migrations de données qui nécessitaient la collaboration du client. (2)
Cette même position a été adoptée par la Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt rendu le 29 octobre 2020. En effet, la Cour avait considéré que le prestataire n’était soumis qu’à une obligation de moyen renforcée puisque la participation active du client dans la réalisation de solution informatique était indispensable. (3)
Pour lire une version plus complète de cet article sur les contrats et les obligations, cliquez ici
Sources :
- Cass, C. Com, arrêt nº 734 du 17 mai 2017, nº 15-17.948
- 2ème, 22 avril 2021, nº 19/00629
- 2ème, 19 novembre 2018, n° 17/03030
- 3e civ., 5 nov. 2020, n° 19-10.857