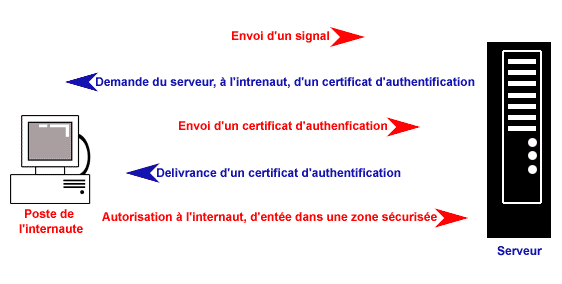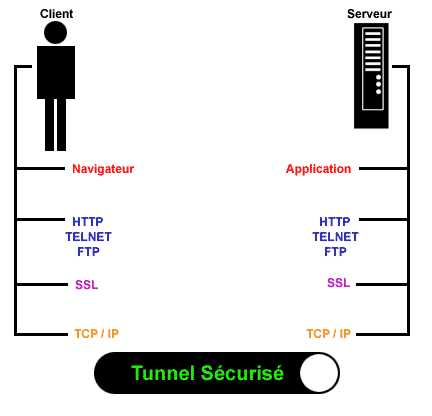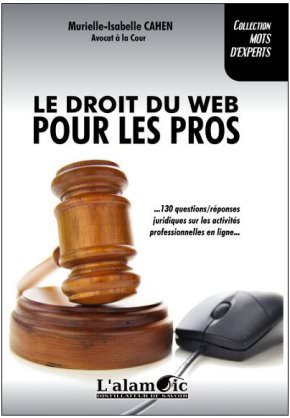6 Mai 2021
Diffamation de nature raciale
Dans le droit français, c’est la Loi du 29 juillet 1881 qui sanctionne les infractions de presse. Initialement, cette loi ne concernait que la presse « papier » mais par la suite avec l’évolution des modes et supports de communication, son champ d’application a été élargi à toute forme de publication. Un acte de publication peut être défini comme le fait de porter à la connaissance d’autrui un fait. Le support importe peu dans cette définition.
Ainsi, la Loi du 29 juillet 1881 s’applique également à Internet, notion définie par Loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique dite LCEN comme un moyen de communication au public par voie électronique. Étant donné la constante augmentation des utilisateurs d’Internet et des réseaux sociaux permettant l’expression d’opinions et débats sur la toile, chacun peut se rendre coupable, sans le savoir, d’un délit de presse.
Dans le cadre de notre étude, nous allons nous concentrer sur les infractions de diffamation et d’injure. Il conviendra de les distinguer (I) avant de s’intéresser aux nouveaux délits à caractère racial ou discriminatoire (II) introduit par la Loi 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme.
I. Distinction entre la diffamation et l’injure :
La distinction entre ces deux infractions est souvent subtile. En effet, dans certains cas, ceux deux infractions peuvent coexister au sein d’une même allégation. Dans d’autres cas, un terme de l’allégation va relever de la diffamation alors que l’autre relève de l’injure . C’est pourquoi il convient de les distinguer.
Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de diffamation ?
Téléphonez nous au : 01 43 37 75 63
ou contactez nous en cliquant sur le lien
A) La diffamation :
La diffamation est définie à l’article 29 alinéa 1 de la loi de presse du 29 juillet 1881 qui dispose que « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. » (1).
Pour caractériser l’élément matériel de la diffamation, il faut la réunion de deux conditions. La diffamation nécessite d’abord l’imputation d’un fait précis à une personne. La caractérisation de ce fait précis est souvent délicate parce que cela peut être confondu avec une opinion. Ensuite, ce fait doit porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne.
L’élément intentionnel est présumé du simple fait de l’existence d’un élément matériel. L’intention de publication suffit donc à caractériser l’élément intentionnel. Nul besoin de prouver l’intention de nuire de l’auteur de l’infraction.
La diffamation est retenue « dès lors que, sans toutefois l’affirmer avec certitude, le propos incriminé insinue que ce pourrait être en toute connaissance de cause que la partie civile a produit un faux document devant une juridiction » a relevé la Cour de cassation dans un arrêt du 24 mars 2020. Celle-ci rappelle également que la forme, manière d’expression de la diffamation, est indifférente, il y a diffamation bien que cette dernière soit exprimée « sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d’insinuation ».
Il existe cependant des éléments d’exonération :
L’exception de bonne foi représente le cas où l’auteur rapporte la preuve de la légitimité du but poursuivi, d’une recherche d’information, de sources fiables, d’une absence d’animosité personnelle, d’une objectivité des faits…
L’exception de vérité consiste à prouver l’exactitude des faits, mais cette exception est encadrée et elle ne peut pas être invoquée dans les cas listés à l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 (2).
Selon l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, le délai de prescription de l’action de diffamation est de « trois mois révolus, à compter du jour où les faits auront été commis »(3). La diffamation étant une infraction instantanée, le point de départ de ce délai est fixé au jour de l’infraction. Cette action nécessite un dépôt de plainte de la victime ou une citation directe devant le tribunal correctionnel.
La diffamation publique qui constitue un délit au sens de l’article 29 alinéas 1 de la loi du 29 juillet 1881 est passible d’une amende de 12 000€. Cependant, une autre forme de diffamation peut aussi constituer une infraction pénale, c’est la diffamation non publique qui constitue une contravention et est passible d’une amende de 38€. La différence réside donc dans l’acte de publication.
Étant donné les similitudes entre les délits de diffamation et d’injure, la qualification de l’infraction est très importante et une confusion entre les deux peut mener à l’irrecevabilité de l’action.
B) L’injure :
Selon l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, « Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure »(4)
Contrairement à la diffamation, l’injure n’impute pas un fait précis à une personne, mais un terme isolé. Cette distinction n’est pas toujours évidente et dans les cas où les deux infractions sont indivisibles, selon un arrêt de la chambre criminelle du 12 juin 1956, c’est la diffamation qui prévaut.
Comme pour la diffamation, l’élément intentionnel est présumé et l’acte de publication à lui seul suffit à caractériser l’infraction.
L’injure fut ainsi caractérisée dans un arrêt du 7 janvier 2020 « au regard de la tonalité de l’ensemble du message, tout sens prétendument médical au terme litigieux et a exactement retenu le caractère injurieux d’un qualificatif outrageant à l’égard des personnes transgenres, qu’il atteint dans leur identité de genre ». La Cour considère que le mépris exprimé à l’égard d’une catégorie de personnes, en raison de leur identité de genre, est une injure et donc une infraction.
Contrairement à la diffamation, l’exception de vérité ne constitue pas un élément d’exonération. Cependant l’excuse de provocation peut exonérer l’auteur de l’infraction de sa responsabilité.
Le délai de prescription est le même que pour le délit de diffamation.
Selon l’article 33 al 2, l’injure est « punie d’une amende de 12 000 euros» (6).
II. Diffamation et injure à caractère racial ou discriminatoire
C’est la Loi du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme, qui a modifié la loi du 29 juillet 1881 en introduisant les infractions de presse à caractère discriminatoire. Suite à la distinction entre la diffamation et l’injure, il convient de distinguer ces dernières avec les infractions de presse à caractère discriminatoire à savoir la diffamation discriminatoire (A) et l’injure discriminatoire (B).
A) Diffamation raciale ou discriminatoire :
L’article 32 al 2 et 3 vise les discriminations en raison de l’origine, du sexe, de la race, de la religion, de l’orientation sexuelle, du handicap… (5). La distinction avec la diffamation est ce caractère discriminatoire dans le fait imputé. En effet, cet élément spécifique de la diffamation discriminatoire est que l’atteinte à l’honneur soit motivée par l’origine, l’appartenance à une ethnie, la race ou encore la religion de la personne. Une fois de plus, la caractérisation de ce fait précis est d’autant plus délicate, car peut se confondre avec des opinions.
De ce fait, c’est le contexte de publication de l’allégation qui est prise en compte dans plusieurs cas. À titre d’exemple, l’expression « Shoa business » est une diffamation raciale envers les juifs (Cass, crim, 12 septembre 2000) ou encore l’affirmation de « faire des gamins pour toucher les allocations » est une diffamation raciale envers les Magrébins (CA Aix-en-provence, 7e chambre, 9 mars 1998).
Selon la loi Perben II de 2004, le délai de prescription de 3 mois est ramené à 12 mois dans le cas de diffamation raciale. Et contrairement à la diffamation, un dépôt de plainte n’est pas nécessaire, le ministère public peut exercer d’office des poursuites.
D’autant plus que les causes d’exonération vues précédemment ne sont pas admises en matière de diffamation raciale.
Quant à la répression, elle est « d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende »(5)
L’application du délit de diffamation racial fut retenue dans un arrêt du 1er septembre 2020, concernant des personnages représentant l’ensemble de la communauté juive. La Cour de cassation retient qu’il y a une exploitation de la mémoire des victimes de la Shoah, le diffamateur en retirant des profits financiers. Une atteinte à l’honneur et à la considération fut donc retenue et la Cour a approuvé la décision de la Cour d’appel de sanctionner le diffamateur à hauteur de 4000€ d’amende.
B) Injure raciale ou discriminatoire :
Selon l’article 33 alinéa 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1881 (6), c’est une expression outrageante, un terme de mépris qui porte atteinte à la dignité ou l’honneur de la personne injuriée et qui serait prononcé en raison de l’origine, la race, le sexe ou la religion de cette dernière.
Existe une subtilité dans la cause d’exonération tirée de du second alinéa de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881, puisque la provocation peut excuser l’injure raciale. Cependant, les juridictions tendent à écarter l’application de cette cause d’exonération par différents moyens, notamment en invoquant l’absence de proportionnalité entre l’injure raciale et la provocation (Cass, crim, 13 février 1999).
Pour les délais de prescription, comme pour la diffamation discriminatoire, le délai de trois mois est prolongé. L’action est donc possible dans les 12 mois suivant les faits.
Une dernière différence demeure au niveau de la répression, et comme dispose l’article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, l’injure raciale « Sera punie de six mois d’emprisonnement et de 22 500 euros d’amende »(6).
Dans un arrêt du 15 octobre 2019, la Cour de cassation est venue sanctionner l’injure raciale, au motif que les propos tenus étaient « outrageants envers les adeptes de la religion juive, présentés comme atteints de troubles et de maladies qui ne s’appliquent qu’aux personnes, et qu’ils ne visent donc pas seulement les préceptes religieux du judaïsme ».
Pour lire cet article sur la diffamation raciale plus détaillé, cliquez
Sources :
- https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419790&cidTexte=LEGITEXT000006070722
- https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419794&cidTexte=LEGITEXT000006070722&dateTexte=20011231
- https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000006419866&cidTexte=LEGITEXT000006070722
- https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419790&cidTexte=LEGITEXT000006070722
- https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419738&cidTexte=LEGITEXT000006070722&dateTexte=20080312
- https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419745&cidTexte=LEGITEXT000006070722&dateTexte=20110916
24 mars 2020, n° 19-83.553
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041810449?init=true&page=1&query=19-83.553&searchField=ALL&tab_selection=all
Crim, 7 janv. 2020, n° 19-80.796
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041481947?init=true&page=1&query=19-80.796&searchField=ALL&tab_selection=all - Cour de cassation, 1 septembre 2020, n° 19-84.102
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043167107?init=true&page=1&query=19-84.102&searchField=ALL&tab_selection=all - Cour de cassation, 15 octobre 2019, n° 18-85.365
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000039285274?init=true&page=1&query=18-85.365&searchField=ALL&tab_selection=all