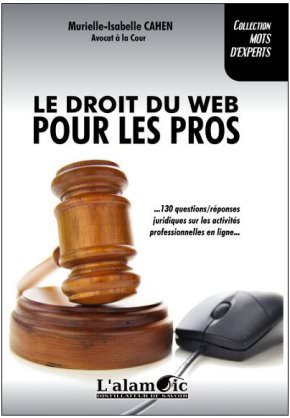6 Oct 2022
QUELLE PROTECTION POUR LE JEU VIDÉO ?
Le marché du jeu vidéo ne cesse d’augmenter. Cependant, d’un point de vue juridique, il n’a pas toujours été évident de déterminer les règles de protections applicables en matière de jeu vidéo. La jurisprudence a longtemps hésité sur la qualification du jeu vidéo.
Il a dans un premier temps fallu reconnaître le jeu vidéo en tant que tel pour pouvoir y apporter une protection adaptée.
Le jeu vidéo comporte plusieurs éléments, comme le logiciel, l’interface graphique et sonore ou encore du game play. Il a donc fallu s’attarder sur la définition du jeu pour établir le cadre de la protection par rapport au droit de la propriété intellectuelle.
Pendant longtemps la jurisprudence n’a pas su définir clairement le jeu vidéo, encore aujourd’hui les définitions restent globalement peu satisfaisantes. La jurisprudence a dégagé plusieurs critères pour amener à la qualification de jeu vidéo. Mais dans certains cas, les critères qui ont pu être dégagés dans les années 90, manque parfois de pertinence. C’est le cas du critère lié au support matériel des cartouches de jeux, celles-ci sont de moins en moins utilisées en raison de la dématérialisation. Cependant, certains critères restent d’actualité, comme celui du logiciel, l’interactivité et de l’existence de séquence animée.
Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?
Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63
ou contactez-nous en cliquant sur le lien
Il est intéressant de revenir dans un premier temps que l’évolution jurisprudentielle sur la qualification du jeu vidéo, passant d’une qualification unitaire à une qualification distributive (I) ainsi que la qualification d’œuvre collaborative du jeu vidéo qui est venu écarter la qualification de l’œuvre collective. (II)
I L’hésitation jurisprudentielle menant à une qualification distributive du jeu vidéo
La jurisprudence a d’abord accordé une protection particulière au jeu vidéo découlant de la protection spécifique du logiciel et ainsi opérée une qualification distributive du jeu vidéo (A). Elle a finalement opté pour une qualification distributive du jeu vidéo en estimant que chaque composant du jeu vidéo devait être soumis à une protection propre à sa nature (A).
A) Le jeu vidéo : une œuvre unitaire protégée par le régime des logiciels
Le critère de l’originalité ne pouvant être retenu pour le jeu vidéo selon la jurisprudence, la qualité d’œuvre était par conséquent rejetée. Ainsi, le jeu n’était pas protégé par le droit de la propriété littéraire et artistique.
Dans un arrêt par le tribunal de Nanterre le 29 juin 1984, il a notamment énoncé que « « ce qui est dénommés pingouins ou créatures hostiles ou encore monstres est constitué de lignes géométriques qui dessinent des silhouettes de schémas que l’on veut bien qualifier d’animaux, mais qui ne présentent pas de caractère particulièrement original, surtout si on les compare aux personnages fortement typés tels que ceux de Donald, Daisy, Minnie, Dingo et autre Mickey du monde féérique de Walt Disney »
Par la suite, la Cour de cassation a rendu les arrêts de principe du 7 mars 1986, Atari et William electronics. Dans ces arrêts, elle a finalement reconnu aux jeux vidéo la qualité d’œuvre de l’esprit pour autant que la condition de l’originalité soit satisfaite.
La position du Tribunal quant à la condition de l’originalité n’est pas rejetée, car le jeu vidéo doit être considéré par une œuvre de l’esprit et ainsi être protégeable par le droit d’auteur.
Après avoir enfin retenu au jeu vidéo la qualité d’œuvre de l’esprit, il a donc été question de le qualifier pour pouvoir appliquer les règles de protection adaptées.
Étant donné que le jeu vidéo regroupe différents composants a rendu complexe sa qualification. Il y a notamment le logiciel, le graphisme, les effets audio, etc.
Dans un premier temps, la jurisprudence s’est donc dirigée vers une qualification unitaire du jeu vidéo. Il était donc question d’appliquer la protection d’un des éléments du jeu à l’ensemble des autres composants.
Pour la Cour, « le logiciel, qui est un programme permettant le traitement de données, ne peut s’apprécier par rapport à un graphisme, à une animation ou à un bruitage, qui sont distincts du logiciel ».
Le législateur à l’époque reconnaissait la qualité d’œuvre de l’esprit au logiciel en raison de la loi du 3 mai 1985. C’est d’ailleurs ce qui a amené à la décision des arrêts Atari et Willaim electronics..
Une décision fondamentale a finalement été rendue consacrant dans un premier temps la qualification d’œuvre unitaire. Il s’agit de l’arrêt Mortal Kombat. Dans cet arrêt, la Cour de cassation énonce que le jeu vidéo doit être considéré comme un logiciel en précisant « “qu’indépendamment de l’appréciation qui peut être portée sur la valeur artistique ou esthétique des jeux vidéo, laquelle n’a pas à entrer en ligne de compte, il ne s’agit pas de la simple mise en œuvre d’une logique automatique, mais d’une création de l’esprit présentant un caractère original”.
Une partie de la doctrine a approuvé cette décision, néanmoins elle sera écartée par la Cour de cassation le 28 janvier 2003 qui énonce que le jeu vidéo n’est pas une œuvre audiovisuelle puisque celle-ci est communément définie comme une “séquence d’images sans interactivité”.
Cependant, la jurisprudence ayant tout de même énoncé que le logiciel devait être considéré comme l’élément principal du jeu, car il ne pouvait exister sans sa présence. Par conséquent, l’arrêt du 21 juin 2000 (Mortal Kombat) reconnaissait la qualification unitaire. Ils avaient ainsi estimé que le régime spécial du logiciel devait donc être appliqué à l’ensemble des composants du jeu. Ce régime accordant un avantage particulièrement important à l’éditeur du jeu.
Concernant le logiciel, il comporte lui-même plusieurs parties. Les idées, l’algorithme ainsi que ces fonctionnalités ne sont pas protégeables. Également, le droit d’auteur vient s’appliquer en ce qui concerne la forme exécutée du logiciel (le cahier des charges) mais aussi aux effets audiovisuels et l’interface graphique. Néanmoins, le droit spécial du logiciel s’applique lorsque cela concerne la partie programmée du logiciel, à savoir le code source.
Également, pour qu’un logiciel soit considéré comme original, la Cour de cassation énonçait dans l’arrêt Pachot rendu le 7 mars 1986 “qu’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante et que la matérialisation de cet effort résidait dans une structure individualisée”
Pour rappel, l’existence d’un contrat de travail ne signifie pas forcément qu’il y ait une dévolution automatique sur les droits des œuvres créées par les salariés. Cependant, le droit spécial du logiciel prévoit quant à lui un mécanisme de dévolution automatique des droits à l’employeur, ainsi celui-ci est particulièrement avantageux pour l’éditeur.
Cela est prévu par l’article L.113-9 du Code de propriété intellectuelle (CPI). L’employeur est le seul pouvant dans ce cas exercer les droits patrimoniaux sur l’œuvre. De plus, l’auteur d’un des éléments du jeu vidéo ne saurait bénéficier de la rémunération pour copie privée. Le droit moral de l’auteur d’un logiciel est largement réduit.
Il ne sera notamment pas possible pour l’auteur ne s’opposer à la divulgation au public de l’œuvre, seul l’éditeur le peut. En outre, l’article 121-7 du CPI prévoit que l’auteur ne peut s’opposer à la modification du logiciel ou d’exercer ses droits de repentir et de retrait.
Ainsi, comme l’énonce la Cour d’appel de Douai dans un arrêt du 1er juillet 1996, “le droit moral se réduit en matière de logiciel au droit au nom”.
La qualification unitaire a finalement été largement critiquée étant bien trop à l’avantage de l’éditeur. La Cour a donc finalement opéré un revirement de jurisprudence et a opté pour une qualification distributive du jeu vidéo.
B) Qualification distributive du jeu vidéo : chaque élément protégé en fonction de sa nature
La jurisprudence a finalement opté pour une qualification distributive du jeu vidéo dans l’arrêt CRYO rendu le 25 juin 2009. Elle a énoncé qu’“Un jeu vidéo est une œuvre complexe qui ne saurait être réduite à sa seule dimension logicielle, quelle que soit l’importance de celle-ci, de sorte que chacune de ses composantes est soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature”.
Le jeu vidéo peut se décomposer en cinq composants principaux, à savoir, le logiciel, le scénario, les effets audiovisuels, la base de données et le game play. Chacun de ces composants ne pouvait se voir appliquer les mêmes règles de protection. Il convient donc d’appliquer des règles propres à la nature de chaque composant.
Le droit du logiciel dispose, comme dit précédemment, d’un statut spécifique. Une directive de 1991 renforcée en 2009 a amené ce droit spécial du logiciel. Le logiciel restera protégé par les règles de cette protection spéciale qui déroge au droit d’auteur. Ainsi, dans ce cas, l’auteur ne pourra exercer ses droits patrimoniaux. Ces derniers reviendront à l’éditeur du jeu vidéo.
Concernant les autres composant du jeu vidéo, ils pourront quant à eux bénéficier d’une protection propre à leur nature. Ainsi, selon la nature de leurs contributions, les auteurs pourront invoquer des règles spécifiques. L’arrêt CRYO met donc un terme à l’idée de qualification unitaire du jeu.
Tout d’abord, comme c’est le cas pour tous types d’œuvres, les auteurs devront satisfaire la condition de l’originalité de leur contribution au jeu vidéo pour se prévaloir de la protection par le droit d’auteur.
Lorsque cette condition est remplie, il conviendra d’apporter une protection adaptée à la nature de leur contribution. À titre d’illustration, la musique qui est intégrée dans le jeu vidéo sera régie par régime de protection des œuvres musicales, de sorte que l’auteur sera soumis à la gestion collective des œuvres musicales, ainsi qu’à leur mode de rémunération.
Dans un arrêt rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 30 septembre 2011, la question concernant la composition musicale insérée dans le jeu vidéo s’est notamment posée.
Ce jugement a une portée large en ce qu’il vient préciser le statut du jeu vidéo et de sa protection en se fondant sur la jurisprudence CRYO.
II. Le jeu vidéo : une œuvre audiovisuelle de collaboration
Nous verrons dans un premier temps comment le régime de l’œuvre collective et donc unitaire a été écarté par le TGI de Paris dans le jugement du 30 septembre 2011 en se fondant sur l’arrêt CRYO, puis dans un second temps, nous verrons les spécificités du régime de protection des œuvres audiovisuelles de collaboration, ainsi que les juges ont qualifié le jeu vidéo.
A. La protection du jeu vidéo par le statut de l’œuvre collective écartée
Le 30 septembre 2011, les juges ont privilégié le statut d’œuvre audiovisuelle de collaboration pour le jeu vidéo au détriment de celui qui est plus avantageux pour l’éditeur du jeu vidéo, le statut d’œuvre collective.
Ainsi, les juges se sont alignés sur la jurisprudence CRYO. En cela en rejetant la qualification d’œuvre unitaire (œuvre collective) au profit de l’œuvre distributive (œuvre de collaboration).
En l’espèce, une composition musicale avait été créée dans le cadre d’un contrat de travail. Celui-ci avait été conclu avec une société spécialisée dans le jeu vidéo. Ce contrat portait donc sur un jeu en particulier et la composition devait être utilisée uniquement pour ce dernier. L’auteur original de la composition s’est rendu compte qu’un CD avait également été créé reprenant les compositions musicales. Ce CD a fait l’objet d’une commercialisation sur un site internet, et ce, sans l’autorisation de l’auteur. Il a donc assigné la société en contrefaçon sur le fondement du droit d’auteur.
La société estimait que la qualité d’auteur ne pouvait être invoquée par le demandeur dans la mesure où il ne disposait pas d’une liberté de création, mais qu’au contraire il était subordonné aux instructions de la société.
Ainsi, la cour a dû répondre à la question suivante : “est-il possible d’assimiler le jeu vidéo à une œuvre collective ?”
Pour rappel, une œuvre collective peut se définir comme un rassemblement sous une autorité unique d’un ensemble de forces individuelles de travail en vue d’atteindre un résultat unitaire.
L’article L.113-2 du CPI dispose en ce sens qu’“Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé”.
Les juges dans l’arrêt du 30 septembre retiennent finalement que la composition musicale peut être séparée du jeu vidéo, en effet, elle peut être écoutée sans jouer audit jeu, et est donc détachable.
Par conséquent, il est possible d’attribuer un droit distinct au compositeur sur cette contribution. Également,, le tribunal souligne l’indépendance de création dont a bénéficié l’auteur. Les juges ont tiré de ces constatations la qualité d’auteur du compositeur.
Ainsi, le tribunal écarte le jeu vidéo du régime de l’œuvre collective, celui-ci prévoyant que “l’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle est divulgué. Cette personne est investie des droits d’auteur” en vertu de l’article L.113-5 du CPI.
Au regard de ce qui précède, le TGI de Paris a donc conclu que le jeu vidéo constituait une œuvre de collaboration ouvrant le droit à la protection par le droit d’auteur. La question est à présent de savoir comment s’organise cette protection.
B. La protection du jeu vidéo par le régime de l’œuvre de collaboration
L’article L.113-2 al 1er du Code Propriété intellectuelle définit l’œuvre collaborative et dispose ainsi qu’ » « Est dite œuvre de collaboration, l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. ». À l’inverse de l’œuvre collective, dans l’œuvre collaborative les coauteurs disposent d’une autonomie dans la création. Ainsi, en caractérisant l’autonomie dans le jeu vidéo, le statut d’œuvre collective a pu être reconnu à ce dernier.
De plus, l’article L. 113-3 précise que « L’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Ils doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartiendra à la juridiction civile de statuer. »
Ainsi, les actes d’exploitation du jeu vidéo devront être consentis par l’ensemble des coauteurs. La Cour de cassation dans un arrêt rendu par sa première chambre civile le 19 décembre 1989, à notamment eu l’occasion d’en apporter la confirmation.
Par conséquent, dès lors que le consentement de l’ensemble des coauteurs du jeu vidéo n’a pas été recueilli, les actes d’exploitation constitueraient une contrefaçon, comme énoncé dans l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 19 mai 1976. .
Également, sous peine d’irrecevabilité, les actions en protection des droits sur l’œuvre doivent être exercées en commun, comme décidée par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 octobre 1988.
Concernant la protection des contributions à part entière. Le musicien qui a élaboré les morceaux de musique pour le jeu vidéo est donc auteur, et il bénéficie sur cette contribution des droits de propriété intellectuelle et artistique. Il pourra ainsi se prévaloir des prérogatives patrimoniales (droit de reproduction prévu à l’article L. 122-3 du CPI, droit de représentation prévu à l’article L. 122-2, droit de suite prévu à l’article L. 122-8) et du droit moral (droit de divulgation prévu à l’article L.121-2 du CPI, droit de paternité prévu à l’article L.121-1, droit au respect de la création prévu à l’article L.121-1, droit de retrait et de repentir prévu à l’article L.121-4.
En outre, il peut notamment exercer ses droits en autorisant des actes d’exploitation de sa contribution. Dans le cadre d’une œuvre de collaboration néanmoins, ce droit est aménagé comme suit. L’auteur d’une contribution peut consentir l’exploitation de celle-ci sans en demander l’autorisation à l’ensemble des coauteurs de l’œuvre. C’est en effet ce que dispose l’article L. 113- 3, al.4 du CPI. Si l’on le rapporte à l’espèce de l’arrêt du 30 septembre 2011, cela signifie donc que le musicien, auteur d’une composition musicale peut autoriser la reproduction de cette musique par des tiers sans avoir à recueillir le consentement de qui que ce soit
Cependant, une limitation à cette liberté d’exploitation est apportée par l’article L. 113- 3, ce dernier énonce que l’exploitation de la contribution personnelle ne doit pas « porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune ». La jurisprudence a considéré par exemple que l’exploitation de la contribution ne pouvait compromettre le succès de l’œuvre dans son entier (TA Nice, 6 avril 1966).
L’auteur d’une contribution dispose également d’une action en contrefaçon si une utilisation de sa contribution est faite sans son consentement.
Dans le jugement rendu le 30 septembre 2011, on se retrouve notamment dans cette situation. En effet, une société avait exploité les morceaux de musique indépendamment du jeu vidéo. La société n’avait pas obtenu d’autorisation de la part de l’auteur de la contribution. C’est ainsi qu’elle s’est rendue fautive d’un acte de contrefaçon.
Par conséquent, l’autorisation accordée par l’auteur de la contribution d’un jeu vidéo pour pouvoir l’exploiter ne s’étend pas à l’exploitation de la contribution seule. Ainsi, pour exploiter une contribution d’un jeu vidéo, il faut en demander l’autorisation à son auteur.
Pour lire une version plus complète de cet article sur les jeux vidéos, cliquez