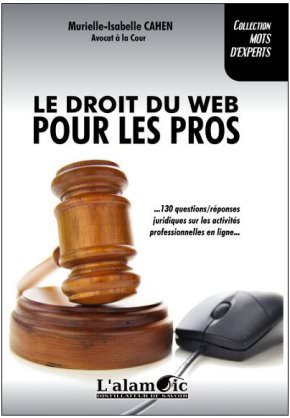26 Avr 2022
LES NOUVEAUX MODES D’ESCROQUERIES SUR INTERNET
Internet a fait émerger un nouveau mode de criminalité : la cybercriminalité. L’infraction classique de l’escroquerie s’est vu prendre de nouvelles formes avec l’arrivée d’internet. Nombreuses sont les victimes de ces nouveaux modes d’escroqueries sur internet. Comment peut-on lutter contre ce fléau et comment cette pratique est-elle réprimée par la loi ?
NOUVEAU : Utilisez nos services pour vous défendre en passant par le formulaire !
Aujourd’hui avec internet les escrocs peuvent agir de partout dans le monde. Par conséquent, il n’est pas toujours aisé de les identifier. Les victimes sont de plus en plus nombreuses avec le développement de ces nouveaux modes d’escroqueries par internet.
Les pouvoirs publics ont finalement pris conscience des dangers de ces nouveaux modes opératoires. Cela aura pris du temps, mais dorénavant, ce fléau est convenablement traité.
Pour comprendre au mieux ces nouveaux modes d’escroqueries sur internet, il convient de revenir sur la définition de l’escroquerie ainsi que les différentes formes qu’elle peut prendre sur internet. Enfin, il faudra se pencher sur les moyens existants pour lutter contre ces escroqueries, toujours plus nombreux.
L’escroquerie est prévue à l’article L.313-1 du Code pénal. Cette infraction correspond au fait « soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».
L’escroquerie est un délit, puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. L’article 313-3 de Code pénal prévoit quant à lui que la tentative d’escroquerie est également punissable. Il convient de rappeler que lorsque la tentative est punie, elle l’est tout autant que la consommation de l’infraction.
Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème d’escroquerie ?
Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63
ou contactez-nous en cliquant sur le lien
Cette infraction est loin d’être nouvelle, mais le développement d’internet a rendu possibles de nouveaux modes d’escroqueries.
Certains internautes ont donc fait le choix de profiter de la naïveté ou du manque de connaissances de certains utilisateurs. Ces internautes vont donc chercher à obtenir la remise d’un service, des fonds ou encore des valeurs par le biais d’internet.
Ces nouveaux modes d’escroqueries prennent différentes formes. Nous pouvons citer le « phising » ou « l’hameçonnage », cette pratique va consister à inciter l’internaute à se connecter sur une page internet, ce qui va permettre d’usurper son identité, cela arrive très fréquemment par mail ou par un lien sur Facebook. On retrouve également le scamming, il s’agit d’une arnaque. Celle-ci consiste par exemple à l’envoi d’e-mails faisant croire à l’internaute qu’il est le grand vainqueur d’un prix, mais que pour recevoir ce dernier, il doit verser une commission. Également, le chantage est particulièrement présent sur internet (notamment sur les sites de rencontres.)
D’autres pratiques font de nombreuses victimes. C’est le cas de « la fraude au président », ici l’escroc va demander la réalisation de différentes opérations, généralement des virements, en se faisant passer pour le président de l’entreprise. Cette demande va se faire par mail ou par appel téléphonique. La victime, du fait de l’importance de l’émetteur du mail, va, dans la panique, réaliser rapidement le virement sans se poser davantage de questions.
Une affaire importante a mis au jour un autre type d’escroquerie, la fraude aux « faux ministres ». Il s’agit de l’affaire du faux « Le Drian ». Deux escrocs se sont fait passer pour l’ancien ministre de la défense français. La fraude était la suivante, en se faisant passer pour le ministre, ils demandaient à des personnalités publiques importantes telles que le roi du Maroc ou encore le président de Total, de fournir une aide financière pour des opérations secrètes de l’Etat française. Pour ce faire, les escrocs se sont servis d’internet et des nouvelles technologies (vidéo skype ou on aperçoit la mise en scène d’un bureau ministériel, appel téléphonique, faux mail). Ils auraient récolté près de 60 millions d’euros avec cette escroquerie la cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 9 septembre 2020, à confirmer l’escroquerie ainsi que les peines de sept et dix ans de prison pour les deux responsables.
Face à la multitude croissante d’escroqueries sur internet, deux solutions : la première consiste nécessairement, dans la continuité de la définition apportée par le Code pénal de l’escroquerie (de manière générale), d’encadrer précisément ces différents agissements sur internet (I). Par ailleurs, il convient également de sensibiliser le public fasse à ces actes (II) : comme on l’a dit, le manque de connaissance est un fait au cœur même de la réussite de ces escroqueries. Des mesures aussi bien préventives que répressives devront donc être mises en place par les pouvoirs publics.
I/ Les conditions de qualification d’escroquerie
A/ Une tromperie, la remise d’un bien, un préjudice
Le délit d’escroquerie doit être distingué du simple mensonge. En effet, le mensonge, bien que punissable en droit civil par le dol, ne l’est pas en droit pénal.
En ce qui concerne l’escroquerie, l’élément matériel est double, cela consiste à la réalisation de manœuvres frauduleuses qui vont provoquer la tromperie qui sera associée à la remise.
Par principe, le mensonge seul n’est donc pas suffisant. Cependant, l’usage d’un faux nom, d’une fausse qualité, de l’abus d’une qualité vraie est retenu. Mais le simple mensonge devra être associé à des manœuvres frauduleuses pour être considéré comme une escroquerie.
Les manœuvres frauduleuses ont pour objet d’amplifier un mensonge, le rendre davantage crédible. Cela va par exemple consister à réaliser une mise en scène, à l’intervention d’un tiers, à la publication du mensonge par voie de presse ou encore par écrit. En principe, le fait de mentir par écrit ou le fait d’écrire un mensonge oral ne constitue pas une manœuvre frauduleuse. Cependant, si l’écrit est objectivement de nature à renforcer la vraisemblance du mensonge par ses caractéristiques propres alors il s’agira de manœuvre frauduleuse susceptible de qualifier l’infraction d’escroquerie.
Les escrocs combinent souvent ces différentes possibilités de tromperie en les utilisant de manière conjointe ou successive. Mais juridiquement, un seul de ces moyens suffit pour constituer l’infraction.
Pour pouvoir qualifier l’infraction, il devra être démontré que les moyens mis en cause ont bien été antérieurs à la remise du bien. Également, il faut que la remise soit due aux manœuvres frauduleuses. Il s’agira de démontrer le lien de causalité entre les manœuvres frauduleuses et la remise.
L’article 313-2 du Code pénal prévoit une liste de circonstances aggravantes. Pour les cas mentionnés, les peines seront portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende. Sera par exemple considéré comme une circonstance aggravante le fait de porter atteinte à une personne « dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ». Est également constitutif d’une circonstance aggravante le fait pour une personne de prendre « indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public », comme c’était le cas dans l’affaire « du faux Le Drian »
Enfin, comme c’est également le cas dans l’affaire précitée, les peines seront portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 million d’euros d’amende lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée.
Sur la remise, celle-ci doit avoir été effectuée par la victime, doit porter sur un bien ou un service qui va par la suite causer un préjudice. La remise peut correspondre à des fonds, des valeurs, un bien quelconque ou la fourniture d’un service. Ainsi, elle peut donc revêtir différentes formes.
Également, cette remise doit exister, en effet si la personne découvre à temps le mensonge, et qu’elle ne remet donc pas le bien, alors l’escroquerie ne sera pas consommée. (cependant, si la personne est trompée, même en l’absence de remise, alors il faudra aller sur le terrain de la tentative).
Sachez toutefois qu’il est indifférent de savoir par qui la remise a été faite et à qui elle est faite. En effet, la remise du bien peut être effectuée par une autre personne que celle qui en subit le préjudice. Le préjudice subi par la victime est totalement indépendant du profit réalisé par l’escroc. Il est aussi indifférent que le bien remis l’ait été à titre de prêt ou de transfert total de propriété. Par ailleurs on ne tient pas compte du fait que l’escroc soit le seul bénéficiaire ou non de la tromperie.
La remise doit donc être faite au préjudice de son auteur, au de celui d’un tiers. Le préjudice pourra être matériel ou moral. Mais l’escroquerie doit nécessairement causer un préjudice.
B/ Nécessité de la volonté de tromper
L’escroquerie étant naturellement une infraction intentionnelle (article 121-3 du Code pénal). Il sera donc nécessaire de pouvoir établir l’intention coupable de l’auteur présumé.
Il convient de préciser que la simple imprudence ne suffira pas à caractériser l’infraction d’escroquerie. À titre d’exemple, le fait pour une personne d’avoir utilisé un nom qu’elle pensait sincèrement être autorisée à revêtir ne fait pas d’elle un escroc.
Les juges du fond apprécieront souverainement la bonne ou la mauvaise foi de l’auteur présumé. Cette intention coupable se déduira de manière générale du comportement de l’auteur.
Dans le cas de l’escroquerie portant sur l’activité de « maraboutage » l’accusé invoquera sa bonne foi en affirmant qu’il croit en ses pouvoirs surnaturels. Le juge devra donc examiner les différents procédés mis en œuvre par le marabout pour obtenir une remise. Et juger si cela constitue des manœuvres frauduleuses. Il convient de préciser que le mobile de l’escroc est indifférent dans l’appréciation de l’escroquerie. Enfin, il n’y a pas non plus lieu de s’intéresser à l’usage qui peut être fait par l’escroc du bien remis.
II/ Internet en tant que nouveau moyen d’escroquerie
A/ Une prise de conscience politique
Différentes raisons ont amené à l’augmentation de la cybercriminalité et notamment à l’explosion des escroqueries. Premièrement, la crise économique a joué un rôle important, en effet, cela à attirer de nombreuses personnes désireuses de trouver une bonne affaire. Plus récemment, la crise du Covid-19 s’est accompagnée d’une utilisation très importante des outils informatiques. Ainsi, cela a favorisé l’augmentation des infractions de la cybercriminalité, et par conséquent, le nombre de victimes
Le gouvernement a mis en place en 2009 la plateforme PHAROS (la Plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements) pour lutter contre la cybercriminalité. Cette plateforme permet aux internautes de signaler des contenus illicites sur internet. Cette plateforme vient permettre de centraliser les signalements des internautes.
Le signalement se fait à l’adresse suivante : https://www.internet-signalement.gouv.fr/PharosS1/
L’internaute pourra donc signaler aux pouvoirs publics via ce site les escroqueries en ligne ou d’autres comportements (incitation à la haine raciale, pédopornographies …)
Il est tout de fois précisée sur la plateforme dans la rubrique « FAQ » que sont exclus les contenus simplement « immoraux » ou jugés « nuisibles ». A titre d’illustration, le spam ne doit pas faire l’objet d’un signalement sur la plateforme PHAROS. Ce signalement devra être fait sur la plateforme suivante : https://www.signal-spam.fr.
La mise en place d’une plateforme de signalement s’inscrit dans l’objectif poursuivi par le ministère de l’Intérieur de sensibiliser et de venir en aide aux personnes victimes d’escroquerie en ligne.
B/ Des moyens de se prémunir
Il convient de revenir sur deux cas particulièrement fréquents d’escroqueries sur internet et de parler des moyens de se prémunir contre ces dernières. Il s’agit de l’hameçonnage et de l’escroquerie dite « à la nigériane ».
Premièrement, concernant l’hameçonnage, il s’agit d’une technique que les fraudeurs vont utiliser pour obtenir de leurs victimes des renseignements sur leurs informations personnelles. Cela est réalisé dans le but d’usurper l’identité de la victime.
Pour ce faire, les fraudeurs vont faire croire à la victime qu’elle converse avec un tiers de confiance (par exemple une banque). Ainsi, la victime en confiance, va fournir des informations personnelles.
Vont être les cibles : les services de banque en ligne, les fournisseurs d’accès à internet, les services de ventes aux enchères tels qu’eBay, ou encore, très fréquemment les services tels que PayPal.
Généralement, les escrocs passent le plus souvent par le biais de courriels, il vise un large public avec l’envoi massif de ces derniers à de nombreuses victimes potentielles. La victime aura donc l’impression que le message provient d’une source fiable, d’une grande société. Le message sera particulièrement alarmant, et exigera de la victime qu’elle agisse rapidement.
Par exemple, un message indiquera à la victime que son compte a été désactivé, et que la réactivation de celui-ci ne sera possible qu’après avoir fourni certaines informations ou effectuer certaines démarches. Le message va alors fournir un hyperlien qui va directement rediriger l’utilisateur vers une page Web qui ressemble fortement au vrai site de la société jugée digne de confiance. Ainsi, une fois sur cette page, l’utilisateur sera invité à saisir des informations personnelles, confidentielles, elles seront directement enregistrées et récupérées par l’escroc.
Pour lutter contre ce type de sollicitation, il faut veiller à vérifier l’adresse web qui s’affiche dans la barre du navigateur, vérifier qu’il s’agit d’un site sécurisé. En effet une attaque consiste le plus souvent à utiliser un nom de domaine mal orthographié contrefaisant un nom de domaine réputé, dans le but d’induire la victime en erreur.
Également, il convient de faire preuve de prudence et de ne pas transmettre ses coordonnées bancaires lorsque celles-ci sont demandées par mail. Une banque ne vous demandera jamais vos coordonnées bancaires par courriel.
Enfin, dès lors que vous avez un doute, prenez contact avec votre banque pour vérifier la fiabilité de la demande.
Si vous constatez que votre carte bancaire fait l’objet d’une utilisation frauduleuse, vous devrez dans un premier temps le signaler le plus rapidement possible à votre banque. Ensuite, il faudra se rendre au commissariat de police ou de gendarmerie le plus proche de votre domicile afin de porter plainte.
Vous devrez alors vous munir d’une pièce d’identité, de votre relevé bancaire sur lequel figurent les paiements contestés, et les coordonnées de votre banque et des références de votre carte bancaire.
Après avoir déposé plainte, une enquête sera alors ouverte puis transmise au procureur de la République.
Pour finir, nous allons donc évoquer l’escroquerie dite « à la nigériane ».
Cette escroquerie va consister à demander à la victime une somme d’argent. L’escroc va alors inventer un scénario pour obtenir cette somme. Les messages envoyés aux victimes proviennent en réalité de l’étranger.
De nombreux scénarios existent, il y aura par exemple des mises en scène personnalisées à l’appui desquelles de faux professionnels, tels que de faux notaires, remettent de faux documents officiels, tels que de faux chèques bancaires.
Pour venir renforcer la vraisemblance du scénario, des faux sites bancaires ainsi que de fausses coordonnées d’avocats, d’huissiers de justice ou de notaires vont être utilisés par les fraudeurs.
Pour lutter efficacement contre ces arnaques, il convient d’adopter les mêmes conseils que pour l’ « hameçonnage ».
Pour rappel, si vous êtes victime d’une escroquerie sur Internet, n’attendez pas et déposez plainte au commissariat ou à la gendarmerie la plus proche.
Prémunissez-vous alors de tous les renseignements pouvant être utiles, tels que les références des transferts d’argent effectués, les références des personnes contactées.
N’oubliez pas que tout renseignement apporté pourra s’avérer utile et permettra d’aider que vous à l’identification de l’escroc.
Pour lire une version plus complète de cet article sur l’escroquerie sur internet, cliquez
Source :
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2020/09/09/escroquerie-au-faux-le-drian-deux-hommes-condamnes-a-sept-et-dix-ans-en-appel_6051555_1653578.html
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI00000641819
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028394778