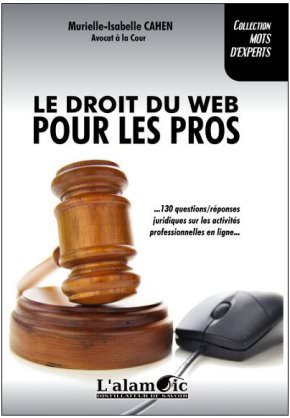17 Nov 2021
EXIGENCE DE DISTINCTIVITE DU SIGNE POUR LE DEPOT D’UNE MARQUE
Le législateur français accorde une protection spécifique à la marque en France . Néanmoins, des conditions sont énumérées afin de bénéficier de la protection de la marque. Ainsi, il exigé par le législateur, l’existence de distinctivité du signe pour que la marque puisse valablement être déposée.
Le dépôt de votre marque vous permet d’identifier l’origine de vos produits ou services auprès des consommateurs.
Le consommateur identifie ainsi la marque aux produits ou services concernés lors de son achat.
Pour qu’elle soit enregistrée, votre marque doit remplir un certain nombre de conditions.
La marque doit en effet être licite, disponible, et distinctive.
Il convient de s’attacher ici à la condition de distinctivité de votre marque.
Le CNCPI apporte une définition assez claire de cette condition : il précise que « le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services qu’il entend distinguer, et au moment du dépôt de cette marque. En effet, une marque doit permettre de distinguer l’origine d’un produit ou d’un service d’une entreprise ou d’un particulier de ceux de ses concurrents ».
L’ancien article L711-2 du Code de la Propriété intellectuelle s’attachait d’ailleurs à rappeler et encadrer cette définition. La distinctivité d’une marque est sa raison d’être. Le nouvel article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle et l’article 4 du Règlement sur la marque de l’Union européenne réaffirment que celle-ci sert à distinguer les produits et les services.
L’exigence de distinctivité du signe pour le dépôt d’une marque est expliquée par le fait qu’il est impératif qu’aucune personne ne puisse se réserver l’utilisation d’une marque qui serait indispensable ou au moins utile aux concurrents.
Ainsi, les types de marques, non distinctives, doivent rester à la disposition de tous afin de préserver la liberté de la concurrence.
Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?
Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63
ou contactez-nous en cliquant sur le lien
L’exigence de distinctivité n’existe qu’en relation avec les produits ou services que vous voulez commercialiser.
Il n’est pas nécessaire que le terme que vous choisissez soit nouveau pour que votre signe soit distinctif.
I. Les conséquences de la condition de distinctivité
A) L’exclusion des marques nécessaires, génériques, usuelles ou descriptives
L’ancien article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle prévoyait l’exigence de distinctivité.Désormais, elle est prévue dans l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle. Ce nouvel article dispose que le signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection. À ce titre, certaines questions pourraient se poser, à savoir dans quelle condition une odeur ou un goût utilisé à titre de marque pourrait faire l’objet d’une représentation précise dans le registre.
L’ancien texte énumère les signes que vous ne pouvez pas enregistrer, car ils sont dépourvus de ce caractère distinctif.
Il est vrai que l’article L. 711-2, dans sa version antérieure, prévoyait déjà la majorité des motifs de refus d’enregistrement ou d’annulation d’une marque, la version réformée ajoute à ces motifs l’utilisation d’une dénomination de variété végétale antérieure, d’indication géographique ou d’appellation d’origine.
Le point 4) de l’article, L.711-2 exclut ainsi « une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications devenues usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ».
Même si le texte emploie des qualificatifs différents les juges n’y accordent que peu d’importance, car ceux-ci peuvent se recouper.
Il suffit simplement de retenir que la marque ne doit pas être constituée ni par un signe dont l’utilisation est impérative pour désigner le produit parce qu’elle le désigne, ni par un signe définissant le genre ou la catégorie dont il relève.
Sachez qu’il est indifférent qu’un signe appartienne au langage courant ou professionnel.
C’est dans sa relation avec le produit ou service concerné que le texte s’applique.
Une marque que vous aurez choisie pourra donc être refusée même si le signe en cause ne concerne que votre secteur d’activité.
Cependant, rien ne vous interdit de choisir un signe qui évoque le produit de manière plus ou moins directe ou astucieuse.
À titre d’exemple, la marque Peau d’Ange a été jugée valable pour des produits cosmétiques (CA Paris, 12 janvier 2001).
Le choix d’un signe évocateur peut vous être utile dans le sens où il permettra d’accentuer votre impact psychologique sur le consommateur notamment dans la publicité.
Comme la distinctivité s’apprécie par rapport au langage courant ou professionnel, même un terme peu connu du grand public peut être considéré comme dénué de caractère distinctif s’il est générique dans votre secteur d’activité.
Si vous optez pour des termes étrangers, vous devez vérifier si le signe en cause est entré dans le langage courant ou professionnel et s’il est compris par une large fraction du public concerné.
Si c’est le cas, il ne pourra pas être enregistré en raison de son défaut de distinctivité.
De surcroît, vous ne pourrez pas vous retrancher derrière le fait que vos produits sont uniquement destinés à l’exportation.
L’appréciation se fait au moment de votre dépôt eu égard au public concerné dans le pays auquel vous procédez au dépôt.
S’agissant du cas de la marque communautaire, comme elle a vocation à produire des effets sur tout le territoire de l’Union européenne, il suffit que la marque que vous ayez choisie soit générique dans un seul État membre pour être exclue de l’enregistrement.
Il vous est toujours possible de déposer une marque composée d’un signe générique si vous y rajoutez un nouvel élément.
À titre d’exemple, vous ne pourrez pas déposer le signe Agenda pour désigner des agendas, mais vous pourrez obtenir une protection si vous optez pour une marque telle qu’Agenda XY (Cour cass, 24 janvier 1995).
Néanmoins, il faut savoir que, comme ce type de signe n’est pas doté d’une grande distinctivité, vous ne pourrez pas vous opposer à l’utilisation par vos concurrents de la partie de votre signe considérée comme générique.
Dans le cadre de notre exemple, le titulaire de la marque Agenda XY ne peut pas s’opposer à l’emploi du terme agenda par ses concurrents dans leurs publicités.
Le point 3) du nouvel article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle excluait, lui, les signes « pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service ».
Là aussi cette exclusion s’explique par un but d’intérêt général.
Il s’agit d’éviter que vous ou un de vos concurrents puisse se réserver une marque décrivant un trait caractéristique des produits ou services en causes, afin que le signe puisse être librement utilisé par tous ceux qui proposent le même type de produits ou services.
De surcroît, il faut savoir que cette exclusion est applicable même si le signe que vous avez choisi a des synonymes (CA Paris, 12 septembre 2003).
Comme précédemment dans le cas d’une marque communautaire, vous devez choisir un signe que sera descriptif dans aucun État membre.
On pourra vous opposer la nullité de votre marque communautaire pour défaut de distinctivité même si le signe est jugé descriptif dans la langue d’un seul État membre.
Dans un arrêt, rendu le 18 septembre 2019, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) énonce que dès lors que la renommée d’une marque communautaire antérieure est établie sur une partie substantielle du territoire de l’Union, et qui peut, éventuellement, coïncider avec le territoire d’un seul État membre, il est force de constater que cette marque jouit d’une renommée dans toute l’Union européenne.
Ainsi, il ne sera pas exigé du titulaire de cette marque la production de la preuve de cette renommée sur le territoire de l’État membre dans lequel la demande d’enregistrement de la marque nationale postérieur qui l’objet d’une opposition a été déposée. (2)
À cet égard, rien ne vous empêche de choisir un signe qui évoque ou suggère plus ou moins directement une caractéristique d’un produit ou service.
À titre d’exemple, ont été admises les marques Double Douceur pour des produits laitiers (CA Paris, 13 novembre 1996) ou Espace pour un fameux véhicule spacieux (CA Versailles, 10 mars 1995).
B) L’exclusion des marques constituées par la forme du produit
Existe également la possibilité d’enregistrer comme marque des formes tridimensionnelles à condition qu’elle respecte les conditions posées par la loi.
Ainsi, afin d’enregistrer une forme comme marque, celle-ci ne doit pas être imposée par la nature ou la fonction du produit, ou ne pas conférer au produit sa valeur substantielle.
L’exclusion de la forme imposée par la nature ou la fonction du produit était prévue au point 5) du nouvel article L 711-2 du CPI.
Il faut savoir que les juges assimilent à la forme du produit la forme de l’emballage de ceux-ci.
Pour que l’enregistrement soit exclu, cela doit être les caractéristiques essentielles de la forme considérée qui doivent répondre à une fonction technique.
Vous ne pourrez pas échapper à l’exclusion si vous rajoutez des caractéristiques secondaires lorsque les caractéristiques considérées comme essentielles par le juge répondent à une fonction technique.
Le juge décidera souverainement s’il s’agit de caractéristiques essentielles ou non.
Enfin vous serez encore soumis à l’exclusion même si vous démontrez que d’autres formes peuvent mener au résultat technique (Cour cass, 21 janvier 2004).
L’exclusion de la forme conférant au produit sa valeur substantielle est prévue au point 5) de l’article L 711-2.
Par exemple, vous ne pourrez pas enregistrer comme marque la forme d’une montre lorsque vous souhaitez en vendre.
II. L’appréciation de la distinctivité de la marque par le juge
A) Les critères d’appréciation utilisés
Ce sont l’office national de propriété intellectuelle chargée de l’examen de la demande d’enregistrement, ou le juge dans le cadre d’une demande en nullité de votre marque, qui apprécie la distinctivité de votre signe.
L’office national pour la France est l’Institut National de la Propriété intellectuelle (OMPI).
Pour une marque communautaire, l’office compétent est l’Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle.
Selon la jurisprudence un signe constitué de plusieurs éléments non distinctifs ne sera soumis à l’exclusion que s’il correspond exactement à la façon dont le public concerné désigne habituellement le produit ou l’une de ses caractéristiques (CJCE, Baby dry 20 octobre 2001).
En effet vous pouvez combiner des éléments qui ne sont pas distinctifs lorsqu’en raison de la combinaison que vous avez effectuée, la marque crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion d’éléments non distinctifs.
Cependant, sachez que si vous optez pour une combinaison d’éléments non distinctifs, votre marque sera considérée comme une « marque faible ».
Comme sa distinctivité restera faible, il sera plus facile pour un concurrent de vous opposer la nullité de votre marque dans le cadre d’une action en contrefaçon, ou encore il vous sera tout simplement plus difficile de prouver la contrefaçon de votre marque.
Enfin, sachez que vous ne pouvez pas arguer du fait que votre marque a été valablement enregistrée une première dans un État membre de la communauté.
En effet chaque office national des pays membres de l’Union européenne est indépendant les uns des autres et obéit à ses propres règles.
Toutefois l’autorité nationale pourra tenir compte de cela mais sans être obligée de suivre la décision du premier office.
On pourrait penser qu’invoquer le principe de l’égalité de traitement permettrait l’enregistrement de votre marque, mais comme ce principe doit être concilié avec le respect de la légalité, cet argument n’est pas pertinent.
En effet le respect de la légalité implique que personne ne peut « invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique ».
B) La possibilité d’acquérir la distinctivité par l’usage de votre marque
Auparavant, l’ancienne version de l’article L 711-2 du CPI prévoyait encore la possibilité d’acquérir la distinctivité pour votre marque grâce à l’usage que vous en faites. La nouvelle version de l’article, quant à elle, réaffirme cela et dispose que : « Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, le caractère distinctif d’une marque peut être acquis à la suite de l’usage qui en a été fait ».
C’est l’hypothèse où votre marque était dénuée de distinctivité lors de son enregistrement et qu’un concurrent demande ainsi la nullité de celle-ci.
C’est alors à vous d’établir l’acquisition de la distinctivité lors de l’instance.
Afin de bénéficier de cette disposition, il faut que vous prouviez que, grâce à l’usage que vous avez fait de votre marque, elle a pris une nouvelle signification dans l’esprit du public.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) affirme, dans un arrêt rendu le 25 juillet 2018, la nécessité de démontrer l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage afin d’enregistrer une marque qui était antérieurement dépourvue de ce caractère.
La CJUE énonce également l’impossibilité d’enregistrer en tant que marque de l’Union européenne, un signe dépourvu de caractère distinctif intrinsèque sauf s’il est prouvé qu’il a acquis un caractère distinctif dans la partie de l’Union où il n’avait pas auparavant un tel caractère. (3)
L’acquisition de la distinctivité doit nécessairement être prouvée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne pour une marque communautaire.
Sachez que pour prouver cette acquisition il faudra vous appuyer notamment sur l’intensité, la durée et l’étendue géographique de votre usage.
Il est possible de se fonder sur la part de marché que vous détenez, l’importance des investissements que vous avez réalisés pour promouvoir votre marque, ou encore la proportion des consommateurs qui identifie votre marque et le produit qui y est attaché.
Néanmoins, même si vous arrivez à démontrer l’acquisition de la distinctivité par l’usage, vous êtes protégés seulement contre une marque dont l’utilisation a débuté après la date à laquelle votre marque a acquis son caractère distinctif.
Cela dit, pendant la période intermédiaire, entre le moment de l’enregistrement de votre marque et celui où vous prouvez sa distinctivité, vous ne pouvez pas agir contre un concurrent en contrefaçon.
Pour lire une version plus complète de cet article sur la distinctivité d’une marque, cliquez
Sources:
- : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381542/2021-11-16
- CJUE 29 sept. 2019, aff. C-728/18
- https://www.actualitesdudroit.fr/browse/affaires/droit-economique/15050/preuve-de-l-acquisition-du-caractere-distinctif-par-l-usage-d-une-marque-depourvue-de-caractere-distinctif-intrinseque