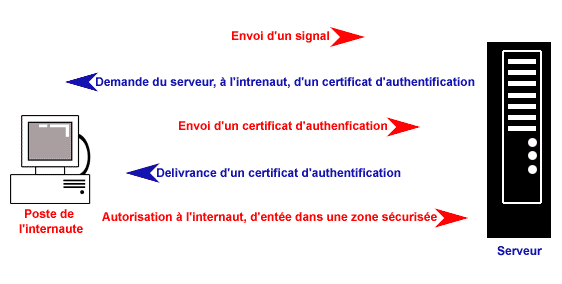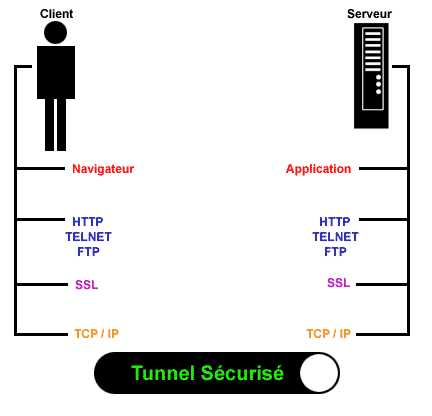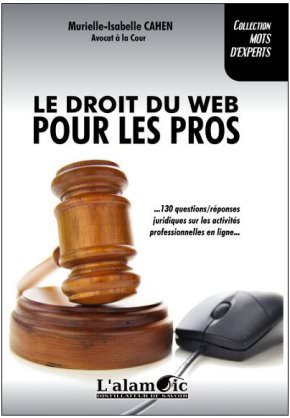3 Mar 2023
Etre en conformité avec le RGPD et l’accountability
Le Règlement général sur la protection des données (« RGPD ») est le nouveau texte phare en matière de protection des données personnelles en Europe. Prévu pour entrer en application le 25 mai 2018, le délai de mise en conformité est court et pourtant trop peu d’entreprises sont au courant des dispositions en la matière.
Le droit européen a instauré un cadre juridique qui se veut « stable » pour l’ensemble de l’Union européenne. Le texte a pour objectif, comme le rappelle la CNIL, de renforcer le droit des personnes au regard du traitement de leurs données à caractère personnel, tout en responsabilisant les traitants et sous-traitants de ces données.
Me CAHEN Murielle, Avocat, peut être choisi par une société pour être Avocat agissant en tant que délégué à la protection des données .
L’avocat délégué à la protection des données a un rôle de conseil et de sensibilisation sur les nouvelles obligations du règlement (notamment en matière de conseil et, le cas échéant, de vérification de l’exécution des analyses d’impact).
« Privacy by Design » signifie littéralement que la protection des données personnelles doit être prise en compte dès la conception du produit ou du service.
Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de rgpd ?
Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63
ou contactez-nous en cliquant sur le lien
Entré en vigueur en mai 2018, le règlement général sur la protection des données (RGPD) fêtera bientôt ses cinq ans. Qu’importe votre situation, si vous collectez des données, une démarche de mise en conformité au règlement devra être initiée.
Afin d’en saisir les contours, cette démarche peut s’appuyer sur la désignation d’un délégué à la protection des données qui se chargera de mettre en œuvre la conformité au règlement européen sur la protection des données pour votre organisme.
La promulgation de ce règlement a permis d’harmoniser le cadre juridique pour l’ensemble de l’Union européenne. Ce texte a, dans un premier temps, permis de renforcer le droit des personnes au regard du traitement de leurs données à caractère personnel.
Dans un second temps, le RGPD a été conçu pour être un rempart face aux dérives et aux risques que les traitements de données peuvent représenter. Pour se faire, il introduit de nouvelles obligations et de nouvelles notions. On pensera par exemple à la notion d’accountability et de privacy by design qui ont pour objectif de responsabiliser les organismes afin de rendre plus effective la protection des données.
Les données sont aujourd’hui des sources de valeur considérable. Elles représentent non seulement des actifs pour les entreprises, mais elles sont également un moyen d’assurer la continuité de leurs activités. Comme le souligne l’ENISA, entre 2021 et 2022, on comptabilise environ une attaque par rançongiciel toutes les onze secondes sur l’ensemble des entreprises situées sur le territoire européen.
Au regard des dangers qui pèsent aujourd’hui sur les entreprises, l’ensemble des dispositions du texte se devront d’être comprises par ces dernières (I) afin d’organiser de manière rapide et efficace leur mise en conformité (II).
I. Le cadre juridique instauré par le RGPD , le régime d’accountability et Privacy by Design
Le texte européen entré en vigueur le 25 mai 2018, prévoit de nouvelles obligations pour les entreprises et, plus largement, tous traitants ou sous-traitants de données à caractère personnel (a). Le non-respect de ces obligations entraîne désormais des sanctions plus lourdes que par le passé (b), dans une volonté non dissimulée d’atteindre un cadre harmonisé.
A) Des obligations nouvelles pour les entreprises et en particulier l’accountability et le « Privacy by Design »
L’entrée en vigueur du texte en mai 2018 renouvelle le cadre de la protection des données et des relations entre ceux qui les fournissent et ceux qui les traitent.
Selon son article 3, ce règlement a vocation à s’appliquer aux entreprises qui traitent des données à caractère personnel, que celles-ci soient établies sur le territoire de l’Union européenne (principe d’établissement) ou non, dès lors que les données traitées concernent les personnes qui se trouvent sur le territoire de l’Union européen (principe de ciblage).
Ce texte insère de nouvelles notions telles que la « Privacy by Design ». Définie à l’article 25 du RGPD, cette notion correspond à la prise en considération de la protection des données dès la conception d’un traitement. Il s’agit aussi bien de la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées, telles que la pseudonymisation. Ces mesures sont destinées à mettre en œuvre les principes relatifs à la protection des données.
Elles s’accompagnent des principes énoncés par le règlement, tel que le principe de minimisation des données (notamment pour les données sensibles). Ces mesures visent à assortir le traitement des garanties nécessaires afin de répondre aux exigences fixées par le règlement et tendent à assurer une protection effective des données de la personne concernée.
D’autres points essentiels du ressortent du Règlement, à commencer par la « consécration » du droit à l’oubli. Pour commencer, le texte amène la « consécration » du droit à l’oubli » , déjà soutenu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Google Spain qui précisait qu’un traitement de données pouvait devenir « avec le temps incompatible avec la directive lorsque ces données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées » .
Les données devront être conservées aussi longtemps que nécessaire et leur accès, leur modification, leur restitution jusqu’à leur effacement sur la demande des individus concernés, devront être garantis.
De même, le texte prévoit que les entreprises devront veiller à ce que seules les données nécessaires à la finalité en cause soient collectées.
Également, les entreprises devront s’assurer du consentement éclairé et informé des individus quant à la collecte et au traitement de leurs données, consentement qu’elles devront pouvoir recueillir et prouver.
Ainsi, les organismes à l’origine d’un traitement de données tel que défini à l’article 4 du règlement, se devront de respecter et d’établir, le cas échéant, les durées de conservation des données. Une liste de mesures à prendre en compte lors de l’établissement d’un traitement de données est disponible à l’article 5.
Par ailleurs, les organismes devront répondre aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées. Énoncés au chapitre III, ils devront lorsque la demande en sera faite, garantir l’accès, la modification, la restitution voire l’effacement des données de la personne concernée.
De plus, ils devront à chaque traitement s’assurer d’avoir recueilli le consentement de la personne concernée comme prévu aux articles 7 et 8 du Règlement.
Pour qu’un traitement de données soit considéré comme licite lorsque le consentement n’est pas demandé, l’organisme doit s’assurer d’être dans son bon droit en établissant l’existence d’une base légale conformément à l’article 6.
Pour commencer, le traitement peut intervenir dans le cadre d’une relation contractuelle ou d’une obligation légale. Il peut également être considéré comme licite lorsqu’il vise l’intérêt général ou la sauvegarde des intérêts vitaux d’une personne. Enfin, il peut s’agir du recours au motif légitime, condition abstraite et très peu utilisée en pratique.
Dans le cas contraire, le traitement (la conservation, l’utilisation, la revente, l’analyse, etc.), n’est pas licite et peut par conséquent faire l’objet de sanction.
Enfin, le texte prévoit également des mesures concernant le respect du droit à la portabilité des données, la mise en place d’un cadre strict pour un tel transfert en dehors de l’Union ainsi que l’obligation pour les entreprises d’informer le propriétaire des données ainsi que la CNIL d’une violation grave des données ou d’un piratage , dans les 72 heures.
B) Des risques accrus pour les entreprises en cas de non-conformité
Depuis l’entrée en vigueur du RGPD de nombreuses formalités auprès de la CNIL ont disparu. En contrepartie, la responsabilité des organismes a été renforcée. Ils doivent en effet assurer une protection optimale des données à chaque instant.
La tâche revient également aux entreprises, en marge des obligations précitées, de veiller à ce que les données soient à tout moment et en tous lieux sécurisés contre les risques de perte, de vol, de divulgation ou contre toute autre compromission.
C’est notamment le cas lors du choix des prestataires informatiques. Les organismes ont un devoir de vigilance et d’information envers les personnes concernées (autrement dit, les personnes dont les données font l’objet d’un traitement).
« Privacy by Design » signifie littéralement que la protection des données personnelles doit être prise en compte dès la conception du produit ou du service.
Pour toute violation de ces dispositions, le texte prévoit notamment des amendes administratives, pouvant s’élever jusqu’à 20 millions d’euros « ?ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent? ».
C’est également l’entreprise qui devra indemniser toute personne lésée matériellement ou moralement par un traitement non conforme de ses données, cette fois-ci sans plafonnement.
Si tel n’est pas le cas, une mise en conformité rapide de votre organisme s’impose donc.
Le RGPD a en effet pour but d’unifier le cadre légal européen en la matière, et tend même à obliger les plus réticents à « jouer le jeu » : on sait que les grandes entreprises comme Google ou Facebook ont déjà été, à plusieurs reprises, rappelées à l’ordre par les CNIL européennes. Les dernières décisions rendues en la matière témoignent de la volonté de faire respecter ce règlement.
La CNIL est venue sanctionner de nombreuses entreprises depuis l’instauration du RGPD, en raison de leur manque de mise en conformité avec le règlement. La sanction la plus importante fut celle de Google, dans une décision du 21 janvier 2019 où la CNIL a prononcé une amende d’un montant total de 50 millions d’euros.
Cette décision fut confirmée par le Conseil d’État dans une décision du 19 juin 2020, qui considère que l’amende de 50 millions d’euros n’était pas disproportionnée.
Après avoir effectué le bilan de son action répressive, la CNIL affirme que l’année 2021 a été un record tant par le nombre de mesures adoptées que par le montant cumulé des amendes, qui atteignait 214 millions d’euros.
L’année 2022 a aussi été marquée par une importante réforme des mesures correctrices de la CNIL, ce qui lui permet d’envisager un traitement plus rapide des plaintes (toujours plus nombreuses) et donc des sanctions.
Cette réforme témoigne de la volonté de donner plus de moyens à la CNIL et de durcir la répression cinq ans après l’entrée en application du RGPD.
Cette décision fut suivie de nombreuses autres amendes pour manquement au RGPD, mais jamais avec un montant aussi élevé. Ainsi dans une décision du 28 mai 2019, l’absence de contrôle des accès aux données conservées par un site internet fut sanctionnée à hauteur de 400 000 euros d’amende.
Dans une décision du 13 juin 2019, l’amende n’a pas dépassé 20 000 euros. Encore récemment, un manquement aux articles 32 et 33 du RGPD fut sanctionné par la CNIL à une amende de 3 000 euros. L’article 32 du RGPD prévoyant l’obligation d’assurer un niveau de sécurité adapté aux risques, en ayant recours à des mesures techniques et organisationnelles appropriées.
Une mise en conformité rapide des entreprises s’impose donc. Le RGPD a en effet pour but d’unifier le cadre légal européen en la matière, et tend même à obliger les plus réticents à « jouer le jeu », dans la lignée de la décision de la CNIL espagnole du 11 septembre dernier, qui a infligé à l’entreprise Facebook une amende administrative d’un montant de 1,2 million d’euros la collecte et le traitement (notamment à des fins publicitaires) de données sensibles sans le consentement des utilisateurs.
Mais il s’avère que les entreprises n’ont pas forcément conscience de la façon dont elles traitent leurs données, ni même plus généralement de l’intégralité des donnés qu’elles traitent et qui peuvent se trouver sur leurs bases de données .
Le RGPD ne doit pas être perçu comme une « obligation » qui s’impose aux entreprises, mais bel et bien comme un élément pour se démarquer du reste des prestataires. Repousser sa mise en conformité revient à repousser un gage de qualité.
Cette transition se doit donc d’être organisée, structurée efficacement, et plusieurs étapes méthodiques apparaissent efficaces dans le suivi de cet objectif.
II. Les étapes de la mise en conformité des entreprises aux nouvelles dispositions
Depuis l’entrée en vigueur de cette réglementation, il convient pour les entreprises et, plus largement, tout responsable de traitement ou sous-traitant de données à caractère personnel, d’initier si tel n’est pas le cas, un processus de mise en conformité. À cet égard, le délégué à la protection des données (A) jouera le rôle de celui en charge d’accompagner l’entreprise dans les différentes étapes (B) de cette transition.
A) Le délégué à la protection des données, « chef d’orchestre » de cette mise en conformité par rapport à l’accountability et le « Privacy by Design »
Même si elle n’est pas obligatoire pour tous les organismes, la désignation d’un pilote paraît essentielle au regard des tâches à accomplir par les entreprises dans le cadre de leur mise en conformité avec le RGPD.
On distingue plusieurs cas dans lesquels la désignation d’un délégué à la protection des données est obligatoire (article 37 du RGPD).
Ainsi la désignation est obligatoire pour les organismes publics et pour toute entreprise responsable du traitement de données sensibles ou de traitement à grande échelle doit désigner un délégué à la protection des données. Il peut s’agir par exemple des ministères, des collectivités territoriales ou encore des établissements publics. En avril 2022, ce sont vingt-deux communes qui ont été mises en demeure par la CNIL afin qu’elles désignent un délégué à la protection des données.
En outre, la désignation s’impose aussi pour les organismes dont les activités de base les amènent à réaliser un suivi régulier et systématique des personnes à grande échelle. Cela peut correspondre aux compagnies d’assurance ou aux banques pour leurs fichiers clients ou les fournisseurs d’accès internet.
Enfin, les organismes dont les activités de base les amènent à traiter à grande échelle des données dites « sensibles » (données biométriques, génétiques, relatives à la santé, la vie sexuelle, l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale) ou relatives à des condamnations pénales et infractions devront également procéder à la désignation d’un délégué à la protection des données.
Publié le 13 décembre 2016 par le G29, les lignes directrices concernant le régime du délégué permettent de caractériser cette idée de « grande échelle » sur des critères tels que le nombre de personnes concernées, le volume des données traitées, la durée de conservation et de traitement des données ou encore l’étendue géographique du traitement.
La désignation d’un pilote paraît essentielle au regard de la mise en conformité des entreprises avec le RGPD. Le délégué à la protection des données ( » DPO « ), au sein de l’entreprise, sera en charge de l’organisation des différentes missions à mener dans l’accomplissement d’un tel objectif.
La désignation de celui-ci est rendue obligatoire pour les organismes publics et pour toute entreprise responsable du traitement de données sensibles ou de traitement à grande échelle.
Néanmoins, la CNIL rappelle que si cette obligation n’incombe pas à certaines entreprises, il est « ?fortement recommandé? » d’effectuer une telle désignation, « le délégué (constituant) un atout majeur pour comprendre et respecter les obligations du règlement » .
Il n’est en effet, pas toujours évident pour une personne étrangère à ce domaine de ne pas cerner les attentes ou les obligations qui découlent de la réglementation. Afin d’être désigné, le délégué doit nécessairement avoir des connaissances juridiques qui lui permettront de rendre intelligible la réglementation auprès de ses collaborateurs.
L’incendie du Datacenter d’OVH illustre parfaitement cette méconnaissance du droit des contrats informatiques. Outre la catastrophe s’abattant sur OVH, un grand nombre de clients avaient souscrit un contrat d’hébergement simple, laissant ces derniers sans possibilité de récupérer leurs données et causant parfois, d’importants préjudices (article avec Me Eric Barbry). La perte de données peut s’avérer fatale pour les plus petites structures, d’où l’importance d’établir un plan de reprise des activités. C’est pourquoi le délégué à la protection des données est un indispensable.
Il ne joue pas qu’un simple rôle de mise en conformité, il joue également un rôle de management des données ce qui permet à la société de comprendre les enjeux de la protection des données. Ce dernier incarne un véritable rôle de conseil, on pourrait presque parler d’un devoir d’information.
Comme le souligne l’article 38 du Règlement, le délégué à la protection des données doit être « associé, d’une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel (5) ».
Précisé à l’article 39, ce « chef d’orchestre » aura la charge de l’organisation des différentes missions à mener dans l’accomplissement d’un tel objectifLe DPO n’a pas nécessairement à être membre de l’entreprise, puisqu’elle peut être liée avec lui sur la base d’un contrat de service. Il est soumis au secret professionnel ou à une obligation de confidentialité.
Le DPO devra jouer le rôle d’un coordinateur, à savoir comprendre et cerner les nouvelles obligations prévues par le texte, et guider le responsable du traitement en fonction.
Ceci étant, le délégué n’endosse pas la responsabilité d’une éventuelle non-conformité du traitant ou sous-traitant des données aux dispositions du Règlement?; il est fortement conseillé pour lui néanmoins de garder les traces de son travail par une documentation précise (notamment dans les cas où l’entreprise n’aurait pas suivi ses recommandations).
B) Les détails du processus de transition pour les entreprises
Une fois le DPO désigné, l’entreprise devra alors engager un processus de transition en trois étapes.
La première consiste à lister de manière précise et concise l’intégralité des données traitées, ainsi que les acteurs de ce traitement.
Pour ce faire, la tenue d’un registre des traitements peut être une solution : l’entreprise y consignera toutes les informations relatives aux traitements et aux traitants, à savoir la nature des données, leur provenance ou encore la manière dont elles sont traitées.
Cependant les registres de traitement sont allégés pour les entreprises de moins de 250 salariés.
Pour rappel, l’obligation de tenir un registre des traitements concerne tous les organismes, publics comme privés, et quelle que soit leur taille, dès lors qu’ils traitent des données personnelles.
Par la suite, il conviendra de prendre les mesures nécessaires pour garantir un traitement respectueux des nouvelles dispositions. Dans un premier temps, il conviendra de s’assurer que ces traitements s’appuient sur des bases légales toujours en vigueur et qu’ils respectent les droits des utilisateurs.
Dans un second temps, il s’agira de procéder à une vérification des mesures de sécurité déployées puis de s’assurer qu’ils respectent les principes liés à la transparence prévus par le texte.
À ce titre, une analyse d’impact sur la protection des données peut s’avérer pertinente : en effet ce type d’étude permet d’évaluer précisément les conséquences du traitement en vigueur dans l’entreprise sur la protection des données et le respect des droits des usagers.
Enfin, la dernière étape consistera pour l’entreprise en une consignation par écrit d’une documentation prouvant la conformité de l’entreprise à la nouvelle réglementation. Il s’agit du processus d’accountability qui se réalise au fur et à mesure de l’exécution des précédentes consignes. Ce processus permet de dresser l’état d’avancement de la mise en conformité en interne, de s’organiser plus facilement et d’assurer un respect en continu de la protection des données traitées.
L’accountability est une démarche permanente qui permet de prouver que le respect des règles fixées par le RGPD.
Pour lire une version plus complète sur la RGDP, cliquez
Sources :
(1) https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-sur-la-protection-des-donnees-ce-qui-change-pour-les-professionnels
(2) http://www.ladn.eu/nouveaux-usages/etude-marketing/rgpd-entreprises-retard-lapplication-reglementation/
(3) Idem
(4)http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d531e9daf43fa64f7b82f3a43da182cc55.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNiMe0?text=&docid=152065&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=500062
(5) https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre4#Article37
(6) https://www.cnil.fr/fr/designer-un-pilote
(7) https://www.cnil.fr/fr/principes-cles/reglement-europeen-se-preparer-en-6-etapes
Décision CNIL 21 janvier 2019
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/san-2019-001_21-01-2019.pdf
Décision Conseil d’Etat, 19 juin 2020, n° 430810
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-06-19/430810
Décision CNIL, 28 mai 2019, SAN-2019-005
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000038552658/
Décision CNIL, 13 juin 2019, SAN-2019-006
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000038629823/
Décision CNIL, 7 décembre 2020, SAN-2020-014
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000042675720