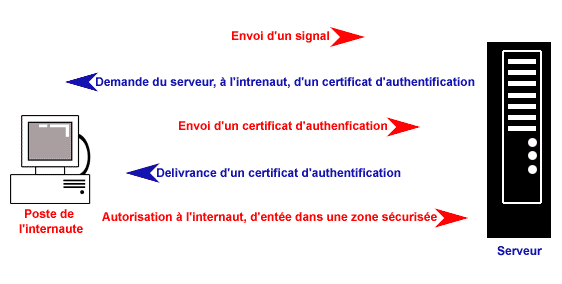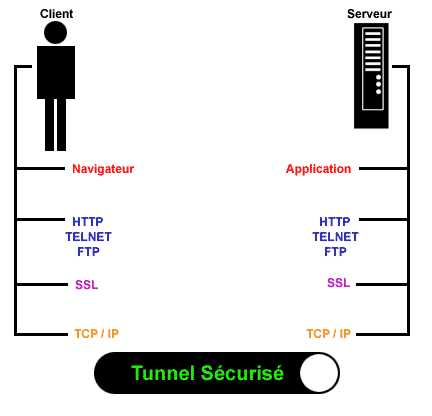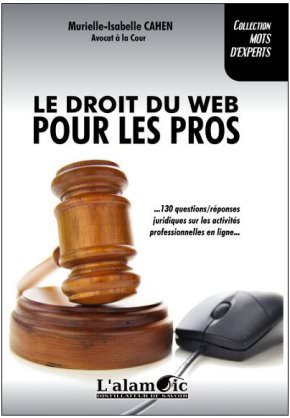18 Fév 2015
Salarié : délit d’email
Aujourd’hui l’email est devenu une mode de communication incontournable notamment au sein de l’entreprise, mais il est alors tentant pour les employeurs de surveiller les correspondances de leurs salariés, mais ces possibilités ont été limitées par le législateur.
Cependant, afin d’éviter des abus, les employeurs peuvent être tentés de placer leurs salariés et leur correspondance sous surveillance.
Ceci nous pousse à nous interroger à la fois sur le régime légal qui est susceptible de s’appliquer à la surveillance du courrier électronique (I) et sur les sanctions éventuelles d’une surveillance irrégulière (II).
I – Le cadre légal de la « cyber-surveillance »
La surveillance du courrier électronique ne fait l’objet d’aucun texte spécifique, mais seulement de décisions de jurisprudence. Il faut donc se demander quelles règles sont applicables.
A – Les principes fondamentaux
Le législateur a mis en place un certain nombre de principes fondamentaux qui bien que non spécifiques à la surveillance du courrier électronique, trouvent à s’appliquer en l’espèce.
Ceux-ci sont de deux types, ceux qui sont favorables au salarié et ceux qui sont favorables à l’employeur.
1 – La protection du salarié
Le droit du travail est traditionnellement favorable au salarié, mais d’autres principes sont aussi favorables à ce dernier.
a – Le Code du Travail
Le code du travail dispose dans son article L.121-8 qu’aucune information ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté à la connaissance du salarié..
L’article L.432-2-1 impose l’information et la consultation du comité d’entreprise avant la mise en œuvre dans l’entreprise de moyens de contrôle de l’activité des salariés.
b – La loi informatique et liberté
Le traitement d’informations sur les salariés si elles sont informatisées, est soumis à déclaration auprès de la C.N.I.L.
Les salariés auront alors un droit d’accès sur les informations les concernant.
Si les informations ont été recueillies sans leur consentement ou leur information
c – Le respect du droit à la vie privée
L’article 9 du Code Civil prévoit un principe général de protection de la vie privée.
Ce principe s’applique évidemment à la vie extraprofessionnelle de l’employé mais aussi dans les rapports de travail.
Certes ce droit est adapté aux nécessités du rapport de travail, mais il n’est pas aliéné par le seul fait du lien de subordination.
L’employeur qui est le cocontractant du salarié doit cependant pouvoir contrôler l’exécution du contrat de travail.
Ce respect du droit à la vie privé constitue une limite aux moyens de surveillance mis en place par l’employeur.
Le problème principal étant de dissocier ce qui relève de la vie privé et ce qui relève du contrôle de l’employeur.
d – Le secret des correspondances
Un des problèmes principaux du courrier électronique est sa nature juridique, en effet aucun texte ne vise expressément le courrier électronique, on s’interrogeait notamment sur l’application éventuelle du secret des correspondances au courrier électronique et notamment à celui transmis sur le lieu de travail.
Un jugement a fixé la position concernant le secret de la correspondance : en effet le tribunal correctionnel de Paris dans un arrêt du 2 novembre 2000 : « Tareg A. » a considéré que la surveillance du courrier électronique par l’employeur était une violation de correspondances effectuées par voie detélécommunication, délit réprimé en l’espèce par l’article L.432-9 du Code Pénal s’agissant d’une personne publique.
Ce délit est réprimé par l’article L.226-15 alinéa 2 du Code Pénal concernant les personnes privées.
Pour la première fois, la Cour de cassation a rendu un arrêt le 2 octobre 2001 sur l’utilisation privée des e-mails au travail. La décision – qui devrait faire jurisprudence – interdit à l’employeur de « prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur ». Cliquer ici pour lire l’arrêt.
2 – Les justifications de l’employeur
a – Les risques de responsabilité
Une des justifications de la surveillance du salarié est paradoxalement une disposition légale favorable au salarié.
L’article 1384 alinéa 5 du Code Civil prévoit la responsabilité civile de l’employeur du dommage causé par ses préposés dans les fonctions auxquelles il les a employés.
L’employeur afin d’éviter de voir sa responsabilité engagée du fait de courrier électroniques indélicats de ses employés peut alors souhaiter exercer un contrôle sur ceux-ci.
b – La sécurité de l’entreprise
Une autre justification pourrait être la sécurité de l’entreprise : l’employeur pourrait souhaiter éviter la divulgation d’informations confidentielles, la transmission de virus, … et contrôler les courriers électroniques afin d’éviter ces problèmes.
B – La mise en place d’une surveillance du courrier électronique
1 – Les préalables
L’employeur afin de pouvoir surveiller son salarié devra le mettre au courant de cette surveillance.
Il devra aussi fixer les limites à l’utilisation du matériel de l’entreprise à des fins personnelles, notamment l’utilisation du courrier électronique sur le lieu de travail.
En limitant l’utilisation du courrier électronique au domaine professionnel, il pourra donc légitimement contrôler ces courriers qui ne seront pas des courriers personnels et donc pas susceptibles d’être protégés par le secret des correspondances.
En pratique, toutes ces dispositions seront intégrées au règlement intérieur. Néanmoins une interdiction absolue de l’usage privé de la messagerie de l’entreprise par les salariés (par une charte) est maintenant interdite au vu de l’arrêt de la cour de cassation précité.
2 – La surveillance elle-même
La surveillance étant prévue par le règlement intérieur ne justifie pas toutes les mesures.
La loi impose en effet une proportionnalité entre les justifications de l’employeur et la surveillance.
La jurisprudence a condamné des entreprises qui pratiquaient de manière systématique des alcootests, des fouilles des salariés.
L’employeur doit donc pratiquer des contrôles qui soient appropriés aux finalités de l’entreprise.
On peut donc penser qu’un contrôle systématique des courriers électroniques envoyés ou reçus par les employés serait sanctionné par un juge, sauf à le justifier par des circonstances particulières (par exemple une société tenue à une haute sécurité par son activité de vente de produits militaires, …)
II – Les sanctions d’une surveillance irrégulière
A – Les personnes susceptibles d’être sanctionnées
On peut se demander en cas de surveillance irrégulière, qui peut être sanctionné.
1 – L’entreprise
Depuis 1994, le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales.
Cependant les textes de loi doivent expressément préciser la possibilité d’une telle responsabilité.
Ce n’est pas le cas pour la violation du secret des correspondances.
Pour la responsabilité civile, celle ci pourra être imputée à l’entreprise pour le paiement des dommages-intérêts.
2 – Le chef d’entreprise
Le chef d’entreprise en tant que responsable de l’entreprise pourra se voir imputer les différentes infractions pénales.
Il pourra aussi, si il a commis une faute, voir sa responsabilité civile engagée.
3 – Le responsable réseau
Le responsable réseau ou informatique de la société qui a mis en place le système de contrôle ou d’interception des courriers électroniques, ou qui aura procédé à ce contrôle, ne pourra pas voir sa responsabilité engagée dans la mesure ou il agit dans le cadre de ses fonctions.
Il pourra cependant voir sa responsabilité engagée s’il n’agit pas dans l’intérêt de l’entreprise et de sa propre initiative.
B – Les sanctions
1 – Sanctions pénales
La violation du secret des correspondances : il s’agit d’un délit pénal prévu par l’article 226-15 du Code Pénal, il est puni d’un an d’emprisonnement et de 300.000 F d’amende.
2 – Sanctions civiles
Les sanctions civiles sont diverses, le préjudice peut être important en fonction du contenu des courriers interceptés.
Si le courrier a été utilisé à des fins de licenciement, le licenciement pourra être requalifié en licenciement abusif et donnera lieu au versement de l’indemnité de licenciement.
3 – Sanctions procédurales
La principale sanction est l’irrecevabilité de la preuve acquise par des moyens irréguliers.
Cette sanction est le résultat d’une jurisprudence célèbre : l’arrêt Neocel rendu par la cour de cassation le 20 novembre 1991.
Cet arrêt est sévère envers l’employeur qui en l’espèce avait installé un dispositif de vidéosurveillance des salariés à leur insu, il avait ainsi prouvé que l’un de ces salariés volait dans la caisse, malgré l’évidence de la preuve, celle-ci a été refusée par la cour pour obtenir le licenciement.
On peut noter tout de même que lorsqu’il s’agit d’une matière pénale (par exemple, si dans l’affaire Neocel l’employeur avait agit au pénal pour vol) la preuve n’est pas écartée d’office, il appartient au juge d’en apprécier la valeur (article 427 du Code de procédure pénale).
On peut citer en ce sens un arrêt du 6 avril 1994 relatif à un détournement de fonds par un salarié au moyen d’un dispositif de vidéosurveillance dissimulé.
ARTICLES EN RELATION :