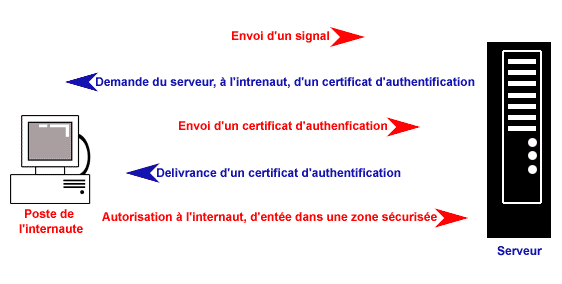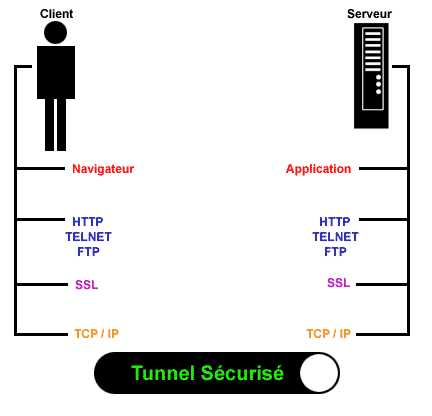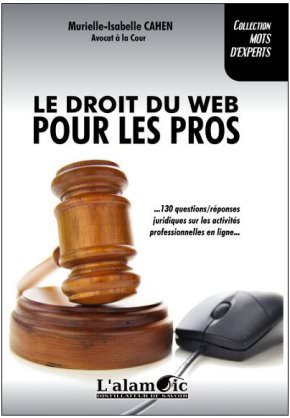4 Jan 2022
LA RESILIATION DE CONTRAT DE MAINTENANCE DE LOGICIEL
Le terme de « maintenance » en lui-même renvoie à un certain nombre de prestations très disparates.
Les prestations portant sur un logiciel vont au-delà de la simple correction des erreurs ou de la prévention des défaillances, que l’on peut respectivement dénommer – sans difficulté – maintenance corrective et maintenance préventive, par symétrie avec ce qui concerne la maintenance des logiciels.
NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire respecter vos droits en matière de contrats en passant par le formulaire !
Il faut aussi que le fournisseur assure son évolution et sa pérennité dans le temps, ce qui implique pour ce dernier, de se livrer à une prestation que l’on appelle improprement la maintenance évolutive, voire la maintenance adaptative, et qui se traduit par la mise au point de versions nouvelles et techniquement ou fonctionnellement différentes du logiciel initial.
La clause objet d’un contrat de maintenance ou suivi de logiciel peut donc prévoir ces différents types de prestations.
la Cour de cassation a jugé que dès lors que le « contrat de maintenance garantissait “un abonnement aux relectures et nouveautés propres à ce programme” et “la fourniture automatique et immédiate de chaque dernière version de ce programme et sa conformité à la législation en vigueur”, le mainteneur avait rempli son obligation de fourniture » puisqu’il avait « fourni le nouveau logiciel dans un délai aussi bref que possible compte tenu des contraintes imposées par la réglementation en vigueur » (Cass. 1re civ., 30 avr. 2014, no 13-11068, note Huet J., RDC 2014 no 4, p. 640).
A propos de cette décision, le professeur Jérôme Huet indique notamment que « l’arrêt, dans sa simplicité, appelle une double observation : la première est que la maintenance d’un programme inclut les mises à jour rendues nécessaires par des modifications législatives ou réglementaires affectant la profession concernée, notamment lorsque celles-ci sont d’ordre purement mathématique ; la seconde est que, par le biais de l’appréciation de la faute, ce que l’on aurait pu penser relever du simple fait, se trouve soumis au contrôle de la Cour de cassation » (Huet J., Revue des contrats, décembre 2014, no 4, p. 640).
Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?
Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63
ou contactez-nous en cliquant sur le lien
Le terme du contrat est atteint à la suite d’une période déterminée ou indéterminée au départ, ou encore peut être induit par la réalisation de certains événements évoqués dans la rédaction du contrat.
I. La résiliation et la résolution
A. La résolution du contrat
Contrairement à la résiliation qui met fin au contrat et le prive d’effets uniquement pour l’avenir, la résolution anéantit, quant à elle, le contrat de façon rétroactive, ce qui suppose que les parties se retrouvent dans la situation de départ, comme si le contrat n’avait jamais existé. La résolution suppose, notamment, la restitution des sommes versées et implique de lourdes conséquences pour chacune des parties.
Dans un jugement, le tribunal de commerce de Paris a par exemple imposé au prestataire fautif (qui n’avait pas réglé à la société qui distribuait un logiciel ERP les licences nécessaires à l’activité de son client) la résolution du contrat ainsi que le remboursement des factures déjà réglées par le client (TC Paris, 5 décembre 2018, Byexpert / JL Consulting, <www.legalis.net>).
Soulignons que la résolution peut être envisagée par les parties dès la conclusion du contrat. Comme le prévoit le nouvel article 1125 du Code civil, une clause résolutoire permet de mettre automatiquement fin au contrat en cas d’inexécution par exemple, à condition qu’elle ne soit pas potestative.
Selon le nouveau texte du Code civil, « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat » et « la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution » et à condition que mise en demeure mentionne expressément la clause résolutoire (Code civil, nouvel article 1125).
Dans une espèce soumise à la Cour d’appel de Paris, un contrat de distribution de logiciels avait été conclu et avait comme particularité de contenir la clause « intuitu personae » suivante : « En dépit des clauses ci-dessus, X pourra résilier le présent contrat avec effet immédiat (…) si les actionnaires ou propriétaires actuels de la société Y venaient à cesser de contrôler la société Y, à moins que X n’approuve le transfert de propriété, ce consentement ne pouvant être refusé de manière irraisonnable ». Pour actionner cette clause, le fournisseur s’était fondé sur une annonce publique du changement de contrôle, sans attendre son effectivité juridique.
La Cour a relevé que la mise en œuvre de la clause n’était « subordonnée ni à la constatation préalable du transfert de propriété des titres cédés ni à sa mise en œuvre abusive, laquelle n’avait pas été constatée en l’espèce » (CA Paris, 5e ch., sect. B, 16 nov. 2006, SAS Microsoft France c/ Sté Solution Informatique et de développement, Juris-Data, no 2006-322561, cité, in Bitan H., Un an de droit des contrats informatiques, Comm. com. électr. 2007, no 5, p. 23).
La clause résolutoire peut donc s’analyser alors comme une clause-sanction, à l’exécution de laquelle la jurisprudence n’oppose qu’un contrôle assez limité. C’est ainsi que dans un arrêt du 10 juillet 2012 portant justement sur la rupture unilatérale d’un contrat du numérique, la chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé que comme un article du contrat « autorisait chacune des parties à résilier le contrat pour faute », il en « résultait que les parties avaient écarté l’appréciation judiciaire de la gravité de leur comportement ».
En dehors des cas de résolution judiciaire que peut prévoir le contrat, la jurisprudence de la Cour de cassation admet parfois aussi la possibilité pour une partie de rompre unilatéralement et à ses risques et périls un contrat lorsque la gravité du comportement de son cocontractant le justifie.
Si la résolution du contrat du numérique est la sanction la plus fréquente, sa mise en œuvre doit cependant répondre à certaines conditions. Il faut dans un premier temps qu’une obligation du contrat n’ait pas été exécutée.
Mais cette obligation doit cependant être une obligation essentielle du contrat, ce que vérifient assez fréquemment les juges. Et pour ce faire, ils n’hésitent pas à rechercher la commune intention des parties : « Mais attendu, en premier lieu, que recherchant la commune intention des parties dans le bon de commande, le cahier des charges et les correspondances échangées, l’arrêt retient dans l’exercice de son pouvoir souverain qu’il en résulte que les parties avaient l’intention de procéder à une informatisation globale et intégrée de la comptabilité dans des délais précis, caractérisant ainsi l’obligation de résultat, tandis que l’expert a constaté que ni le matériel, ni le logiciel ne pouvaient être utilisés en raison de l’inachèvement des modifications et de l’adaptation ».
Outre le fait que l’inexécution doit porter sur une obligation principale, il faut que cette inexécution présente une gravité suffisante. Ainsi, dans un arrêt de 1993, la Cour de cassation a voulu – pour valider la résolution – vérifier que la non-conformité du système constatée mettait le système dans l’incapacité totale de fonctionner. De même, elle reconnaît qu’il est dans le pouvoir souverain du juge du fond d’estimer que « les manquements de la société Multiconsult à ses obligations contractuelles présentaient une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat litigieux, qu’elle a prononcée ».
B. La résiliation du contrat
La résiliation du contrat concerne plus généralement les contrats à exécution successive ou à durée indéterminée alors que la résolution, organisée par le nouvel article 1224 du Code civil concerne les autres contrats.
S’agissant de la résiliation, les parties peuvent librement mettre fin au contrat, mais dans le respect des modalités prévues à cet effet. S’agissant des contrats à durée indéterminée, le nouvel article 1211 du Code civil dispose désormais que « lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ».
Un contrôle du même type trouve aussi à s’exercer lorsque la résiliation unilatérale est décidée par le fournisseur au motif qu’il lui est apparu qu’il serait finalement impossible de mener à bien le projet informatique considéré.
Dans un tel cas, la Cour de Paris a considéré que le prestataire avait « rompu le contrat du fait de son incapacité à proposer même une version simplifiée d’un projet d’une extrême complexité technique pour le montant contractuellement envisagé » et qu’en l’espèce, « cette rupture est fautive, la consultation du cahier des charges pouvant lui permettre de se convaincre aussi bien de ces éléments que de l’inachèvement du projet et des attentes particulières du client » (CA Paris, pôle 5, ch. 11, 16 mars 2012, <www.legalis.net>).
Cet abus de résiliation peut également résider dans la clause même de résiliation unilatérale contenue dans le contrat. C’est ainsi que la Commission d’Examen des Pratiques commerciales (CEPC) a estimé dans un avis du 23 février 2015 qu’était « contraire à l’article L. 442-6 I 2º du code de commerce » en raison de son « asymétrie de traitement des parties », une clause de résiliations unilatérale qui prévoyait que « si le cocontractant souhaite sortir du contrat, il doit verser de 30 % à 100 % des loyers à échoir, selon le moment de la résiliation, montant majoré le cas échéant d’une clause pénale de 10 % de ces loyers.
Et ce alors même qu’aucune exécution ne serait matérialisée. À l’inverse, les conditions générales ouvrent de nombreux cas de résiliation à la société B (ou au cessionnaire du contrat) et ce, sans que cette faculté de sortie ne soit payante ni justifiée par un motif grave ».
L’avis décrit ensuite en détail les aspects que la commission a considéré comme particulièrement déséquilibrés, ce qui nous donne de bons exemples de dispositions qu’il convient de considérer comme pouvant « soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (C. com., art. L. 442-6, I. 2º) :
« L’article 16.1 stipule que le contrat peut être résilié de plein droit avec mise en demeure infructueuse par la société B ou le cessionnaire notamment en cas de non-paiement à terme d’une seule échéance, non-exécution d’une seule des conditions du contrat. Ce même article dispose que la société B ou le cessionnaire peut, en dépit de l’exécution consécutive à la mise en demeure, tout de même résilier le contrat.
L’article 16.2, expressément contesté, prévoit une résiliation de plein droit et sans mise en demeure en cas de cessation d’activité partielle ou totale du client signataire.
L’article 16.3 dispose qu’en sus de l’intégralité des loyers, le client devra verser une indemnité de 10 % de ces loyers dès lors que le contrat est résilié par la société B ou le cessionnaire.
Par ailleurs, même s’il n’est pas parti à cette relation, le client devra verser une indemnité en cas de résolution du contrat existant entre la société B et la société de location financière cessionnaire (article 16.4) »
II. Conséquences sur la fin du contrat de maintenance
A. Le contrat de maintenance
La maintenance peut d’abord être liée, en ce sens qu’elle dépend d’un autre contrat, dont elle est une clause ou un contrat annexe indivisible. Il peut s’agir de la vente d’un ordinateur, d’une imprimante, d’un scanneur, ou d’un ensemble plus complexe (voire un contrat relatif à un logiciel, mais alors c’est à tort que le mot de maintenance est utilisé).
Souvent expresse, elle découle aussi, fut-ce implicitement, des clauses de garanties contractuelles, qui obligent le vendeur à réparer gratuitement l’appareil, ou à remédier aux défaillances d’un logiciel (si tant est qu’il puisse exister une maintenance à leur égard, ce qui est contestable). D’un autre côté, il nous semble qu’un professionnel est tenu, de par sa qualité, d’assurer au minimum un service après-vente (qui est distincte de la maintenance), indépendamment de toute garantie conventionnelle.
À côté de la vente, la maintenance peut aussi être liée à un contrat de sécurité, un crédit-bail, à une location-vente, à une location classique d’une unité centrale (processeur) comme de tout autre matériel informatique, ou encore à une location-service (dite parfois renting), dans laquelle le locataire est mandaté par le loueur pour acheter les biens qui lui conviennent (comme dans le crédit-bail), alors que le loueur se charge de leur maintenance. La formation peut encore être liée à des licences de logiciel et à de la maintenance.
Lorsque la maintenance est ainsi associée à un contrat principal de fourniture ou de location, la résiliation du contrat principal entraîne automatiquement celle du contrat de maintenance, dans la mesure où ils sont indivisibles.
La circonstance qu’un contrat de maintenance soit lié à un autre contrat, dont il peut être regardé comme l’accessoire, emporte une importante conséquence en cas de modification du titulaire des droits du contrat de base, qui est son support. Si le propriétaire ou le locataire de l’installation change, le contrat de maintenance sera transféré sur la tête du nouveau propriétaire ou du nouveau locataire, après simple signification au débiteur cédé.
Parfois, le contrat supprime même cette exigence ; dès lors, le débiteur cédé ne peut pas s’opposer à la cession. Cependant, les parties ont pu convenir d’une clause en sens contraire. Il en existe de deux sortes. Soit elle précise que le contrat a été conclu intuitu personæ, ou firmæ, comme cela est presque d’usage dans les contrats de maintenance informatique, pour interdire toute transmission ; soit, un degré en dessous, elle soumet la transmission à un agrément de l’autre partie.
Mais il a été jugé que le contrat de maintenance était automatiquement transmis (sous-entendu malgré toute clause contraire) au sous-acquéreur d’un ordinateur et d’un système d’exploitation (operating system [OS], lorsque le fournisseur initial a le monopole en France du matériel et du système, d’où personne d’autre ne peut effectuer cette prestation.
B. Défaut de résiliation du contrat de maintenance en cas d’utilisation du logiciel
Par un jugement prononcé le 14 octobre 2021, le tribunal de commerce de Rennes a refusé de prononcer la résiliation du contrat de maintenance portant sur des logiciels fournis malgré les dysfonctionnements, car les clients avaient continué de les utiliser.
Il a estimé que l’exécution du contrat avait été partielle et, en conséquence, il a seulement ordonné une indemnisation des clients par une réfaction de 40 % de leurs factures de prestations émises durant les trois ans.
Deux PME spécialisées dans l’emballage avaient souscrit une offre commerciale portant sur l’implémentation d’une solution logicielle standard de gestion de fournisseurs et de clients, de comptabilité, etc. En plus de la mise à disposition des logiciels, le contrat incluait une formation des utilisateurs, une assistance en ligne, une maintenance corrective et évolutive.
Dès le début, les clients ont rencontré des difficultés pour installer et paramétrer les logiciels. Ils ne pouvaient pas l’utiliser de manière optimale. « Le tribunal constatant que les prestations se poursuivent même si la prestation fournie (…) laisse à désirer et que l’exécution du contrat peut être qualifiée de partielle, la société Exact palliant certaines incapacités des défenderesses, juge qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation des contrats ».
Les clients demandaient 100 000 € de dommages-intérêts, se basant notamment sur le temps passé par leurs salariés à installer et à paramétrer les logiciels ou à corriger les erreurs. Si le tribunal reconnaît le préjudice sur le principe, il en réfute le montant. Il leur accorde cependant une réfaction du prix, concernant la maintenance.
Pour lire une version plus complète de cet article sur la résiliation d’un contrat de maintenance de logiciel, cliquez
Sources :
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024761210?init=true&page=1&query=10-26203&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033486905?init=true&page=1&query=15-17.743+&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026182917?init=true&page=1&query=11-20.060&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020259667?init=true&page=1&query=08-12415&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007509424?init=true&page=1&query=05-15590&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033570035?init=true&page=1&query=15-12.981&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007235749?init=true&page=1&query=92-20.589&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007431900?init=true&page=1&query=98-10.600&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007208875?init=true&page=1&query=91-18.583&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007052075?init=true&page=1&query=02-21.240&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019035577?init=true&page=1&query=07-14.299&searchField=ALL&tab_selection=all