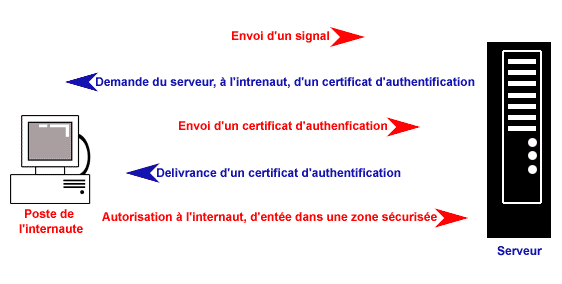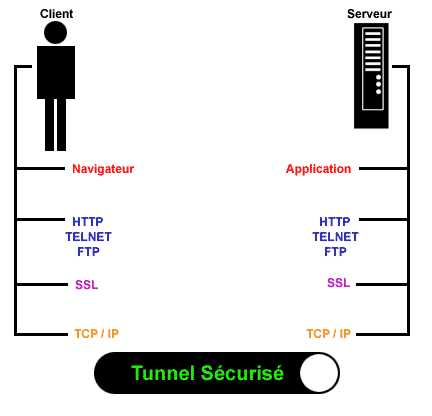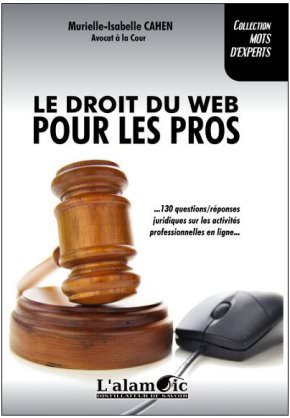16 Nov 2022
La qualification juridique du contrat des conducteurs Uber et VTC
De nombreuses affaires ont eu lieu ces dernières années concernant le statut des chauffeurs VTC. Une véritable bataille juridique est née entre les chauffeurs et les plateformes, notamment contre la société Uber. Ces plateformes permettent la mise en relation de chauffeur avec les clients pour exercer un service de transport. L’objectif étant pour ces chauffeurs d’obtenir une requalification de leur contrat de travail et ainsi pouvoir bénéficier des avantages d’un salarié.
NOUVEAU : Utilisez nos services pour vous défendre en passant par le formulaire !
Classiquement, le contrat de travail se définit comme étant « une convention par laquelle une personne s’engage monnayant rémunération pour accomplir une prestation au profit d’une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place »
La détermination de ce contrat se base donc sur différents critères. A savoir, la réalisation d’une prestation par un travailleur contre une rémunération. Cette prestation doit être réalisée pour le compte d’une autre personne avec laquelle un lien de subordination doit exister.
L’entreprise Uber existe dans près de 800 villes à travers le monde. L’application compte plus de 118 millions de clients chaque mois. Le chiffre d’affaires de l’entreprise est estimé à environ 6 milliards de dollars. Enfin, la plateforme compte près de 10 000 nouveaux chauffeurs VTC par an au niveau mondial.
Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de droit du travail ou de contrat ?
Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63
ou contactez-nous en cliquant sur le lien
La plateforme a également de nombreux procès à son actif. Entre 2009 et 2016, aux États-Unis, l’entreprise a été condamné dans 170 procès et a dû verser près de 160 millions de dollars.
L’entreprise est aussi dans le viseur de plusieurs pays, dont la France. Ces litiges ont conduit à des grèves mener par les chauffeurs de taxi en raison de concurrence déloyale. Les chauffeurs de la plateforme dénoncent quant à eux des « « des conditions de travail indignes » .
Récemment, le juge européen s’est prononcé en faveur d’une réglementation nationale à laquelle devra se plier l’entreprise. En effet, la Cour de justice de l’Union européenne (“CJUE“) a affirmé, ce 20 décembre 2017, que la société Uber propose bien un “service de transport“.
La décision rendue par la CJUE à de nombreuses conséquences, elle demande aux législations nationales de s’affirmer (I) et permet donc à des pays comme la France de continuer sur sa lancée en la matière en règlementant de manière plus stricte ce domaine. (II)
Pour rappel la société américaine Uber, anciennement UberCab, permet depuis 2010 la mise en contact d’un particulier avec un conducteur, dans le cadre de services de transport.
Les enjeux liés à la définition du statut des conducteurs Uber sont d’autant plus importants qu’aujourd’hui, l’entreprise s’est développée dans plus de 310 villes à travers le monde, pour un chiffre d’affaires annuel de plus de 6 milliards de dollars, et 10 000 nouveaux chauffeurs de VTC en plus chaque année au niveau mondial (https://www.lesechos.fr/11/10/2015/lesechos.fr/021395598585_uber—dans-les-coulisses-d-une-machine-de-guerre-juridique.htm).
Récemment, le juge européen s’est prononcé en faveur d’une réglementation nationale à laquelle devra se plier l’entreprise. En effet, la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE« ) a affirmé, ce 20 décembre 2017, que la société Uber propose bien un « service de transport« .
Cette décision n’est pas sans conséquence pour la qualification des chauffeurs des plateformes de VTC : en renvoyant la balle dans le camp des législations nationales (I), elle permet définitivement à des pays comme la France d’asseoir une réglementation plus stricte en la matière (II).
I) Le feu vert donné par la CJUE aux législations nationales
L’arrêt Uber Systems Spain, en ce qu’il renvoie à la législation nationale en la matière (A), permet aux droits nationaux de venir répondre à des litiges surabondants (B).
A) L’arrêt Uber Systems Spain
Cette affaire concentre les questions autour de la qualification des activités et du cadre légal applicable à l’entreprise Uber, questions auxquelles la CJUE s’est efforcée de répondre.
Pour rappel, une plainte avait été déposée en 2014, par une association professionnelle de chauffeurs barcelonais, devant le tribunal de commerce de la ville aux motifs de « pratiques trompeuses » et « concurrence déloyale » de la filiale espagnole « Uber Systems Spain« .
A la suite d’une question préjudicielle, la CJUE a finalement répondu « qu’un service d’intermédiation tel que celui en cause doit être considéré comme étant indissociablement lié à un service de transport » et que « en l’état actuel du droit, il revient aux États membres de réglementer les conditions de prestation de tels services ».
Par son arrêt du 20 décembre 2017, elle affirme donc que les services proposés par Uber relèvent de la politique commune des transports urbains et doivent donc être soumis aux « licences et agréments requis par le droit national » . Les règles applicables aux taxis s’appliquent désormais à Uber.
B) Une réponse adaptée aux différents droits nationaux
De nombreux mouvements nationaux avaient déjà commencé pour aller dans ce sens.
Dans une décision du 10 novembre 2017, le tribunal du travail de Londres a estimé que la société Uber devait considérer les chauffeurs comme de véritable salarié et par conséquent, les rémunérer au salaire minimum et leur octroyer des congés payés. Ce sont donc 70 000 chauffeurs britanniques qui ont reçu le statut de travailleur.
Pour rendre cette décision, la cour s’est appuyée sur le fait que “les chauffeurs seraient obligés d’accepter 80 % des courses que l’application leur envoie“, excluant de fait toute qualification possible de travailleur indépendant.
Egalement, le tribunal de grande instance de Paris dans un arrêt rendu le 12 octobre 2017 a décidé de requalifier la relation entre un chauffeur VTC autoentrepreneur et la société LeCab de contrat de travail.
Aux États-Unis, de nombreux litiges ont également eu lieu avec la plateforme Uber, la justice, à titre d’exemple, a refusé l’accord proposé par Uber en août 2016 du versement de 100 millions de dollars à d’anciens chauffeurs ayant agi en justice en nom collectif dans le but de voir leur contrat requalifié en contrat de travail. Ce refus s’explique notamment par le fait que le préjudice s’estimait ici à plus de 850 millions de dollars, et que la somme proposée par l’entreprise ne pouvait justifier l’abandon de la plainte par les requérants, étant « inadéquate » au préjudice subi.
Toujours aux États-Unis, en Californie une loi votée en 2019 avait finalement considéré que les chauffeurs Uber devaient avoir le statut de salarié. La plateforme Uber avait répliqué avec un référendum. La juge a finalement déclaré le 20 août 2021, que ce référendum était inconstitutionnel.
La décision rendue par la Cour de justice de l’Union européenne devrait donc permettre de clarifier la qualification accordée aux liens contractuels entre les conducteurs et leur employeur.
Besoin de l’aide d’un avocat pour un contrat de travail ?
Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63
ou contactez-nous en cliquant sur le lien_
II) Une décision accompagnée par le droit français
La loi Grandguillaume, entrée en vigueur le premier janvier 2018 (A), constitue une nouvelle étape dans l’établissement d’une qualification pertinente des contrats des conducteurs (B).
A) La loi Grandguillaume
La « Loi Grandguillaume », du 29 décembre 2016 est venue réguler le secteur du transport en France.
Elle a notamment pour finalité de « pacifier les relations entre taxis et VTC, réguler l’activité de transport public de personnes [ou encore] interdire aux capacitaires LOTI l’utilisation de plateforme type Uber » (https://www.rhinfo.com/thematiques/gestion-administrative/code-du-travail/vtc-loti-uber-et-la-loi-grandguillaume).
Il faut savoir que le statut de capacitaire LOTI, issu du 30 décembre 1982, nécessite normalement le transport d’au moins deux personnes. On parle ici de transport « collectif« , et non pas de transport « public particulier ».
Mais ce statut fait débat en ce qu’il est de plus en plus utilisé par les chauffeurs affiliés aux plateformes de VTC, qui incitent fortement leurs prestataires à agir en tant qu’indépendants, ce qui contrevient à l’essence même de la loi.
La loi Grandguillaume est désormais applicable, et met fin au détournement du statut LOTI, en imposant aux chauffeurs d’exercer soit comme taxi, soit comme VTC. Du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018, la loi avait d’ailleurs prévu une période transitoire durant laquelle les conducteurs pouvaient effectuer les démarches pour obtenir la licence de leur choix.
Par conséquent, les conducteurs n’ayant pas entamé les démarches administratives avant le 1er janvier 2018, ne peuvent aujourd’hui plus exercer.
Egalement, la loi vient intensifier la lutte antifraude. Elle impose certaines obligations comme la détention d’une carte professionnelle par les chauffeurs, ou encore la présence obligatoire du macaron sur les véhicules. Elle modifie également les conditions d’accès à la licence VTC, en remplaçant les 3 semaines de formations par un examen en deux parties, écrite et pratique.
Ainsi, par ce biais, le droit français vient renforcer le cadre juridique des différents statuts, en unifiant les règles applicables en la matière.
B) Les enjeux d’une requalification
Le débat lié à la qualification des contrats entre les chauffeurs et la société de transport n’est pas nouveau.
Dans un arrêt « Labanne » en date du 19 décembre 2000, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de requalifier un contrat de « location de véhicule équipé taxi » en contrat de travail.
La Cour de cassation s’est notamment appuyée sur les critères de qualification dégagés dans l’arrêt société Général de 1996. Les critères sont donc les suivants : l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination.
Différents indices, laissent penser qu’aujourd’hui une telle qualification pourrait être opérée sur le fondement de ces critères, et notamment du lien de subordination : en effet les chauffeurs sont soumis à un système de notation et peuvent dès lors se voir écartés, pratiques pouvant s’apparenter à une forme de licenciement.
De plus, les tarifs applicables ne sont pas choisis par les chauffeurs. En effet ces derniers sont imposés par la société, ce qui demeure paradoxal au regard de leur statut d’autoentrepreneur.
Cette requalification s’accompagne de nombreuses conséquences pour les chauffeurs Uber conformément au droit du travail : congés payés, SMIC, mutuelle d’entreprise, visites médicales et arrêts maladie, respect des durées maximales de travail et droit au repos, ou encore indemnités de licenciement sont de ces dispositions qui relèvent du régime juridique du contrat de travail, et dont pourront bénéficier les salariés.
Cette jurisprudence a abouti à un arrêt du 4 mars 2020 venant confirmer un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 10 janvier 2019, où le contrat entre le chauffeur et la plateforme Uber a été requalifié en contrat de travail. Pour obtenir cette requalification, la Cour a utilisé la méthode du faisceau d’indices pour démontrer le lien de la subordination entre le chauffeur et la plateforme.
Ces indices étant l’absence de clientèle propre au chauffeur, l’absence de contrôle du chauffeur sur ses tarifs et ses conditions d’exercice de sa prestation. De plus, la Cour a retenu la subordination en raison de l’existence de cette clause « Uber se réserve également le droit de désactiver ou autrement de restreindre l’accès ou l’utilisation de l’Application Chauffeur ou des services Uber par le Client ou un quelconque de ses chauffeurs ou toute autre raison, à la discrétion raisonnable d’Uber ».
Les conditions du lien de subordination, pour déterminer s’il y a un contrat de travail, étant la direction, le contrôle et le pouvoir de sanction. Or ces trois conditions sont des pouvoirs de la plateforme Uber et non au chauffeur donc la Cour de cassation dispose que le statut d’indépendant des chauffeurs Uber est fictif. Cependant, tous les chauffeurs Uber n’ont pas vu leur contrat requalifié en contrat de travail, pour cela il faut passer devant le juge.
Cet arrêt s’inscrit dans la jurisprudence récente, en effet, dans l’arrêt de la CJUE du 22 septembre 2020 concernant la plateforme Airbnb, la CJUE a autorisé l’application par les États membres de la législation sur les hôtelleries aux personnes louant leur logement sur la plateforme Airbnb. L’intérêt étant d’aboutir à une régulation des plateformes numérique de travail.
On retrouve la même bataille concernant les coursiers travaillant pour les entreprises tels que Uber. Dans arrêt rendu en 2018, nommé « Take eat easy », la Cour de cassation avait estimé que l’existence d’un lien de subordination était en l’espèce bien caractérisé notamment en raison du pouvoir de sanction et de contrôle exercé par Uber. Ainsi, le contrat devait être requalifié.
Egalement, dans un arrêt rendu le 19 avril 2022, la Cour de cassation a maintenu sa position stricte envers ces plateformes de livraison et a condamné la société Delivroo France à 375 000 euros d’amendes pour travail dissimulé. Et a attribué le statut de salarié aux livreurs.
Les batailles menées contre les plateformes basées sur le modèle Uber n’ont donc pas fini d’exister.
Pour lire l’article dans une version plus complète, cliquez sur les mots VTC, UBER et contrat de travail
SOURCES :
- http://www.liberation.fr/futurs/2017/11/10/droit-du-travail-uber-perd-le-match-retour-en-angleterre_1609231
- https://www.lesechos.fr/11/10/2015/lesechos.fr/021395598585_uber—dans-les-coulisses-d-une-machine-de-guerre-juridique.htm
- https://www.theguardian.com/technology/2016/apr/13/uber-lawsuits-619-million-ride-hailing-app
- http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/explicateur/2016/12/24/29004-20161224ARTFIG00007-pourquoi-les-chauffeurs-sont-en-colere-contre-uber.php
- http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32006L0123
- http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32000L0031
- http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf ; jsessionid=9ea7d0f130d594b923a1f1dc44e7be72e50fd2dd6462.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNuKe0?text=&docid=198047&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1122394
- https://www.rhinfo.com/thematiques/gestion-administrative/code-du-travail/vtc-loti-uber-et-la-loi-grandguillaume
- https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/vtc-gouvernement-confirme-lapplication-loi-grandguillaume-au-1er-janvier-2018-et-accompagnera
- https://www.saisirprudhommes.com/fiches-prudhommes/les-chauffeurs-uber-et-le-droit-du-travail
- https://www.village-justice.com/articles/Les-chauffeurs-auto-entrepreneurs-Uber-sont-des-salaries, 23437.html
- Cour d’appel de Paris, 10 janv. 2019, no 18/08357
- , 4 mars 2020, n°19-13.316
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/374_4_44522.html - CJUE, 22 septembre 2020, C-724/18
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231406&pageIndex=0&do-