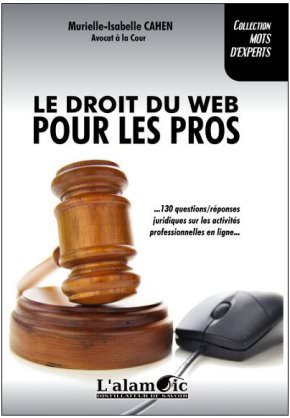4 Fév 2022
CLAUSE DE NON CONCURRENCE ET GARANTIE LEGALE
La clause de non-concurrence est une figure contractuelle que l’on retrouve en droit du travail et en droit commercial.
Ainsi existe en droit commercial, à la charge du vendeur, une interdiction de faire concurrence, après la vente de son fonds de commerce et à l’expiration de la garantie légale prévue en la matière. La clause permet la poursuite dans le temps des effets de la garantie. Elle donne à la vente sa réelle efficacité. En effet, la clientèle risque d’être attirée par le commerçant se réinstallant à proximité du fonds vendu. Or, la clientèle est l’élément souvent essentiel du fonds de commerce, sinon, pour certains auteurs, le fonds lui-même.
En droit du travail, l’obligation de non-concurrence est une stipulation par laquelle un salarié se voit interdire, après la rupture du contrat de travail, pendant une certaine durée et dans un certain espace géographique, de concurrencer son ancien employeur.
Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?
Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63
ou contactez-nous en cliquant sur le lien
L’obligation de non-concurrence est une obligation post-contractuelle. Ainsi, la chambre sociale a précisé que : « la clause de non-concurrence, étant distincte de l’obligation de loyauté à laquelle le salarié se trouve soumis pendant la durée d’exécution du contrat, et n’ayant pu entrer en application qu’à compter de la rupture du contrat de travail, (une) cour d’appel a exactement énoncé que les seuls manquements du salarié pouvant, dans le cadre de cette clause, permettre à l’employeur de s’exonérer de son obligation financière étaient ceux fondés sur des faits postérieurs à la rupture ».
En outre, selon les articles 1625 et 1626 du Code civil, le vendeur est tenu d’une obligation de garantie de l’éviction du fait personnel : il doit donc au vendeur une paisible possession de la chose vendue.
En effet, le vendeur doit garantir l’acquéreur, non seulement de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, mais aussi de charges prétendues sur cet objet et non déclarées lors de la vente.
Par ailleurs, à l’expiration de la clause de non-concurrence, l’acquéreur d’un fonds de commerce demeure fondé à se prévaloir de la garantie légale d’éviction prévue par l’article 1626 du Code civil, qui interdit au cédant tout agissement ayant pour effet de lui permettre de reprendre la clientèle du fonds cédé, privant ainsi celui-ci de sa substance.
I. Le maintien de la garantie légale d’éviction
A. Le champ d’application de la garantie légale d’éviction
Le principe issu du droit commun de la vente est que tout vendeur doit garantir son acquéreur contre les évictions émanant notamment de son fait personnel. L’adage « qui doit garantie ne peut évincer » précise que le vendeur ne peut, par des moyens détournés, tenter de conserver une partie ou la totalité de ce qu’il a cédé.
D’abord, le vendeur d’un fonds de commerce est tenu de ne pas reprendre la clientèle du fonds cédé. Il s’agit de l’interdire d’effectuer des actes visant à détourner la clientèle, c’est-à-dire de concurrencer, même par des moyens loyaux, le cessionnaire.
L’obligation de non-concurrence résultant de la garantie légale est autonome par rapport à celle issue d’une éventuelle clause de non-concurrence engageant le cédant. L’extinction de cette dernière (par arrivée du terme, par annulation ou par « rachat ») est donc sans incidence sur la durée de l’obligation légale de non-concurrence.
Toutefois, la réinstallation demeure possible sous la condition qu’aucune concurrence ne soit réalisée à l’encontre du fonds de commerce exploité par le cessionnaire.
Ensuite, la garantie d’éviction a une durée illimitée. Certains auteurs affirment même qu’elle est perpétuelle. Il semble toutefois que le vendeur ne sera plus tenu de garantir l’acquéreur dès que le fonds de commerce cédé aura disparu ou aura été transformé. De plus, la garantie ne prend pas fin en cas de décès du vendeur, ses héritiers demeurant tenus de manière indivisible vis-à-vis de l’acquéreur.
La garantie légale se trouve transmise non seulement aux héritiers, mais également aux ayants droit de l’acquéreur. Si le fonds de commerce fait l’objet d’une mutation, les nouveaux propriétaires bénéficieront des mêmes garanties de la part du vendeur originaire.
La garantie d’éviction se révèle être d’une redoutable étendue pour le vendeur du fonds de commerce. Il ne pourra ainsi effectuer de manière directe aucune concurrence à son acquéreur jusqu’à ce que celui-ci cesse son exploitation.
Enfin, la jurisprudence a étendu le champ d’application des articles 1627 et 1628 du Code civil en affirmant qu’un vendeur, personne physique, différente de la personne morale exerçant la concurrence, mais dans laquelle le vendeur apparaissait en qualité de gérant, pouvait être tenu de la garantie du fait personnel.
Ainsi le vendeur reste tenu même si la concurrence est exercée par une tierce personne dès lors qu’il participe de manière indirecte à la concurrence. Il en serait de même, si le vendeur offrait ses services, éventuellement à titre gracieux, à un tiers visant à concurrencer l’acquéreur.
Le vendeur du fonds de commerce ne doit procéder à aucun acte de concurrence direct ou indirect à l’encontre de son acquéreur et pendant toute la durée d’existence du fonds. Cette garantie étant efficace tant à l’égard des différents propriétaires du fonds que des héritiers ou ayants droit du vendeur. Compte tenu de l’étendue du champ d’application de la garantie légale, analysons son régime.
B. Le régime de la garantie légale d’éviction
Le principe est que la garantie légale a un caractère d’ordre public. L’article 1628 du Code civil le confirme clairement. Ce caractère se justifie par la volonté d’empêcher un contractant, au moyen d’une clause, de supprimer l’objet de la convention.
En conséquence, l’aménagement conventionnel de cette garantie ne pourra porter que sur une extension et en aucun cas sur une limitation ou une suppression de ses effets.
De plus, cette garantie existe sans qu’il soit nécessaire de la mentionner dans le contrat de vente de fonds de commerce, les caractères légaux et d’ordre public de la garantie suffisent à démontrer son existence. Le vendeur du fonds de commerce se trouve tenu de ne pas concurrencer son acquéreur sans pouvoir limiter cette obligation de quelque manière que ce soit. La qualité de professionnel des parties en général commerçant ne leur permet pas de renoncer à cette règle d’ordre public.
Cependant, il semble possible lors de la vente de mentionner l’existence d’un autre fonds exploité par le vendeur et qui risque de concurrencer l’acquéreur. Il conviendra alors, non pas d’une manière conventionnelle, mais en application des articles 1627 et 1628 du Code civil d’informer l’acquéreur de la situation afin qu’il confirme ou non son intention d’acquérir.
Le fondement de cette situation réside dans son caractère aléatoire, l’acquéreur prenant ou non, en connaissance de cause le risque d’être concurrencé. Toutefois, cette particularité ne se révèle que rarement et il conviendra d’être prudent, car, en cas de litige, la possibilité de concurrencer l’acquéreur reste soumise à la libre appréciation des juges. La prudence s’impose donc aux parties et aux rédacteurs de la clause notamment à cause des sanctions possibles.
La première sanction en cas de non-respect de la garantie légale d’éviction consiste dans l’exercice d’une exception de garantie lorsque le vendeur exercera une action judiciaire. Ce moyen a l’avantage d’être imprescriptible, toutefois, sa mise en œuvre ne paraît pas facile.
Ensuite, l’acquéreur peut obtenir la résolution de la vente, éventuellement la condamnation sous astreinte à la fermeture du fonds de commerce exerçant la concurrence à l’encontre de l’acquéreur. Mais en général il demandera le versement de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi. Ces sanctions se caractérisent par une sévérité en rapport avec l’importance que revêt la garantie d’éviction dans un contrat où l’objet vendu est parfois lié étroitement avec la personne qui l’exploite. Compte tenu des caractères et du régime de la garantie d’éviction, les parties ont-elles toujours intérêt à insérer une clause contractuelle de non-concurrence dans leur contrat de vente de fonds de commerce ?
II. L’opportunité de la clause de non-concurrence dans la vente de fonds de commerce
A. La contractualisation de la concurrence
L’objectif de la clause de non-concurrence est de déterminer les contours de l’obligation de concurrence, mais se trouve limité tant par les conditions de validité et d’opportunité de la clause de non-concurrence que par sa sanction.
En effet, la clause de non-concurrence, pour être valide, doit être limitée d’abord dans le temps ou dans l’espace. La jurisprudence considère cette limitation comme alternative, il n’est donc pas nécessaire de prévoir à la fois une durée et un secteur géographique de non-concurrence. Il est à noter que la clause pourra s’avérer à durée indéterminée puisqu’elle pourra ne préciser qu’une limite spatiale.
Elle doit ensuite limiter l’objet de la concurrence, c’est-à-dire ne concerner que toute ou partie de l’activité cédée sans permettre de violer l’obligation légale de garantie. En pratique, elle porte sur les activités cédées et relatées dans l’acte de vente du fonds de commerce.
Enfin, la clause de non-concurrence doit être justifiée par un intérêt légitime. D’une part, elle ne joue qu’un rôle accessoire au contrat de vente de fonds de commerce en protégeant simplement l’acquéreur contre une concurrence du vendeur. Elle doit être utile au maintien du contrat.
D’autre part, elle doit être proportionnée à l’objectif poursuivi par l’acquéreur, c’est-à-dire éviter la concurrence du vendeur portant sur le fonds vendu. Pour respecter cette règle, la clause ne devra pas empêcher le vendeur d’exercer toute activité commerciale ou salariée ce qui la rendrait contraire à la fois à la liberté du commerce et du travail.
Cette condition est importante et fait l’objet d’une attention particulière de la jurisprudence qui n’hésite pas à sanctionner la disproportion entre l’intérêt de l’acquéreur à protéger et la rigueur de la clause pour le vendeur. La clause de non-concurrence sera limitée à ce qui est « nécessaire à la sécurité de l’acquéreur ».
Sous ces réserves, la convention des parties pourra déterminer les conditions opportunes d’une éventuelle concurrence notamment avertir l’acquéreur d’une réinstallation ou du maintien d’un fonds concurrent par le vendeur. Ces précisions permettront à l’acquéreur de maintenir ou non son intention d’acquérir en connaissance de cause. La prudence du rédacteur et du vendeur restera de rigueur, car l’ordre public de la garantie légale constitue une menace, le vendeur se gardera notamment d’effectuer des démarches auprès des clients fréquentant le fonds cédé.
Après avoir déterminé les conditions de la concurrence, les parties auront intérêt à déterminer la sanction applicable en cas de violation. Cette clause pourra prévoir notamment le recours au référé. Cette procédure permet de faire constater l’application d’une clause résolutoire conventionnelle, d’agir rapidement et de limiter l’interprétation des juges.
Ensuite, il peut être prévu le versement d’une somme d’argent à titre de clause pénale ou le montant d’une astreinte pour faire cesser le trouble ou tous autres critères de détermination de la réparation du préjudice subi par l’acquéreur. Le principe de la liberté contractuelle trouve là à s’exercer pleinement et permet au rédacteur de simplifier et donc de renforcer la mise en œuvre de la sanction de la concurrence.
Les parties ayant la possibilité au moyen de la convention de déterminer le contenu de la concurrence et éventuellement sa sanction, la clause se révèle aussi opportune pour prouver les contours de cette obligation.
B. La preuve de l’obligation de non-concurrence
Une clause de non-concurrence post-contractuelle, parfois également dénommée clause de non-rétablissement ou de non-réinstallation, par exemple acceptée par un salarié, ou par le cessionnaire d’un fonds, est en principe valable, mais sous les conditions spécifiques synthétisées ci-dessous en dehors de celles qui résultent du Droit commun ou spécial en cause.
De même, la preuve de l’obligation de non – concurrence est à la charge de celui qui l’invoque (Code civil, article 1315). Exceptionnellement, le principe même de la stipulation d’une clause de non-concurrence peut être écarté (par ex. l’article 1erter de l’ordonnance no 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat).
Le premier avantage d’insérer une clause de non-concurrence est de prouver son étendue au vendeur. Il lui sera difficile de prétendre ne pas avoir violé la clause quand celle-ci interdit toute réinstallation alors qu’il y a procédé.
Toutefois, il faudra, pour que la preuve soit plus aisée, que la clause soit claire et évite tout recours à l’interprétation. À défaut, cela reviendra à recourir aux juges qui parfois seulement admettront l’application de la garantie légale à l’égard de ces personnes alors que juridiquement il ne s’agit pas du vendeur du fonds de commerce.
Ensuite, l’insertion de la clause permettra de prouver la faute commise par le vendeur. Dès qu’il ne respectera pas l’engagement contractuel, il sera présumé fautif. Il ne pourra alors invoquer que l’illicéité de la clause en réponse.
La preuve de la faute est donc facilitée puisqu’il suffit de démontrer que le vendeur a violé les termes clairs de la clause de non-concurrence, sans avoir à prouver le non-respect de la garantie légale en établissant toutes les conditions de celle-ci ce qui s’avère souvent plus délicat et sujet à appréciation.
Enfin, le dernier avantage consiste dans la preuve de la connaissance par le vendeur de l’interdiction de concurrence et donc dans l’intérêt pédagogique de cette clause. Alors que la garantie légale peut se révéler méconnue du vendeur de fonds de commerce, l’insertion d’une clause démontrera l’existence, les contours et les sanctions de l’obligation de non-concurrence. En ne la respectant pas, il pourra difficilement invoquer la bonne foi alors que le rédacteur l’aura sensibilisé sur l’interdiction de concurrencer l’acquéreur.
Ainsi la clause de non-concurrence présente plusieurs intérêts bien que les effets de la garantie légale soient toujours sous-jacents. Le rédacteur devra informer les parties, le vendeur en particulier, que le respect strict des termes et délais de la clause conventionnelle ne signifie pas que la garantie légale ne s’applique pas.
Ainsi, en ne violant pas la clause ou en attendant son expiration avant de concurrencer l’acquéreur, le vendeur peut être condamné pour avoir contrevenu à la garantie légale.
En outre, la violation d’une clause de non-concurrence peut engendrer un préjudice qui sera réparé si tant est que la preuve de sa réalité est rapportée. À défaut d’une telle preuve, l’employeur ne peut prétendre à aucune réparation.
Il n’y a pas d’automaticité du préjudice. Il peut donc exister un intérêt à assortir l’obligation de non-concurrence d’une clause pénale, fixant par anticipation le montant de l’indemnité due par le salarié qui y manquerait, d’où le pouvoir modérateur du juge ; et si le salarié ne peut invoquer une absence de préjudice subi par l’employeur pour tenter d’échapper à la condamnation, il est à l’inverse possible de convenir que s’y ajouteront des dommages et intérêts supplémentaires en réparation du préjudice effectivement subi par l’employeur.
Au lieu des dommages et intérêts, conventionnellement déterminés ou judiciairement prononcés, le juge a également le pouvoir d’interdire l’activité concurrente exercée contrairement à la clause ; mais c’est apparemment l’un ou l’autre. (Id. pour une mesure d’interdiction.
Le nouvel employeur qui se rendrait complice de ce manquement contractuel en connaissance de cause pourrait voir sa responsabilité délictuelle engagée, sauf à en contester lui-même la validité.
Mais il arrive aussi que les conventions collectives prévoient la possibilité, pour l’employeur, de relever le salarié de son obligation de non-concurrence. À défaut, celui-ci peut prétendre à une indemnité, dont le montant varie d’ailleurs selon l’origine de la rupture, démission ou licenciement.
Quant à la preuve de la violation de l’obligation de non-concurrence, elle repose sur l’employeur, toute disposition contraire étant inopérante, étant rappelée au surplus que le fait pour un salarié de solliciter un emploi au sein d’une société concurrente ne caractérise pas, à lui seul, une violation d’une clause de non-concurrence.
Pour lire une version plus complète de cet article sur les clauses de concurrence déloyale et leur garantie, cliquez
Sources :
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006990320?init=true&page=1&query=72-11.542&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007039569?init=true&page=1&query=96-13.292&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021512158?init=true&page=1&query=08-20.522+&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007459313?init=true&page=1&query=02-11.384&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017831503?init=true&page=1&query=05-19.978&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007045233?init=true&page=1&query=00-10.978&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037495370?init=true&page=1&query=16-28.133&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007036431?init=true&page=1&query=92-42.298&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038797796?init=true&page=1&query=17-28.717&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007040566?init=true&page=1&query=95-44.747&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007022708?init=true&page=1&query=87-11.473&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007025417?init=true&page=1&query=87-40.890&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038238747?init=true&page=1&query=18-10.406&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007049993?init=true&page=1&query=04-45.546&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020453619?init=true&page=1&query=07-41.894&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027307864?init=true&page=1&query=11-25.619&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007425716?init=true&page=1&query=99-11.320&searchField=ALL&tab_selection=all